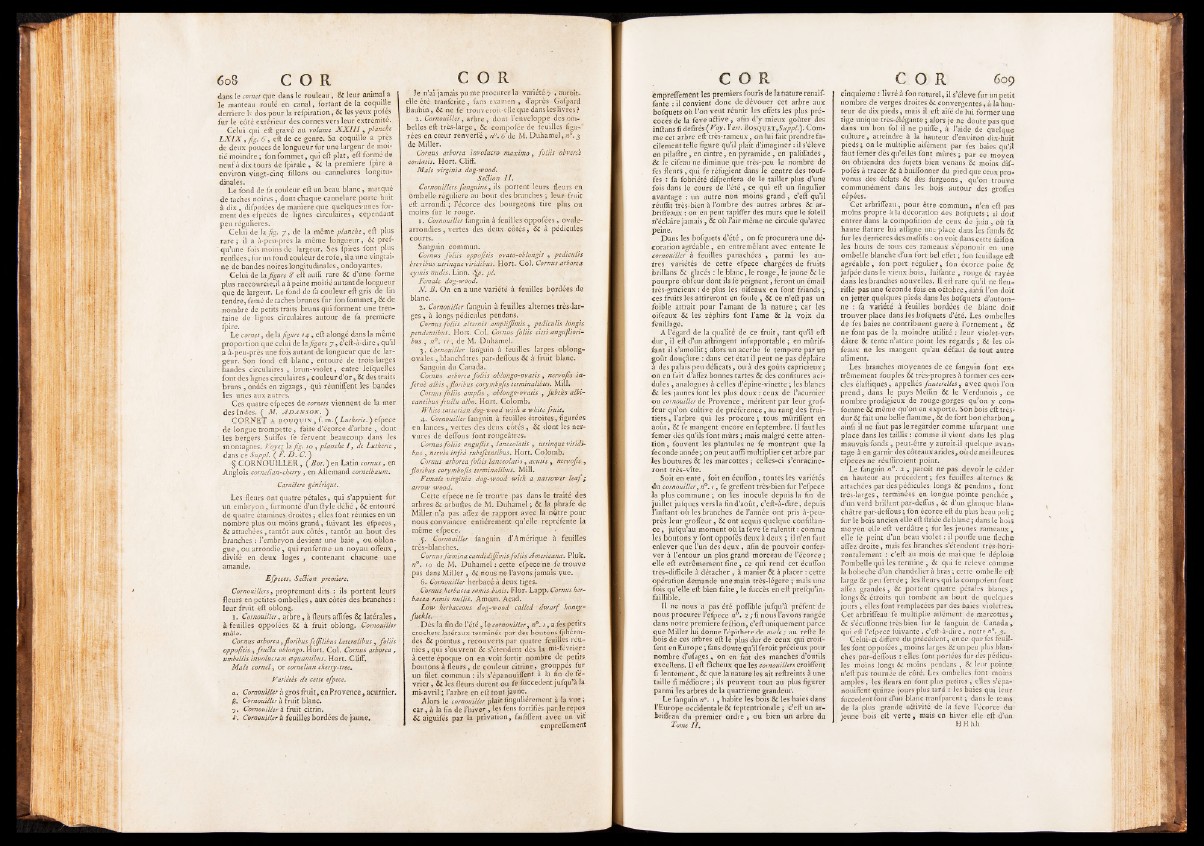
dans le cornet que dans le rouleau, & leur animal a |
le manteau roulé en canal, fortant de la coquille I
derrière k dos pour la refpiration, 6c les yeux pofés 1
fur le côté extérieur des cornes vers leur extrémité..
Celui qui eft gravé au volume X X I I I , planche
L X I X , fig. 6 , eft de ce genre. Sa coquille a près
de deux pouces de longueur fur une largeur de moitié
moindre ; fon fommet, qui eft plat, eft forme de
neuf à dix tours de fpirale , & la première fpire a
environ vingt-cinq filions ou cannelures longitudinales.
,
Le fond de fa couleur eft un beau blanc / marque
de taches noires, dont chaque cannelure porte huit
à dix , difpofées de maniéré que quelques-unes forment
des efpeces de lignes circulaires, cependant
peu régulières.
Celui de la fig. 7 , de la même planche, eft plus ,
rare; il a à-peu-près la même longueur, 6c pref-
qu’une fois moins de largeur. Ses fpires font plus
renflées ; fur un fond couleur de rofe, il a une vingtaine
de bandes noires longitudinales, ondoyantes.
Celui de la figure 8 eft aufli rare 6c d’une forme
plus raccourcie;il a à peine moitié autant de longueur
que de largeur. Le fond de fa couleur eft gris de lin
tendre, femé de taches brunes fur fon fommet, 6c de
nombre de petits traits bruns qui forment une trentaine
de lignes circulaires autour de fa première
fpire. \ , . - * >
Le cornet, delà figure 14 , eft alongé dans la même
proportion que celui de la figure y , c’eft-à-dire, qu’il
a à-peu-près une fois autant de longueur que de largeur.
Son fond eft blanc, entouré de trois larges
bandes circulaires , brun-violet, entre lefquelles
font des lignes circulaires, couleur d’o r , & des traits
bruns , ondés en zigzags, qui réunifient les bandes
les unes aux autres.
Ces .quatre efpeces de cornets viennent de la mer
des Indes. ( M. A d a n s o n . )
CORNET a bo u q u in ., f. m.,(Lutherie. ) efpece
de longue trompette, faite d’écorce d’arbre , dont
les bergers Suiffes fe fervent beaucoup dans les
montagnes. Voyeç la fig. 10 , planche I , de Lutherie ,
dans ce Suppl. ( F. D . C. )
§ CORNOUILLER, ( Bot.')en Latin cornus, en
Anglois cornelian-cherry, en Allemand corndbaum.
Caractère générique.
Les fleurs ont quatre pétales, qui s’appuient fur
un embryon , furmonté d’un ftyle délié , 6c entoure
de quatre étamines droites ; elles font réunies en un
nombre plus ou moins grand, fuivant les efpeces ,
& attachées, tantôt aux côtés, tantôt au bout des
branches : l’embryon devient une baie , ou oblon-
gue , ou arrondie, qui renferme un noyau offeux ,
divifé en deux loges , contenant chacune une
amande.
Efpeces, Section, première.
Cornouillers 9 proprement dits : ils portent leurs
fleurs en petites ombelles, aux côtés des branchés:
leur fruit eft oblong.
1. Cornouiller, arbre, à fleurs affifes & latérales,
à feuilles oppofées 6c à fruit oblong. Cornouiller
mâle.
Cornus arbore a y fioribus fejjilibus lateralibus, 'foliis ‘
oppofitis , fructu oblongo. Hort. Col. Cornus arborea ,
umbellis involucrum oequantibus. Hort. Cliff.
Male cornel, or cornelian cherry-tree.
Variétés de cette efpece.
«t. Cornouiller à gros fruit, en Provence, acurnier.
fi. Cornouiller à fruit blanc.
y. Cornouiller à fruit citrin.
l-. Cornouiller à feuilles bordées de jaune»
Je n’ai jamais pu me procurer la variété?- , auroit-
elle été tranferite , fans examen , d’après Gafpard
Bauhin, 6c ne fe trouveroit- elle que dans les livres?
2. Cornouiller, arbre, dont T’enveloppe des Ombelles
eft très-large, 6c compofée de feuilles figu-*
rées en coeur renverfé, n°. 6 de M. Duhamel, /z9. 3
de Miller.
Cornus arborea involucro maximo, folïis obversl
cordatis. Hort. Cliff.
Male Virginia dog-wood.
Section I I .
Cornouillers fanguins, ils portent'leurs fleurs en
ombelle régulière au bout des branches ; leur fruit
eft arrondi ; l’écorce des bourgeons tire plus ou
moins fur le rouge.
1. Cornouiller fanguin à feuilles Oppofées , ovale-
arrondies , vertes des deux côtés, 6c à pédicules
courts. .
Sanguin commun.
Cornus folïis oppofitis ovato-oblohgis , pediculis
brevibus utrinque viridibus. Hort. Col. Cornus arborea
cytnis nudis. Linn. <\p. pl.
Female dog-wood. /
N. B. On en a une variété à feuilles bordées de
blanc.
2. Cornouiller fanguin à feuilles alternes très-larges
, à longs pédicules pepdans.
Cornus folïis alternis ampliffimis , pediculis làngts
, pendentibus. Hort. Col. Cornus foliis citri angufiiori-
bus , 72°. i l , de M. Duhamel.
3. Cornouiller fan'guin à feuilles larges oblong-
ovales , blanchâtres par-deflous 6c à fruit blanc.
Sanguin du Canada.
Cornus arborea foliis oblongo-ovatis, nervofis in-
\ feme albis , fioribus corymbpfis terminalibus. Mill.
Cornus foliis amplis , oblongo-ovatis , fubtus albi-
cantibus fructu albo. Hort. Colomb.
White tartarian dog-wood with a white fruit.
4. Cornouiller fanguin à feuilles étroites, figurées
en lances, vertes des deux côtés , 6c dont les nervures
de deffous font rougeâtres.
Cornus folïis angufiis , lanceolatis , utrinque viridibus
, nervis infra rubefeentibus. Hort. Colomb.
Cornus arborea foliis lanceolatis, acutis , nervojis, )
fioribus corymbofis terminalibus. Mill.
Female Virginia dog-wood with a narrower leaf ;
arrow wood.
Cette efpece ne fe trouve pas dans le traité des
arbres 6c arbuftes de M. Duhamel ; & la phrafe de
Miller n’a pas affez de rapport avec la nôtre pour
nous convaincre entièrement qù’elle repréfente la
même efpece. *
5. Cornouiller fanguin d’Amérique à feuilles
très-blanches.
Cornus feemina candidijfimis foliis Americana. Pl.uk.
n°. 10 de M. Duhamel : cette efpece ne fe trouve
pas dans Miller , 6c nous ne l’avons jamais vue.
6. Cornouiller herbacé à deux tiges.
. Cornus,herbacea ramis binis. Flor. Lapp. Cornus her~
bacea ramis nullis. Amoen. Acad.
Low. herbaceous dog-wood called ■ dwarf honey-
fuckle. ■ :
. Dès la fin de l’été, le cornouiller, 720. /, a fes petits
crochets latéraux terminés par des boutons fphérot-
des 6c pointus , recouverts par quatre feuilles reunies
, qui s’ouvrent 6c s’étendent dès la mi-février:
à cette époque on en voitfortir nombre de petits
boutons à fleurs, de couleur citrine, grouppés fur
un filet, commun : ilsVépànouiflent à la fin de février
, & les fleurs durent ou fe fuccedent jufqu’à la
mi-avril; l’arbre en eft tout jaune.
Alors le cornouiller plaît finguliérement à la vue ;
ca r, à la fin de l’hiver , les fens fortifiés par le repos
6c aiguifés par la privation, faififfent avec un vif
empreffement
emprefiement les premiers fouris de la nature renaif-
fante : il convient donc de dévouer cet arbre aux
bofquets oîi l’on veut réunir les effets les plus précoces
de la feve aftive, afin d’y mieux goûter des
inftans fi defirés (Voy. Y art. Bosquet, Suppl.). Comme
cet arbre eft très-rameux, on lui fait prendre facilement
telle figure qu’il plaît d’imaginer : il s’élève
en pilaftre, en cintre, en pyramide, en paliffades ,
& le cifeau ne diminue que très-peu le nombre de
fes fleurs , qui fe réfugient dans le centre des touffes
: fa fobriété difpenfera de le tailler plus d’une
fois dans le cours de l’été , ce qui eft un fingulier
avantage : un autre non moins grand, c’eft qu’il
réuflit très-bien à l’ombre des autres arbres 6c ar-
brifieaux : on en peut tapiffer des murs que le foleil
n’éclaire jamais, 6c oit l’air même ne circule qu’avec
peine.
Dans les bofquets d’é té , on fe procurera une décoration
agréable, en entremêlant avec entente le
cornouiller à feuilles panachées , parmi les autres
variétés de cette efpece chargées de fruits
brillans 6c glacés : le blanc, le rouge, le jaune & le
pourpre oblcur dont ils fe peignent, feront un émail
très-gracieux : de plus les oifeaux en font friands ;
ces fruits les attireront en fou le, & ce n’eft pas un
foible attrait pour l’amant de la nature ; car les
oifeaux 6c les zéphirs font l’ame & la voix du
feuillage.
A l’égard de la qualité de ce fruit, tant qu’il eft
dur , il eft d’un aftringent infupportable ; en mûrif-
fant il s’amollit; alors un acerbe fe tempere par'un
goût douçâtre : dans cet état il peut ne pas déplaire
à des palais peu délicats, ou à des goûts capricieux ;
on en fait d’affez bonnes tartes 6c des confitures acidulés
, analogues à celles d’épine-vinette ; les blancs
6c les jaunes font les plus doux : ceux de l’acurnier
ou cornouiller de Provence, méritent par leur grof-
feur qu’on cultive de préférence, au rang des fruitiers,,
l’arbre qui les -procure ; tous mûriffent en
août, & fe mangent encore en feptembre. Il faut les
femer dès qu’ils font mûrs ; mais malgré cette attention
, fouvent les plantules ne fe montrent que la
fécondé année; on peut aufli multiplier cet arbre par
les boutures 6c les marcottes ; celles-ci s’enracineront
très-vîte..
Soit en enté, foit en écuffon, toutes les variétés
du cornouiller, n°. 1 , fe greffent très-bien fur l’efpece
la plus (commune ; on les inocule depuis la fin de
juillet jufques vers la fin d’août, c’eft-à-dire, depuis
l’inftant ofi les branches de l’année ont pris à-peu-
près leur groffeur, 6c ont acquis quelque confiftan-
ç e , jufqu’au moment oîi la feve fe ralentit : comme
les boutons y font oppofés deux à deux ; il n’en faut
enlever que l’un des deux , afin de pouvoir confer-
ver à l’entour un plus grand morceau de l’écorce ;
elle eft extrêmement fine, ce qui rend cet écuffon
très-difficile à détacher , à manier & à placer : cette
opération demande une main très-légere ; mais une
fois qu’elle eft bien faite, le fuccès en eft prefqu’in-
faillible.
Il ne nous a pas été poflible jufqu’à préfent de
nous procurer l’efpece n°. 2 ; fi nous l’avons rangée
dans notre première feûion, c’eft uniquement parce
que Miller lui donne l’épithete de male ; au refte le
bois de ces arbres eft le plus dur de ceux qui croif-
fent en Europe ; fans doute qu’il feroit précieux pour
nombre d’ufages , on en fait des manches d’outils
excellens. Il eft fâcheux que les cornouillers croiffent
fi lentement, 6c que la nature les ait reftreints à une
taille fi médiocre ; ils peuvent tout au plus figurer
parmi les arbres de la quatrième grandeur.
Le fanguin n°. 1 , habite les bois & les haies dans'
l’Europe occidentale & feptentrionale ; c’eft un ar-
brifleau du premier ordre , ou bien un arbre du
Tome I I .
cinquième : livré à fon naturel, il s*é.îeve fur Un petit
nombre de verges droites 6c convergentes » à la hauteur
de dix pieds, mais il eft aifé de lui former une
tige unique très-élégante ; alors je ne doute pas que
dans un bon fol il ne puiffe, à l’aide de quelque
culture, atteindre à la hauteur d’environ dix-huit
pieds ; on le multiplie aifément par fes baies qu’iï
faut femer dès qu’elles font mûres ; par ce moyen
on obtiendra des fujets bien venans 6c moins dif-
pofés à tracer 6c à buiffonner du pied que ceux provenus
des éclats 6c des furgeons, qu’on trouva
communément dans les bois autour des groffea
cépées.
Cet arbriffeau, pour être commun, n’eiî eft pas
moins propre à la décoration des bofquets ; il doit
entrer dans la compofition de ceux de juin, oii fa
haute ftature lui affigne une-place dans les fonds &
fur les derrières des maflifs : on voit dans cette faifon
les bouts de tous ces rameaux s’épanouir en une
ombelle blanche d’un fort bel effet ; fon feuillage eft
agréable, fon port régulier, fon écorce polie 6c
jafpée dans le vieux bois, luifante , rouge 6c rayée
dans les branches nouvelles. Il eft rare qu’il ne fleu-
riffe pas une fécondé fois en oûobre, ainfi l’on doit
en jetter quelques pieds dans les bofquets d’autom^
ne : fa variété à feuilles bordées de blanc doit
trouver place dans les bofquets d’été. Les ombelles
de fes baies ne contribuent guere à l’ornement, 6c
ne font pas de la moindre utilité ; leur violet-verdâtre
& terne n’attire point les regards ; & les oifeaux
ne les mangent qu’au défaut de tout autre
aliment.
Les branches moyennes de ce fanguin font ex*
trêmement fouples 6c très-propres à former ces cerf
des élaftiques, appellés fauterelleS, avec quoi l’on
prend, dans le pays Meflin 6c le Verdunois , ce
nombre prodigieux de rouge-gorges qu’on y con-
fomme 6c même qu’on en exporte. Son bois eft très-
dur & fait une belle flamme, 6c de fort bon charbon >
ainfi il ne faut pas le regarder comme ufurpant une
place dans les taillis : comme il vient dans les plus
mauvais fonds , peut-être yauroit-il quelque avan-«
tage à en garnir descôteauxarides,oiide meilleures
efpeces ne réufliroient point.
Le fanguin n9. 2 , paroît ne pas devoir le céder
en hauteur au précédent ; fes feuilles alternes &
attachées par des pédicules longs 6c pendans, font
très-larges, terminées en longue pointe penchée ,
d’un verd brillant par-deffus, ÔC d’un glauque blanchâtre
par-deffous ; fon écorce eft du plus beau poli ;
fur le bois ancien elle eft ftriée de blanc ; dans le bois
moyen elle eft verdâtre ; fur les jeunes rameaux ,
ellè fe peint d’un beau violet : il pouffe une fléché
affez droite, mais fes branches s’étendent très-horizontalement
: c’eft au mois de mai que fe déploie
l’ombelle qui les termine , & qui fe releve comme
la bobeche d’un chandelier à bras ; cette ombelle eft
large 6c peu ferrée ; les fleurs qui la compofent font
affez grandes, 6c portent quatre pétales blancs
longs 6c étroits qui tombent au bout de quelques
jours , elles font remplacées par des baies violettes.
Cet arbriffeau fe multiplie aifément de marcottes,
6c s’écuffonne très-bien fur le fanguin de Canada ,
qui eft l’efpece luivante, c’eft-à-dire, notre n°. 3. .
Celui-ci diffère du précédent, en ce que fes feuilles
font oppofées , moins larges 6c un peu plus blanches
par-deffous : elles font portées fur des pédicules
moins longs 6c moins pendans , & leur pointe
n’eft pas tournée de côté. Les ombelles font moins
amples, les fleurs en font plus petites , elles s’épa-
nouiffent quinze jours plus tard : les baies qui leur
fuccedent font d’u« blanc tranfparent ; dans le tems
de la plus grande aâivité de la feve l’écorce du-
jeune bois eft verte, mais en hiver elle eft d’un
HHhh