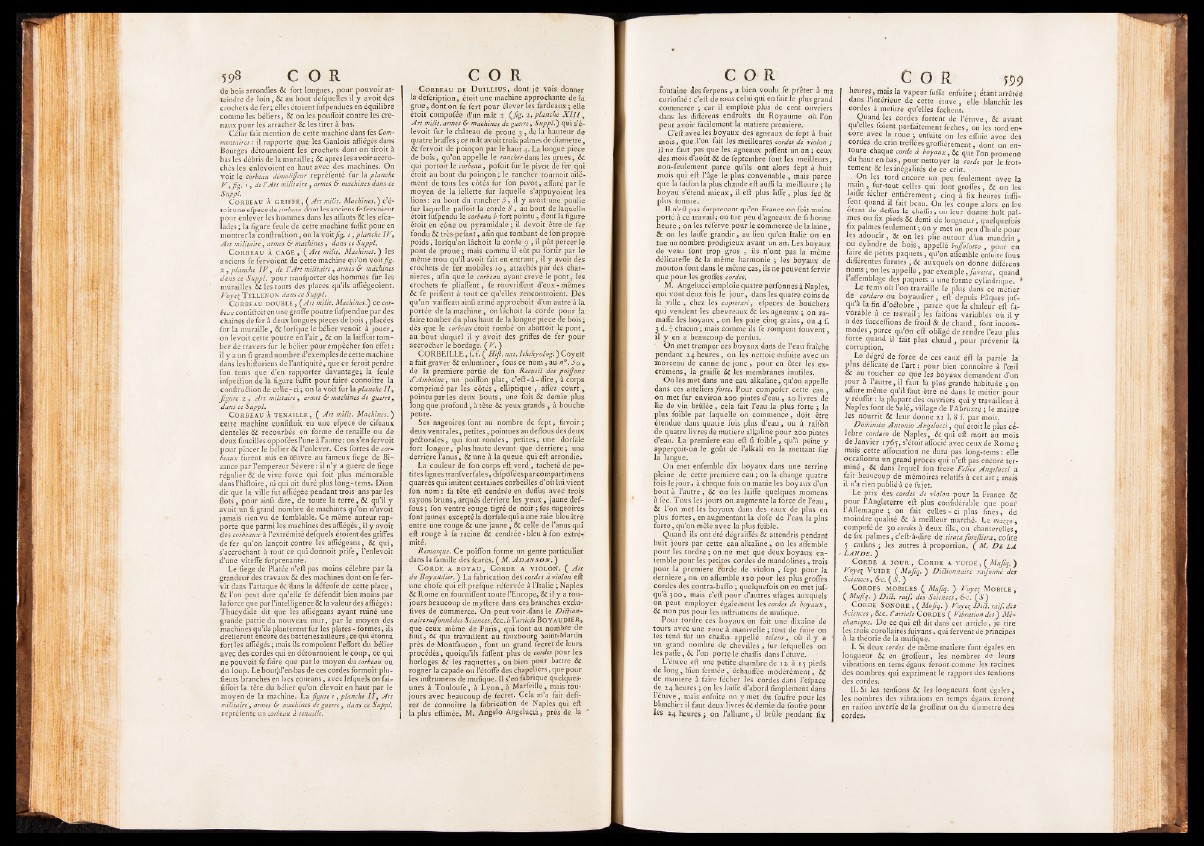
P
de bois arrondies & fort longues, pour pouvoir atteindre
de loin, & au bout defquelles il y avoit des
crochets de fer; ellesétoient fufpendues en équilibre
comme les béliers, & on les pouffoit contre les cre-
naux pour les arracher 8c les tirer à bas.
Célar fait mention de cette machine dans fes Commentaires
: il rapporte que les Gaulois affiégés dans
Bourges détournoient les crochets dont on tiroit à
bas les débris de là muraille ; & après les avoir accrochés
les enlevoient en haut avec des machines. On
voit le corbeau démolijjeur repréfenté fur la planche
V 9fig. 1, de l'Art militaire , armes & machines dans ce
Suppl.
‘ Corbeau à g riffe, ( Artmilit. Machines.') c’é-
toit une efpece de corbeau dont les anciens fe fervoient
pour enlever les hommes dans les affaùts & les efca-
lades ; la figure feule de cette machine fuffit pour en
montrer la conftruûion, on la voit fig, 1 , planche IV ,
Art militaire, armes & machines , dans ce Suppl.
CO R B E AU À C A G E , ( Art milit. Machines. ) les
anciens fe fervoient de cette machine qu’on voitfig.
2. , planche IV , de l'Art militaire , armes & mdchines
dans ce Suppl..pour tranfporter des hommes fur les
murailles & les tours des places qu’ils affiégeoient.
Voyei T ELLENON dans ce Suppl.
Corbeau DOUBLE, (Art milit. Machines.) ce corbeau
confiftoit en une grofl’e poutre fufpendue par des
chaînes de fer à deux longues pièces de bois, placées
fur la muraille, & lorfque le bélier venoi't à jouer,
on levoit cette poutre en l’air, 8c on la laiffoit tomber
de travers fur le bélier pour empêcher fon effet :
il y a un fi grand nombre d’exemples de cette machine
dans les hiftoriens de l’antiquité, que ce feroit perdre
fon tems que d’en rapporter davantage; la feule
infpeftion de la figure fuffit pour faire connoître la
conftruftion de celle - ci ; on la voit fur la planche II ,
figure 2 , Art militaire, armes & machines de guerre ,
dans ce Suppl.
Corbeau k tenaille, ( Art milit. Machines. )
cette machine confiftoit en une efpecê de cifeaux
dentelés 8c recourbés en forme de tenaille bu de
deux faucilles oppofées l’une à l’autre : on s’en fervoit
pour pincer le bélier 8c l’enlever. Ces fortes de corbeaux
furent mis en oeuvre au fameux fiege de Bi-
zance par l’empereur Sévere : il n’y a guere de fiege
régulier 8c de vive force qui foit plus mémorable
dans l’hiftoire, ni qui ait duré plus long-tems. Dion
dit que la ville fut afîlégce pendant trois ans par les
flots, pour ainfi dire, de toute la terre, & qu’il y
avoit un fi grand nombre de machines qu’on n’avoit
jamais rien vu de femblable. Ce même auteur rapporte
que parmi les machines des affiégés, il y avoit
des corbeaux à l’eitrémité defquels étoient des griffes
de fer qu’on lançoit contre les affiégeans, & qui,
s’accrochant à tout ce quidorinoit prife, l’enlevoit
d’une vîteffe fur prenante.
Le fiege de Platée ri’ eft pas moins célébré par la
grandeur des travaux 8c des machines dont on fe fer-
vit dans l’attaque &'dans la défenfe de cette place ,
& l’on peut dire qu’elle fe défendit bien moins par
la force que par l’intelligence & la valeur des affiégés:
Thucydide dit que les affiégeans ayant ruiné une
grande partie du nouveau mur, par le moyen des
machines qu’ils plantèrent fur les plates - formes, ils
drefferent encore des batteries ailleurs, ce qui étonna
fort les affiégés ; mais ils rompoient l’effort du bélier
avec des cordes qui en détournoient le coup, ce qui
ne pouvoit fe faire que par le moyen du corbeau ou
du loup. Le boutjd’en-bas de ces cordes formoit plu-
fieurs branches en lacs courans, avec Iefquels on fai-
fiffoit la tête du bélier qu’on élevoit en haut par le
moyen de la machine. La figure 1 , planche I I , Art
militaire, armes & machines de guerre, dans ce Suppl.
repréfente un corbeau à tenaille.
Corbeau de D uillius, dont je vais donner
la defçription, étoit une machine approchante de la
grue, dont on fe fert pour élever les fardeaux; elle
étoit compofée d’un mât 2 (fig- 2.. planche X I I I y
Art milit. armes & machines de guerre, Suppl.) qui s’é-
levoit fur le château de proue 3 , de la hauteur de
quatre braffes ; ce mât avoit trois palmes de diamètre,
8c fervoit de poinçon par le haut 4. La longue piece
de bois, qu’on appelle le rancher dans les grues, 8c
qui portoit le corbeau, pofoit fur le pivot de fer qui
étoit au bout du poinçon ; le rancher tournoit aifé-
mënt de tous les côtés fur fon pivot, affuré par le
moyen de la fellette fur laquelle s’appuyoient les
lions : au bout du rancher 5 , il y avoit une poulie
fur laquelle paflbit la corde 8 , au bout de laquelle
étoit fufpendu le corbeau b fort pointu, dont la figure
étoit en cône ou pyramidale ; il devoit être de fer
fondu & très-pefant, afin que tombant de fon propre
poids , ’lorfqu’on lâchoit la corde 3), il pût percer lé
pont de proue ; mais comme il eût pu fortir par le
même trou qu’il avoit fait en entrant, il y avoit des
crochets de fer mobiles 10, attachés par des charnières,
afin que le corbeau ayant crevé le pont, les
crochets fe pliaffent, fe rouvriffent d’eux - mêmes
8c fe priffent à tout ce qu’elles rencontroient. Dès
qu’un vaiffeau ainfi armé approchoit d’un autre à la
portée de la machine , on lâchoit la corde pour la
faire tomber du plus haut de la longue piece de bois ;
dès que le corbeau étoit tombé on abattoit le pont,
au bout duquel il y avoit des griffes de fer poür
accrocher le bbrdage. ( V. )
CORBEILLE, f. f. ( Hift. nat. Ichthyolog. ) C oyett
a fait graver 8c enluminer, fous ce nom, au n°. So ,
de la première partie de fon Recueil des poijfons
d'Amboine, un poiffon plat, c’e ft-à -d ire , à corps
comprimé par les côtés , elliptique , affez court ,
pointu paries deux bouts, une fois 8c demie plus
long que profond, à tête 8c yeux grands , à bouche
petite.
Ses nageoires font au nombre de fept, fa voir ;
deux ventrales, petites, pointues au deffous des deux
pe&orales, qui font rondes, petites, une dorfale
Fort longue, plus haute devant que derrière; une
derrière l’anus, & une à la queue qui eft arrondie.
La couleur de fon corps eft v erd , tacheté de petites
lignes tranfverfales, difpoféespar compartimens
quarrés qui imitent certaines corbeilles d’où lui vient
fon nom: fa tête eft cendrée en deffus avec trois
rayons bruns, arqués derrière les y e u x , jaune deffous
; fon ventre rouge, tigré de noir ; fes nageoires
font jaunes excepté la dorfale qui a une raie bleuâtre
entre une rouge 8c une jaune, 8c celle de l’anus qui
eft rouge à fa racine 8c cendrée-bleu à fon extré-^
mité.
Remarque. Ce poiffon forme un genre particulier
dans la famille des fcares. ( M. A d a n s o n . )
Corde a boyau, Corde a violon. ( Art
du Boyaudier. ) La fabrication des cordes à violon eft
une chofe qui eft prefque réfervée à l’Italie ; Naples
& Rome en fourniffent toute l’Europe, & i l y a toujours
beaucoup de myftere dans ces branches exclu-
fives de commerce. On peut voir .dans le Dictionnaire
raifonnédes Sciences,Si.c. à l’article BOYAUDIER,
que ceux même de Paris, qui font au nombre de
huit, 8c qui travaillent au fauxbourg Saint-Martin
près de Montfaucon, font un grand fecret de leurs
procédés, quoiqu’ils faffent plus de cordes pour les
norloges & les raquettes, ou bien pour battre &
rogner la capade ou l’étoffe des chapeliers, que pour
les inftrumens de mufique. Il s’en fabrique quelques-
unes à Touloufe, à Lyon , à Marfeille, mais toujours
avec beaucoup de fecret. Cela nï*a fait defi-
rer de connoître la fabrication de Naples qui eft
la plus eftimée. M. Angelo Angeluçci, près de la ‘
Fontaine dèsferpèns » a bien voulu fë prêter à ma
curiofité : c’eft de tous celui qui en fait le plus grand
commerce ; car il emploie plus de cent ouvriers
dans les différens endroits du Royaume où l’on
peut avoir facilement la matière première.
C’eft avec les boyaux des agneaux de fept à huit
mois, que..l’on fait les meilleures cordes de violon ;
il ne faut pas que les agneaux paffent un an ; ceux
des mois d’août & de feptembre font les meilleurs *
non-feulement parce qu’ils;, font alors fept à huit
mois qui eft l’âge le plus convenable, mais parce
que la faifon la plus chaude eft auffi.la meilleure ; le
boyau s’étend mieux, il eft plus liffe, plus fec 8c
plus fonore.
Il n’eft pas furprenant qu’en France on foit moins
porté à ce travail ; on tue peu d’agneaux de fi bonne
heure ; on les réferve pour le commerce de la laine
& on les laiffe grandir, au lieu qu’en Italie on en
tue un nombre prodigieux avant un an. Les boyaux
de veau font trop gros , ils n’ont pas la même
délicateffe 8c la même harmonie ; les boyaux de
mouton font dans le même cas, ils ne peuvent fervir
que pour les groffes cordes.
M. Angelucci emploie quatre perfonnes à Naples,
qui vont deux fois le jour, dans les quatre coins de
la ville , chez les capretari, efpeces de bouchers
qui vendent les chevreaux 8c les agneaux ; on ra-r
maffe les boyaux , on les paie cinq grains, ou 4 f.
2 d. £ chacun ; mais comme ils fe rompent fouvent,
ïl y en a beaucoup de perdus.
On met tremper ces boyaux dans de l’eau fraîche
pendant 2 4 heures, on les nettoie enfuite avec un
inorceau de canne de jon c , pour en ôter les ex-
crémens, la graiffe 8c les membranes inutiles.
.On les met dans une eau alkaline, qu’on appelle
dans ces atteliersforte. Pour compofer cette eau,
on met fur environ 200 pintes d’eau , 20 livres de
lie de vin brûlée, cela fait l’eau la plus forte ; la
plus foible par laquelle on commence, doit être
étendue dans quatre fois plus d’eau, ou à raifon
de quatre livres de matière alkaline pour 200 pintes
d’eau. La première eau eft fi foible, qu’à peine y
, apperçoit-on le goût de l’alkali en la mettant fur
la langue.
On met enfemble dix boyaux dans une terrine
pleine de cette première eau ; on la -change quatre
Fois le jour, à chaque fois on manie les boyaux d’un
bout à l’autre, 8c on lès laiffe quelques momens
à fec. Tous les jours on augmente la force dé l’eau,
& l’on met les boyaux dans des eaux de plus en
plus fortes, en augmentant la dofé de l’eau la plus
Forte, qu’on mêle avec la plus foible.
Quand ils ont été dégraiffés 8c attendris pendant
huit jours par cette eau alkaline, on les affemble
pour les tordre ; on ne met que deux boyaux enfemble
pour les petites cordes de mandolines, trois
pour la première «rorde.de violon , fept pour la
derniere , on en affemble 120 pouf les plus groffes
cordes des contra-baffo ; quelquefois on en met juf-
qu’à 300, mais c’eft pour d’autres ufages auxquels
on peut employer également les cordes de boyaux,
& non pas pour les inftrumens de mufique.
Pour tordre ces boyaux on fait une dixaine de
tours avec une roue à manivelle ; tout de fuite on
les tend fur un chaffis appellé telaro, où il y a '
un grand nombre de chevilles , fur lefquelles on
les paffe, & l’on porte le chaffis dans l’étuve.
L’étuve eft une petite chambre de 12 à ,x ç pieds
de long , bien fermée , échauffée modérément, 8c
de maniéré à faire fécher les cordes dans l’efpace I
de 24 heures ; on les laiffe d’abord Amplement dans
l’étuve, mais enfuite on y met du foufre pour les
blanchir: il faut deux livres 8c demie de foufre pour
les 24 heures j on l’alliune, il brûle pendant fix
heures , niais la vapeur fuffit enfuite ; étant àr'rêtéé
dans l’intérieur de cette étuve, elle blanchit les
cordes à mefure qu’elles fechent;
Quand les cordés fortent de l’étuVe ; & àVanÉ
quelles foient parfaitement feehes, on les tord en**
eore avec la roue ; enfuite on les effuie avec des
cordes de crin treffées groffiérement, dont on en**
toure chaque corde à boyaux, 8c que l’on promene
du haut en bas, pour nettoyer la corde par le frottement
8c les inégalités de ce crin.
Gn les tord encore un peu feulement avec la
main , fur-tout celles qui font groffes, & on les
laiffe féchef entièrement ; cinq à fix heures fuffi-
fent quand il fait beau. On les coupe alors en les
Otant de deffus le chaffis, on leur donne huit palmes
Ou fix pieds 8c demi de longueur, quelquefois
fix palmes feulement ; on y met un peu d’huile pour
les adoucir, & on les plie autour d’ün mandrin,
où cylindre de bois, appelle buffolotto , pouf en
dé petits paquets, qu’on affemble enfuite fous
differentes formes , & auxquels on dortnë différens
noms ; on les appelle , par exeiftple,favetta, quand
1 affemblage des paquets a une fornie cylindrique. *
Le tems où l’on travaille le plus dans ce métier
^e> co^ aro c,u boyaudief, eft depuis Pâques juf—
qu’à la fin d’o&obre , parce que là chaleur eft favorable
à ce travail les faifons variables où il y
a des fucceffions de froid & de chaud, font incommodes
, parce qu’on eft obligé de rendre l’eau plus
forte quand il fait plus chaud , pour prévenir là
corruption.
Le degré de force de ces eàux éft la partie la
plus délicate de l’art : pour bien connoître à l’oeil
& au toucher ce que les boyaux demandent d’un
jour à l’autre, il faut la plus grande habitude ; on
affure même qu’il faut être né dans le métier pour
y réuffir : la plupart des ouvriers qui y travaillent à
Naples font de Sale, village de l’Abruzze ; le maître
les nourrit & leur donne 21 1. 8 f. par mois;
Dominico Antonio Angelucci, qui étoit le plus célébré
cordaro de Naples, 8c qui eft mort au mois
de Janvier 1765, s’étoit affocié avec ceux de Rome ;
mais cette affociatiôrt ne dura pas long-tems : elle
occafionna un grand procès qui n’eft pas encore terminé
, & dans lequel fon frere Felice Angelucci à
fait beaucoup de mémoires relatifs à cet art; mais
il n’a rien publié à ce fiijet.
Le prix des cordes de yiàlon pour la France &
pour 1 Angleterre eft plus confidérable que pouf
l’Allemagne ; on fait c e lle s -c i plus fines, dé
moindre qualité 8c à meilleur marché. Le ma^p,
compoféde 30 cordes à deux fils, ou chanterelles,
de fix palmes, c’eft-à-dire de tirata forejliera, coûte
5 carlins; les autres à proportion. ( M. D e l à
* L a n d e . )
Corde a jour , Corde a vuide , ( Mufiq, )
Vyye{ VuiDE ( Mufiq. ) Dictionnaire raifonné des
Sciences, &c. ( i 1. )
Cordes mobiles ( Mufiq. ) Voye{ Mobile j'
( Mufiq. ) Dici. raif. des Sciences, &c. ( 5 )
Corde Sonore , ( Mufiq. ) Voye^ Dict. raif. des
Sciences , &c. l'article CORDES ( Vibration des) Mé-
chanique. De ce qui eft dit dans cet article, je tire
les trois corollaires fuivans, qui fervent de principes
à la théorie de la mufique.
I. Si deux cordes de même matière font égales en
longueur & en groffeur , les nombres de leurs
vibrations en tems égaux feront comme les racines
des nombres qui expriment le rapport des tenfions
des cordes.
. II. Si les tenfions & le $ longueurs font égales,
les nombres des vibrations en temps égaux feront
en raifon inverfe delà groffeur ou du diamètre des
cordes.