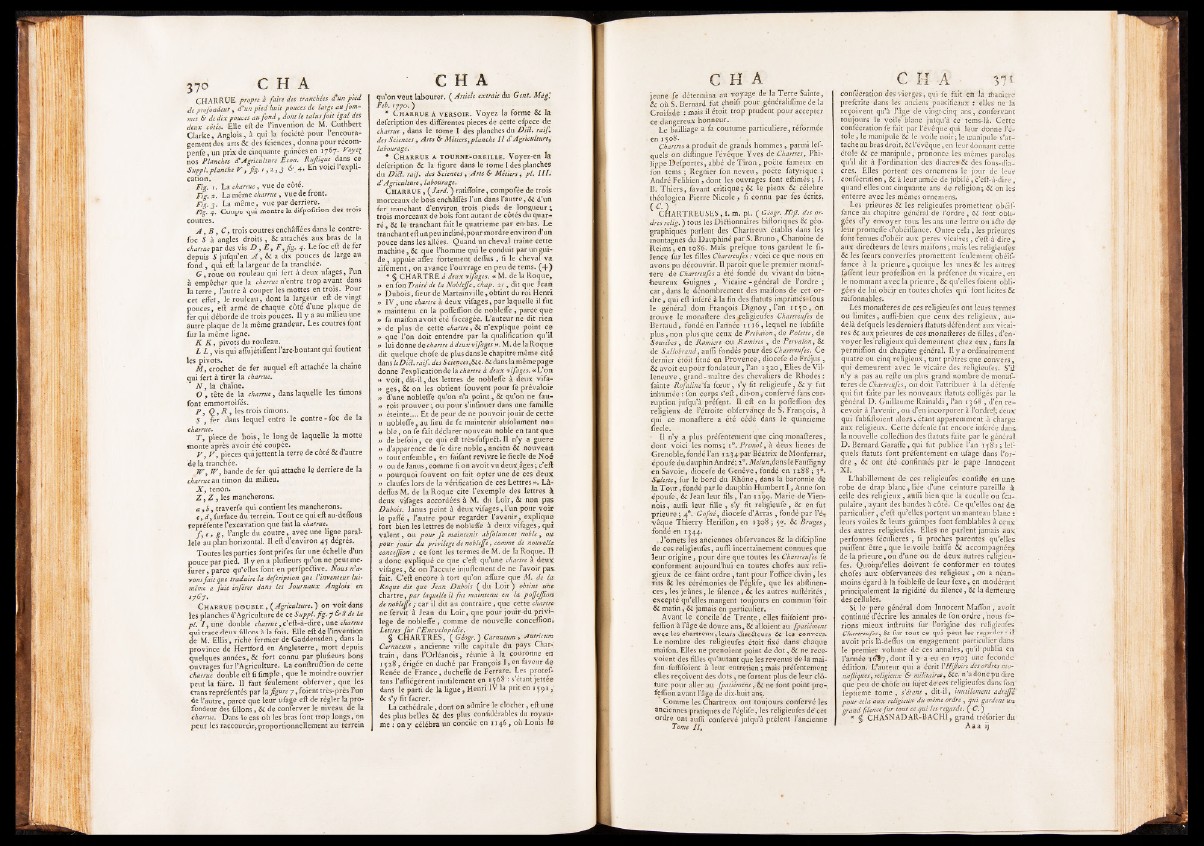
CHARRUE propre à faire des tranchées <tun pied
de profondeur , d'un pied huit pôucesde large aufom-
met & de dix pouces au fond, dont le talusfoit égal des
deux côtés. Elle eft de l’invention de M. Cuthbert
Clarke, Anglois, à qui la fociété pour l’eneoura-
gement des arts & des fciences, donna pour recom-
penfe, un prix de cinquante guinées en 1767. Voye^
nos Planches d?Agriculture Econ. Rufiique dans ce
Suppl, planche V , fig. 1 , 2 , 3 ^*n v0*c* ^ exP^“
cation. \ ,
Fig. 1. La charrue, vue de cote.
Fig. z. La même charrue , vue de front.
Fig. g. La même, vue par derrière.
Fig. 4. Coupe qui montre la difpofition des trois
coutres.
A , B , C , trois coutresenchâffées dans le contre-
foc S à angles droits, & attachés aux bras de la
charrue par des vis D , E , F,fig. 4. Le foc eft de fer
depuis S jufqu’en A , & a dix pouces de large au
fon d, qui eft la largeur de la tranchée.
G y roue ou rouleau qui fert à deux ufages , 1 un
à empêcher que la charrue n’entre trop avant dans
la terre, l’autre à couper les mottes en trois. Pour
cet effet, le rouleau, dont la.largeur eft de vingt
pouces, eft armé de chaque côté d’une plaque de
fer qui déborde de trois pouces. Il y a au milieu une
autre plaque de la même grandeur. Les coutres font
fur la même ligne.
K K y pivots du rouleau.
L L , y is qui affujétiffent l’arc-boutant qüi foutient
les pivots.
M , crochet de fer auquel eft attachée la chaîne
qui fert à tirer la charrue.
N , la chaîne.
O , tête de la charrue, dans laquelle les timons
font emmortoifés.
P , Q y R , les trois timons.
S fer dans lequel entre le contre - foc de la
charrue.
T y piece de bois, le long de laquelle la motte
monte après avoir été coupée.
V , V , pièces qui jettent la terre de côté & d’autre
de la tranchée. . . . - , ,
TT, W , bande de fer qui attache le derrière de la
charrue au timon du milieu.
X , tenon.
Z , Z , les mancherons.
a ,b , traverfe qui contient les mancherons.
c, d, furface du terrein. Tout ce qüi eft au-deffous
repréfente l’excavation que fait la charrue.
f , e , g , l’angle du coutre, avec une ligne parallèle
au plan horizontal. Il eft d’environ 45 dégrés.
Toutes les parties fontprifes fur une échelle d’un
pouce par pied. Il y en a plufieurs qu’on ne peut me-
iurer, parce qu’elles font en perfpe&ive. Nous n'ayons
fait que traduire la defcription que l'inventeur lui-
même a fait inferer dans les Journaux Anglois en
sy6y.
C harrue double , ( Agriculture. ) on voit dans
les planches d’Agriculture de ce Suppl. fig. y & 8 de la
pl. 7 ,un e double charrue,c’eft-à-dire, une charrue
qui trace deux filions à la fois. Elle eft de l’invention
de M. Ellis, richè fermier de Gaddensden, dans la
province de Hertford en Angleterre, mort depuis
quelques années, & fort connu par plufieurs bons
ouvrages fur rAgriculture. La conftru&ion de cette
charrue double eft fi fimple, que le moindre ouvrier
peut la taire. Il faut feulement obferver, que les
crans repréfentés par la figure y , foient très-près l’un
de l’autre, parce que leur ufage eft de regler la profondeur
des filions, & de conferver le niveau de la
charrue. Dans le cas oh les bras font trop longs, on
peut les raccourcir, proportionnellement au terrein
qu*ôn veut labourer. £ Article extrait du Gent. Mdg1
Feb. #770. )
* C harrue à versoîr. Voyez la forme & la
defcription des différentes pièces de cette efpece de
charrue y dans le tome I des planches du Dicl. raif.
des Sciences, Arts & Métiers, planche I I d'Agriculture^
labourage.
* C harrue a tourne-oreille. Vôyez-en la
defcription & la figure dans le tome I des planches
du Dicl. raif. des Sciences ÿ \Arts & Métiers, pl. I I I •
d'Agriculture, labourage.
C harrue , ( Jard. ) ratiffoire, compofée de trois
morceaux de bois enchâffés l’un dans l’autre, & d’un
fer tranchant d’environ trois pieds de longueur ;
trois morceaux de bois font autant de côtés du quar-
r é , & le tranchant fait le quatrième par en-bas. Le
tranchant eft un peu incliné,pour mordre environ d’un
pouce dans les allées. Quand un cheval traîne cette
machine, & que l’homme qui le conduit par un guide
, appuie affez fortement deffus , fi le cheval va
aifément, on avance l’ouvrage en peu de tems. (+ )
* § CHARTRE à deux vifages. « M. de la Roque,
» en fon Traité de la Noblejfe, chap. 2 1 , dit que Jean
» Dubois, fieur de Martainville, obtint du roi Henri
» IV , une chartre à deux vifages, par laquelle il fut
» maintenu, en la poffeffion de nobleffe , parce que
» fa maifon avoit été faccagée. L’auteur ne dit rien
» de plus de cette chartre, &. n’explique point ce
» que l’on doit entendre par la qualification qu’il
» lui donne de chartre à deux vifages ». M. de la Roque
dit quelque chofe de plus dans le chapitre même cité
dans leDicl. raif. des Sciences,&cc. &dans la même page
donne l’explicationde la chartre à deux vifages-, «L’on
» v o it , dit-il, des lettres de nobleffe à deux vifa-
» ges, & on les obtient fouvent pour fe prévaloir
» d’une nobleffe qu’on n’a point, & qu’on ne fau-
» roit prouver ; ou pour s’infinuer dans une famille
» éteinte.... Et de peur de ne pouvoir jouir de cette
» nobleffe, au lieu de fe maintenir absolument no-
» b le , on fe fait déclarer nouveau noble en tant que
» de befoin, ce qui eft très-fufpeft. Il n’y a guere
» d’apparence de fe dire noble , ancien & bouveau
» tout enfemble, en faifant revivre le fiecle de Noé
» ou de Janus »comme fi on avoit vu deux âges ; c’eft
» pourquoi fouvent on fait opter une de ces deux
» claufes lors de la vérification de ces Lettres ». Là-
deffus M. de la Roque cite l’exemple des lettres à
deux vifages accordées à M. du Loir, & non pas
Dubois. Janus peint à deux vifages, l’un pour voir
le paffé , l’autre pour regarder l’avenir , expliqué
fort bien les lettres de nobleffe à deux vifages, quî
valent, ou pour fe maintenir abfolument noble, oie
pour jouir du privilège de nobleffe, comme de nouvelle
conceffion : ce font les termes de M. de la Roque. I!
a donc expliqué ce que c’eft qu’une chartre à deux
vifages, & on l’accufe injuftement de ne l’avoir pas.
fait. C ’eft encore à tort qu’on affure que M. de la
Roque dit que Jean Dubois ( du Loir ) obtint une
chartre, par laquelle il fut maintenu en la pofjejjîon
de nobleffe ; car il dit au contraire, que cette chartre
ne fervit à Jean du Loir, que pour jouir-du privilège
de nobleffe, comme de nouvelle conceffion,,'
Lettres fur l'Encyclopédie.
§ CHARTRES, ( Géogr. ) Car nutum , Autricum
Carnutum , ancienne ville capitale du pays Char-î
train, dans l’Orléanois, réunie à la couronne en
1528, érigée en duché par François I , en faveur de
Renée de France, ducheffe de Ferrare. Les protef-
tans l’affiégerent inutilement en 1568 :•Vêtant jettee
dans lè parti de la ligue, Henri IV la prit en 1591
& s’y fit facrer.
La cathédrale, dont on admire le clocher, eft une
des plus belles & des plus confidérables du royaume
; on y célébra un concile en 1146) ou Louis le
jeune fe détermina;'ait voyage dé jà Terre Sainte,
Le oh S. Bernard fut choifi pour généraliffime de la
Croifade : mais il étoit trop prudent pour accepter
ce dangereux honneur.
Le bailliage a fa coutume particulière, réformée
en 1508. - ,
Chartres a produit de grands hommes, parmi lesquels
on diftingue l’évêque Yves de Chartres, Philippe
Defportes, abbé de T iron, poëte fameux en
fon tems ; Regnier fpn neveu, poëte fatyrique ;
André Felibien, dont les ouvrages font eftimés ; J.
B. Thiers, favant critique; & le piettx & célébré
théologien Pierre Nicole, fi connu par fes écrits.
WBÊË
CHARTREUSES ,.f. m. pl. ( Géogr. Hifi. des ordres
relig. ) tous les Dictionnaires hiftoriques & géographiques
parlènt des Chartreux établis dans les
montagnes du Dauphiné par S. Bruno, Chanbine de
Reims, en 1086. Mais prefque tous gardent le fi-
ïence fur les filles Chartreufes : voici ce que nous en
avons pu découvrir. Il paroît que le premier monaftere
de Chartreufes a été fondé du vivant du bienheureux
Guignes , Vicaire - général de l’ordre ;
ca r, dans le dénombrement des maifons de cet ordre
, qui eft inféré à la fin des ftatuts imprimésafous
le général dom François Dignoy,Pan 1 150 , on
trouve le monaftere des g.eligieufes Chartreufes de
•Bertaud, fondé en l’arinée 1 1 1 6 , lequel ne fubfifte
plus, non plus qüe ceux de Prebaion, de Polette, de
Souribes, de Ramiere ou Ramires , de Pervalon, &
de Sallobrand, aufîi fondés pour des Chartreufes. Ce
dernier étôit fitué en Provence, diocefe de Fréjus ,
& avoit eu pour fondateur, l’an 13 10 , Elies de Villeneuve
, grand - maître des chevaliers de Rhodes :
fainte Rofaline'fa foeur, s’y fit religieufe, & y fut
inhumée ': fon corps s’eft, dit-on ,■ confervé fans corruption
jufqu’à p ré fe t . Il eft en la poffeffion des
religieux de l’étroite obfervânce de S. François, à
qui ce monaftere a été cédé dans le. quinzième
fiecle.
• Il n’y a plus préfentement que cinq monafteres,
dont voici les noms; i° . P remol, à deux lieues de
Grenoble, fondé l’an n34*par Beatrix deMonferrar,
époufe du dauphin André; z°. Melun,dans le Faufiigny
en Savoie, diocefe de Genève, fondé en 1288 ; 3®.
Salette, fur le bord du Rhône, dans la baronnie de
la T o u r , fondé par le dauphin Humbert I , Anne fon
époufe, & Jean leur fils, l’an 1299. Marie de Viennois
, auffi leur fille , s’.y fit religieufe, & en fut
prieure ; 40. Gofnè, diocefe d’Arras , fondé par l’é*
vêque Thierry Heriffon, en 1308 ; 55. & Bruges,
fondé en 1344.
. J’omets les anciennes obfervances & la difeipline
de ces religieufes, auffi incertainement connues que
leur origine, pour dire que toutes les Chartreufes fe
conforment aujourd’hui en toutes chofes aux religieux
3e ce faint o rdre, tant pour l’office divin, les
rits & les cérémonies de l’églife, que lés abftinen-
ce s, les jeûnes, le filence, & les autres auftérités,
excepté qu’elles mangent toujours en commun‘foir
& matin ,• & jamais en particulier.
Avant le concile*de Trente, elles faifoient pro-
feffion à l’âge de douze ans, & allaient au fpatièment
avçc les chartreux, leurs diae&eurs & les convers.
Le nombre des religieufes étoit fixé daris chaque
maifon. Elles ne prenoient point de dot, & ne rece-
voient des filles qu’autant que les revenus 'de la maifon
•fuffifoient à leur entretien ; mais préfentement
elles reçoivent des dots, ne fortent plus de leur clôture
pour aller au fpatièment ,•& ne font point pro-
feffion avant l’âge de dix-huit ans.
Comme les Chartreux ont toujours confervé les
anciennes pratiques de l’églife, les religieufes dé cet
ordre ont auffi confervé jufqu’à préfent l’ancienne
Tome ÎI,
cônfécration des vierges, qui fe fait eft la thaniere
preferite dans les anciens pontificaux : elles ne la
reçoivent qu’à l’âge de vingt-cinq ans, confervant
toujours le voilé’ blanc julqu’à ce tems-là. Cette
confécration fe fait par l’évêque qui leur donne l’é-
to le , le manipule & le voile noir; le manipule s’attache
au bras droit, & l’évêque, en leur donnant cette
étole & ce manipule, prononce les mêmes paroles
qu’il dit à l’ordination des diacre» & des fous-diacres.
Elles portent ces ornemens le jour de leur
confécration, & à leur armée de jubilé, c’eft-à-dire,
quand ellès ont cinquante ans de religion » & on les
enterre avec les mêmes ornemens; '
Les prieures & les religieüfes promettent obéif-
fance au chapitre général de l’ordre, &c font obligées
d’y envoyer tous lès ans une lettre ou àéte de
leur promefîë d’obéiflance. Outre cela , les prieures
font tenues d’obéir aux peres vicaires, c’eft-à-dire,
aux directeurs de leurs maifons ; mais les religieufes
& les foeurs converfes promettent feulement obéif-
fance à la prieure, quoique les unes & les autres'
fgffent leur profeffion en la préfence du vicaire, err
le nommant avec la prieure, & qu’elles foient obligées
de lui obéir en toutes chofes qui font licites &
raifonnables.
Les monafteres de ces religieufes ont leurs termes
ou limites, auffi-bien que ceux des religieux, âu-
delà defquels les derniers ftatuts défendent aux vicaires
& aux prieures de ces monafteres de filles, d’envoyer
les religieux qui demeurent chez eu x , fans la
permiffion du chapitre général. Il y a ordinairement
quatre ou cinq religieux, tant prêtres que convers ,
qui demeurent avec le vicaire des religieufes. S’il
n’y a pas au rejfte iin plus grand nombre de monafteres
de Chartreufes, on doit l’attribuer à la défenfe
qui fut faite par lés nouveaux ftatuts colligés par le
général D. Guillaume Rainaldi, l’an x 3 68 , d’en recevoir
à l’avenir, ou d’en incorporer à l’ordrej; ceux
qui fubfiftoient alors, étant apparemment à charge,
aux religieux. Cette défenfe fut encore inférée dans-
la nouvelle colleûion des ftatuts faite par le général
D. Bernard Garaffe, qui fut publiée l’an 1581 ; lesquels
ftatuts font préfentement en ufage dans l’ordre
, &t ont été -confirmés par le pape Innocent
L’habillement de ces religieufes confifte en une
robe de drap blanc, liée d’une ceinture pareille à
celle des religieux, anfli bien que la cuculle ou fea-
pulaire, ayant des bandes à côté. Ce qu’ elles ont de;
particulier, c’eft qu’elles portent un manteau blanc z
leurs voiles & leurs guimpes font femblables à ceux
des autres religieufes. Elles ne parlent jamais aux
perfonnes féculieres , fi proches parentes qu’elles
puiffent être, que le.voile baiffé &c accompagnée^
de la prieure, ou d’une ou de deux àutres religieufes.
Quoiqu’elles doivent fe conformer en toutes
chofes aux obfervances des religieux , on a néanmoins
égard à la foiblefle de leur fexe, en modérant
principalement la' rigidité du filence, & la demeure
des cellules.
Si le pere général dom Innocent Maflbn, avoit
continué d’écrire les annales de fon ordre , nous ferions
mieux inftruits fur l’origine des religieufes
Chartreufes, & fur tout ce qui peut les regarder : iî
avoit pris là-deffus un engagement particulier dans
le premier volume de ces annales, qu’il publia én
l’année 16 Î7 , dont il y a eu en 1703 une fécondé
édition. L’auteur qui a écrit l'Hifioire des ordres rho-
nafiiques, religieux & militaires, Sec. n a donc pu dire
que peu de chôfe ail fujetde‘ces religieufes dans fon'
feptieme tome , s'étant , dit-il, inutilement adreffè
pour cela aux religieûx du même ordre , qui gardent un
grand filence fur tout ce qui les regarde. ( C. )
* § CHASNADAR-BACHI, grand tréfbrier du
A a a ij