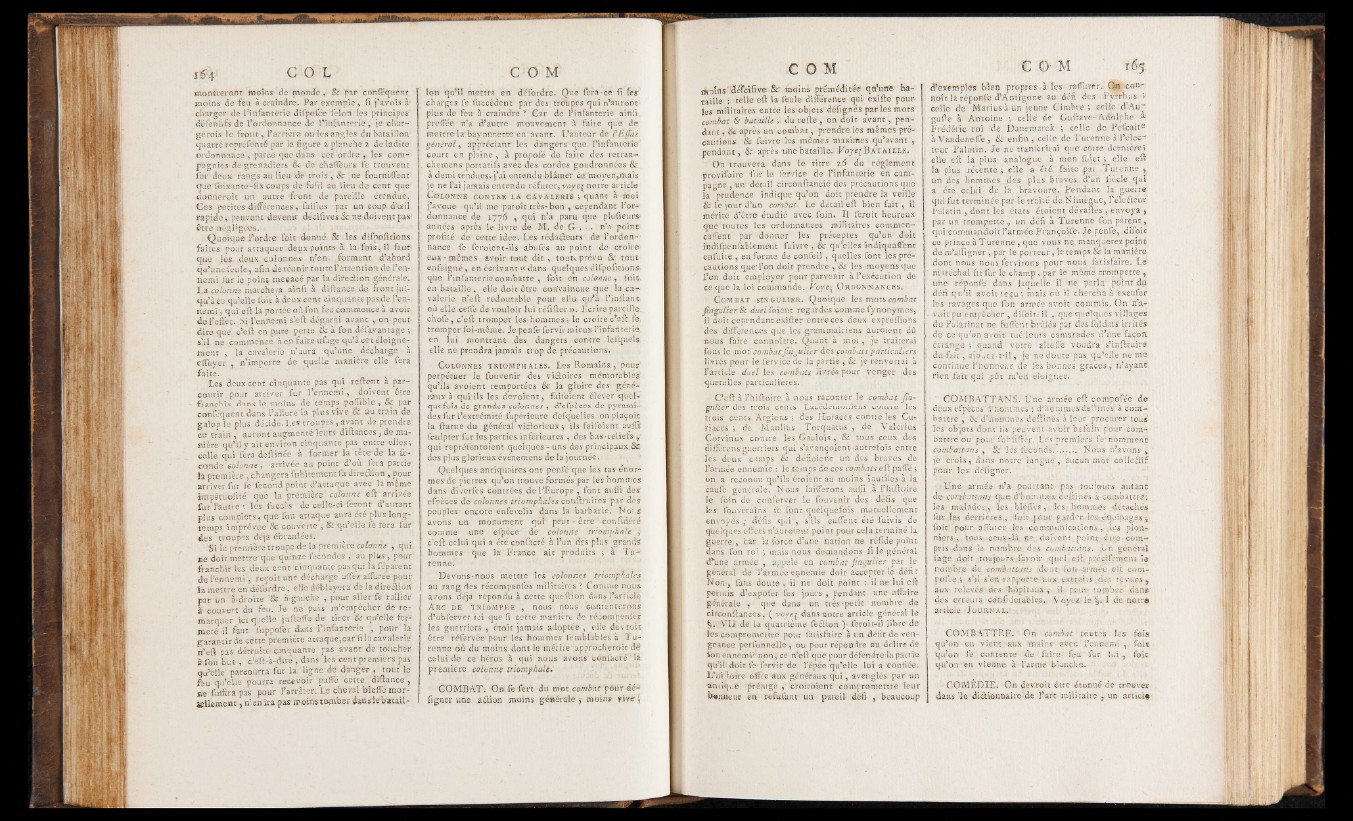
montreront moins de monde M 8 t par confisquent
moins de feu à craindre. Par exemple , fi j’avois à
charger de l'infanterie difpofée félon les principes
defenfifs de l’ordonnance de l’ infanterie, je chargeais
le front, Parrière ou les-angles du bataillon
quarré repréfenté par la figure 2 planche 2 de ladite
ordonnance , parce que dans per ordre , les compagnies
de grenadiers & de chafleurs le trouvent
fur deux rangs au lieu de trois , & ne fourniflent
que foixanté-fix coups de fufil au lieu de- cent que
donneroit un autre front de pareille étendue.
Ces petites différences , faifies par un coup d’oeil
rapide, peuvent devenir décifives & ne doivent pas;
être négligées.
Quoique l’ordre foit donné & les difpofitions
faites pour attaquer deux points à la fois, il faut
que les-deux-colonnes n’en forment d’abord
qu’une feule-, afin de réunir toute l’attention de l’ennemi
fur le point menacé par la direction générale.
La c o lo n n e marchera ainfi à diftance. de front jul-
qu’àce qu’elle foit à deux-ce rit cinquante pas de l’ennemi
, qui eft la portée où fon feu co ni me nce-a. avoir
de l’effet. Si l’ennemi s’eft dégarni avant , on peut
dire que c’eft en pure perte & à fon défa,vantage ;
s’il ne commence à en faire ufage qu’a cet éloignement
, la cavalerie n’aura qu’une déchargé a
cfluyer , n’importe de quelle manière elle fera
faite.
tes deux cent cinquante pas qui reftent à parcourir
pour arriver fur l’ennemi , doivent être
franchis dans le moins de temps pofïible , & par
conféquent dans l’allure la plusviye & an train de
galop le plus décidé. Les troupes, avant de prendre
ce train , auront augmenté leurs diftances, de manière
qu’ il y ait environ cinquante pas^entre elles',
celle qui fera deftinée à . former la tête de- la féconds
c o l o n n e , arrivée au point d’où fera partie
la première , changera fub'itentent fa direétion , pour
arriver fur le fécond point d’attaque; avec la même
împétuofité que la première c o lo n n e eft arrivée
fur l’autre : les fuccès de celle-ci feront d’autant
plus complets , que fon attaque aura été plus longtemps
imprévue & couverte , & qu’elle fe fera fur
des troupes déjà ébranlées. • _
Si la première troupe de la première c o lo n n e , qui
lie doit mettre'que quinze fécondés , an plus , pbur
franchir les deux bent cinquante pas qui la lep aient
de l’ennemi, reçoit une décharge allezallurée pour
la mettre én détordre, elle déblayera de la direction
par un à-droite & à-gauche , pour aller fe' rallier
£ couvert du feu. Je ne puis m’empêcher de remarquer
ici quelle jafteffe de tirer & qu’elle fermeté
il faut fuppofer dans l’infanterie , pour la
garantir de cette première attaque,car fi là cavalerie
n’ eft pas détruite cinquante pas avant de toucher
»fon but , c’eft-à-dire , dans les cent premiers pas
qu’elle parcourra fur la ligne; do danger , tout lç
fôu qu’elle pourra recevoir paffé cette diftance ,
ne fuffira pas pour l’arrêter. Le cheval Fieffé mor-
Spllement, n’en ira pas moins tomber dartÿlebataü-
Ion qu’il mettra en defordre. Que fera-ce fi les
charges fe fuccèdent par des troupes qui n’auront
plus de féu à craindre ? Car de l’infanterie ainfi
preffée n’a d’autre mouvement à faire que de
mettre la'bayonnette en avant. L’auteur de PËJJai
g é n é r a l , appréciant les dangers que l’infanterie'
court en plaine , à propofé de faire des retran-
chemens portatifs avec des cordes goudronnées &
à demi tendues, j’ai entendu blâmer ce moyen,mais
je ne l’ai jamais entendu réfuter; v o y e z notre article
C olonne co ntre la c a v a l e r ie ; quant à moi
j’avoue qu’il me paroît très-bon , cependant l’or-'
donnante de 1776 , qui n’a paru que plufieurs-
années après le livre de M. de G . -. n’a point*
profité de cette idée. Les rédaéteurs de l’ordonnance
fe feroient-ils abufés au point de croire^
eux-mêmes avoir tout d it, tout*.prévu & tout
enfeigné, en écrivant « dans quelques difpofitions-
que l’infanterie combatte , foit en co lo n n e , foit
en bataille, elle doit être convaincue que la cavalerie
n’eft redoutable pour elle qu#à l’inftanc.
ou elle cefle de vouloir lui réfifter ». Écrire pareille
chofe , c’eft tromper les hommes; le croire c’eft le
tromper foi-même. Je penfe fervir mieux l’infanterie
en lui montrant des dangers contre leiquels.
elle ne prendra jamais trop de précautions.
C olonnes t r iom ph a l e s . Les Romains, pour
perpétuer le fonvenir des viâoires mémorables
qu’ils avoient remportées & la gloire des généraux
a-qui ils les dévoient, faifoient élever quel*
quefois de grandes c o lo n n e s , d’efpèces de pyramides
fur l’extrémité fupérieure dèfquelles on plaçoit
la ftatue du général viâorieux ; ils faifoient au fis
fculpterfur les parties inférieures , des bas-reliefs
qui repréfentoient quelques - uns des principaux &
des plus glorieux événemens de la journée.
Quelques antiquaires ont penfé que lès tas énormes
de pierres qu’on trouve formés par les hommes
dans diverfes contrées de l’Europe , font aufli des'
efpèces de- co lo n n e s t r iom p h a le s conftruites par des
peuples- encore enfevelis dans la barbarie. No; s
avons un monument qui peut - être confidéré
comme une efpèce de- c o lo n n e tr iom p h a le 9
c’eft celui qui a été confacré à l’un des plus grands
hommes que la France ait produits ; à Tu-’
renne:
Devons-nous mettre les c o lo n n e s t r iom p h a le s
au rang des récompenfés militaires ? Comme nous
avons déjà répondu à cette queftion dans l’article
A rc de tr iom ph e , nous, nous contenterons
d’obferver ici que fi cette manière de récompenf’er
les guerriers , étoit jamais adoptée , elle devroit
être réfervée pour les hommes le mb labié s a Tu-
reifne où du moins dont le mérite approcHeroit de'
celui de ce héros- à qui nous avons confacré la
première c o lo n n e t r iom p h a le .
COMBAT. On: fe fert du mot c om b a t pour défi
gner une a&ian moins générale , moins vive" 5
rtioîns défcifiver & moins préméditée qn’une bataille
: te lle eft la feule différence qui exifte pour
les militaires entre les objets défignés parles mots
combat & bataille ;t du. r e f te , on doit a v an t , pendant
, & après un com b a t, prendre les mêmes précautions
& fuivre les mêmes maximes qu’ avant ,
pendant, & après une bataille. Voy*\ B a t a il l e .
On trouvera dans le titre 26 du réglement
provifoire fur le fervice de l’infanterie en campagne
, un* détail circonftancié des précautions que
la prudence indique qu-’on doit prendre la veille
& le jour d’un combat- Le détail eft bien fait, il
mérite d’être étudié avec foin. Il feroit heureux
que toutes les ordonnances militaires commençaient
par donner les préceptes qu’on doit
indifpenfablemem fuivre , & qu’elles indiquaient
enfuite , en forme de confeil, quelles font les précautions
q.ue? l’on doit prendre , & les moyens quë
l’on doit employer pour parvenir à l’exécution de
ce que la loi commande. V o y e { O rdonn ance s.
C om b a t s in g u l ie r . Quoique l e s m o t s c om b a t
f i t ig u li e r & d u e l foient regardés comme fynonymes,
il doit cependant exifter entre ces deux expreflions
des différences que les -grammairiens auroient dû
nous faire connoître. Quant à moi , je traiterai
fous le mot c om b a tJ în g u lie r des c om b a ts p a r t i c u lie r s
livrés pour le fervice de la partie , & je renverrai à
l’article d u e l les c om b a ts livrés pour venger des
querelles particulières.
C’eft à l’hiftoire à nous raconter le c om b a t J ïn -
g u h e r des trois cents Lacédémoniens contre les
trois cents Argiens ; des Horaces contré les Cu-
riacès ; de Manlius Torquatu-s , de Valerius
Corvinus- contre les Gaulois, & tous ceux des
differens guerriers qui s’avançoient autrefois entre
les deux camps & défioient un des braves de
l’armée ennemie : lé, temps de ces com b a ts eft paffé ;
on a reconuu qu’ilsétoient au moins inutiles à la
caufe générale. Nous laifferons aiilji à l’ hiftoire
le loin de confervfer le fouvenir des défis que
les .fouverains fe font quelquefois mutuellement
envoyés ; défis qui , s’ils euffenr été fuivis de
quelques effets n’àuroient point pour cela terminé la
guerre , car la force d’une nation ne réfide point
dans fon roi ; mais nous demandons fi le général
d’ une armée , appelé en c om b a t J in g u li e r par le
général de l’ârmée ennemie doit accepter le défi?
Non, fans doute, il ne doit point : il ne lui eft
permis d’expoler fes jours , pendant une affaire
générale , que dans un très-petit nombre; de
oirconftances, ( v o y e z dans notre article général le
§. VII de la quatrième feâion )• feroit-il libre de
les compromettre pour fatisfaire à un défir de vengeance
pet-fonnelle , ou pour répondre au délire de
ton ennemi? non, ce n’eft que pour défendre la patrie
qu’il doit fe fervir de- l’épée qu’elle lui a confiée.
L’hiftoire offre aux ‘généraux qui, aveuglés par un
•antique préjugé croiroient compromettre leur
tanneur en r-efulànt un pareil- défi , beaucoup
dfexemples bien propres à les raffurer. On con-
noît la réponde d’Antigone au défi des; Pyrrhus V
celle de Marius à un jettrie Cimbre ; celle d’-Au“
gufte à Antoine ; cellé dé’ Guftave-Adolphe a
Frédéric roi 'de Danemarck ; celle de Pe&air8
à Vandenefle , & enfin , celle de Turenne à l’élec“
teijr Palatin. Je ne tranlcrirai que cette dernière»
elle, eft la plus analogue à mon Jujet; elle eft
la plus récente; elle a été.' faite par Turenne ,
un des hommes,.des plus braves- d’un fiécîe qui
a été celui - de là bravoure. Pendant la guerre
qui fut terminée par le traité de. Nimègue, Telefteur
Palatin , dont les états étoiènt déyaftés envoya ,
par un trompette, un défi à Turenne fon parent,
qui commandoit l’armée Frânçoife. Je penfe, difoit
ce prince,à Turenne, que vous ne manquerez point
de m’alfigner, par le porteur, le temps & là manière
dont nous nous fervirons pour nous fatisfaire. Le
maréchal fit fur le champ , par le même trompette ,
une report fe dans laquelle il ne parla1 point du
défi qu’il avoir reçu ; mais où il chercha à excufer
les ravages que' fon armée avoit commis. Gn n’a-
- voit pu empêcher , difoit-il , que quelques villages
du Palatinat ne fufient brùlés par des foldâts irrités
de ce qu’on avoit tué leurs camarades d’tipie façon
étrange ; quand; votre alteffe voudra- s’inftruire
du fait, ajouta-t-i!, je ne doute pas qu’elle né me
continue'l’honneur de fès bonnes' grâces , n’ayant
riem fait qui pût m’en éloigner.
COMBATTANS. Une armée eft contpofée de
deux efpèces d’hommes : d’hommeS'd.èftinés a combattre
, & d’hommes deftinës à leur procurer tous
leà objets dont il'S:peu>reht avoir befoin pour combattre
ou pour' JVibfiftér. .Les'premiers fe' nomment
c om b a t to n s , &' les féconds*'../..... Nous n’avons ,
jé crois,'dans nôtre iangue , aucun mot colledif
pour les- défigner.
Une armée -n’a pourtant -pas toujours autant
de- c o m b a t ta i s que d’hommes deftinés à combattre;,
les malades;., les. bléffes , les^ hommes .détachés
fur J es .dernières;, iîfpit pour gar.de r-.-l es^éqe i page s
foit pour affurer les ciommunications, ,les pionniers.,
, tous, ceux-là ne doivent, point être compris
dans le- nombre, des cum b a ttà n s \ Un général
fage .doit toujours iàyoir quel eft.procifendent le
nombre de. c am b a tta r is dont fon armée eft coin*
p o fé e s ’il s’en rapporte-'•ùux extraits , des levées,
aux: relevés des*- hôpitaux , il peut- tomber dans
des erreurs confiderables. V-oyez le §. I de notre
article J 0 u rn a l .! .
COMBATTRE. On c om b a t '■ toutes les fois
qu’on en vient aux mains avec l’ennemi , foit
qu’on le contente de faire' feu fur -lui . foie
qu’on |en vienne à l’arme blanche.
COMÉDIE. On devroit être étonné de trouvée
dans'le di&ionnaire-de l’art militaire 7 un articit