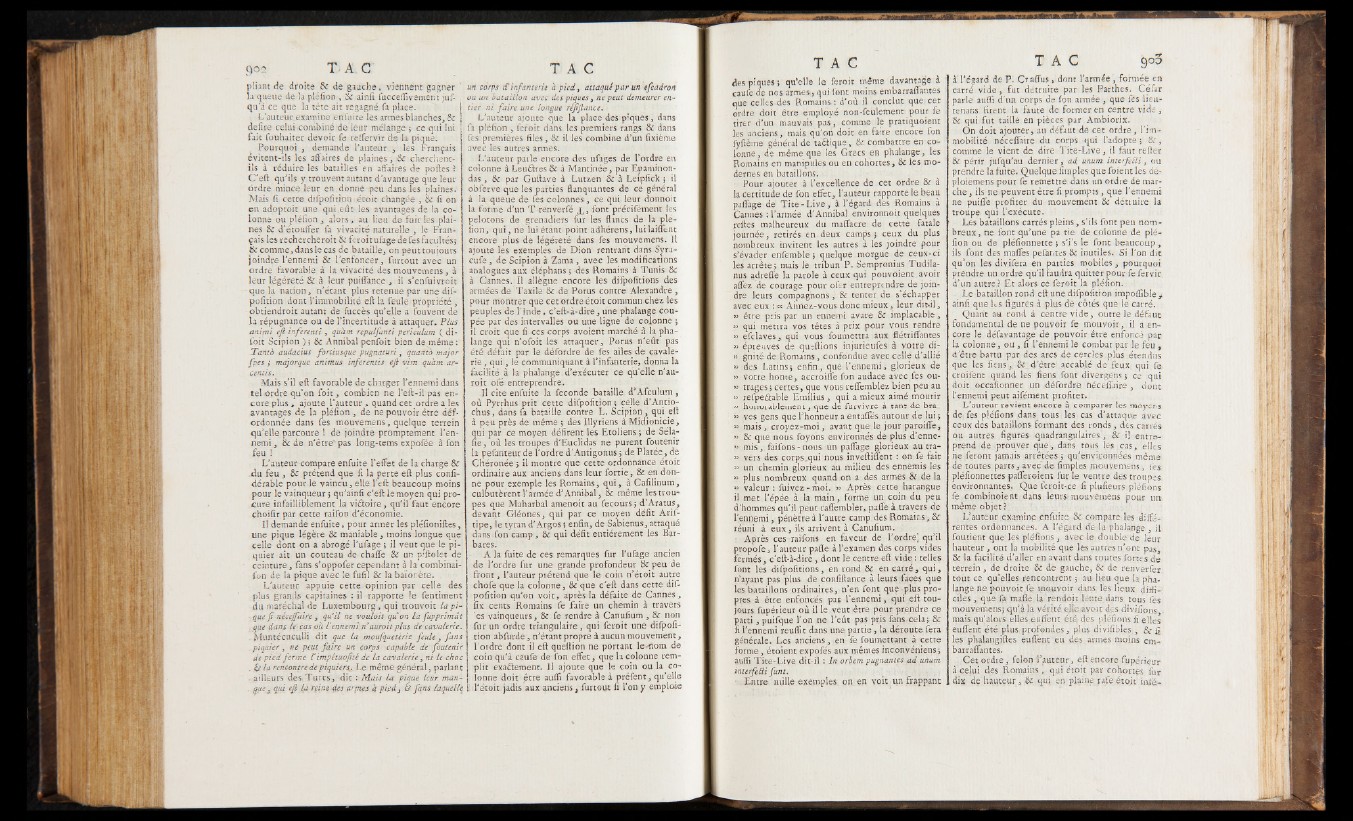
pliant de droite 8c de gauche, viennent gagner
la queue de la pléfion , 8c ainfi fuccefli veinent juf-
qu'd ce que la tête ait regagné, fa place.
L'auteur examine enfuite les armes blanches, 8e
defire celui combiné de leur mélange ; ce qui lui
fait fouhaiter devoir fe relfervir de la pique.
Pourquoi, demande l’auteur , les Français
evitent-ils les affaires de plaines, & cherchent-
ils à réduire les batailles en affaires de poftes ?
C ’eft qu'ils y trouvent autant d'avantage que leur
ordre mince leur en donne peu dans les plaines.
Mais fi cette difpofition étoit changée , 8c fi on
en adoptoit une qui eût- les avantages de la colonne
ou p lé fio n a lo r s , au lieu'de fuir les plaines
8c d'étouffer fa vivacité naturelle , le Français
les rechercheroit & feroitufage de fes facultés;
8c comme, dans le cas de bataille, on peut toujours
joindre l ’ennemi 8c l ’enfoncer, furtout avec un
ordre favorable à la vivacité des mouvemens, à
leur légéreté & à leur puiffançe , il s’enfuivroit
que la nation, n’étant plus retenue par une difpofition
dont l'immobilité eft la feule propriété ,
obtiendroit autant de fuccès qu’elle a fouvent de
la répugnance ou de l’incertitude à attaquer. Plus
animi eft inferenti , quant repulfanti periculum (d i-
foic Scipion ) ; & Annibal penfoit bien de même :
Tantb audacius fortiusque pugnaturi, quanta major
fpes j majorque ammus inferentis eft vim quam ar-
centis.
Mais s’ il eft favorable de charger l’ennemi dans
teLordre qu’on fo i t , combien ne l’eft-il pas encore
plus , ajoute l’auteur, quand cet ordre a les
avantages de la pléfion, de ne pouvoir être déf-
ordonnée dans fes mouvemens, quelque terrein
qu’elle parcoure 1 de joindre promptement l’ennemi
, & de n’être' pas long-tems expofée à fon
feu !
L’auteurcompare enfuite l’effet de la charge &
du feu , 8c prétend que fi la perte eft plus confi-
dérable pourde vaincu, elle l’eft beaucoup moins
pour le vainqueur ; qu’ ainfi c’éft le moyen qui procure
infailliblement la viéfoire, qu’ il faut encore
çhoifir par cette raifon d’économie.
Il demande enfuite, pour armer les pléfioniftes,
une pique légère 8c maniable , moins longue que
celle dont on a abrogé l’ufage ; il veut que le pi-
quier ait un couteau de chaffe 8c un piftolet de
ceinture, fans s’oppofer cependant à la combinaison
de la pique avec le fufil 8c la baïorète.
L'auteur appuie cette opinion par celle des
plus grands capitaines : il rapporte le fentiment
du maréchal de Luxembourg, qui trouvoit La pique
fi nécejfaire , qu'il ne vouloit qu on la fupprimât
que dans le. cas ou Vennemi n auroit plus de cavalerie.
Muntécu.culli dit que La, moufqueterie feule, fans
piquier, ne peut faire un çorps capable de foutenir
de pied ferme Vimpêtuofité de la cavalerie 3 ni le choc
. & la rencontre de piquiersLe même général, parlant
ailleurs des, Turcs, dit : Mais la pique leur man-
■ &y-e 3 ÇM e$ r&ne drpie$ h pied j & fans laquelle
un corps d'infanterie a pied y attaqué par un efeadrott
ou un bataillon avec des piques , ne peut demeurer entier
ni faire une longue réjtftance.
L’auteur ajoute que la place des piques, dans
fa pléfion , feroit dans les premiers rangs 8c dans
fes premières files, 8c il les combine d’un fixième
avec les autres armes.
L’auteur parle-encore des ufages de l’ordre en
colonne à Le 11 êtres 8c à Mantinée, par Epaminon-
das, 8c par Guftave à Lutzen 8c à Leipfick ; il
obferve que les parties flanquantes de ce général
à la queue de fes colonnes, ce qui leur donnoit
la forme d’un T renverfé jl, font précifément les
pelotons de grenadiers fur les flancs de la pléfion,
qui, ne lui étant point adhérens, luilaifient
encore plus de légéreté dans fes mouvemens. Il
ajoute les exemples de Dion rentrant dans Syra-
eufe, de Scipion à Zama, avec les modifications
analogues aux éléphans ; des Romains à Tunis 8c
à Cannes. Il allègue encore les difpofitions des
armées de Taxile 8c de Porus contre Alexandre,
pour montrer que cet ordre étoit commun chez les
peuples de l’ Inde, c’eft-à-dire, une phalange coupée
par des intervalles ou une ligne de colonne j
il croit que fi ces corps avoîent marché à la phalange
qui n’ofoit les attaquer, Porus n’eût pas
été défait par le défordre de fes ailes de cavalerie,
qui, le communiquant à l’infanterie, donna la
facilité à la phalange.d’exécuter ce qu’elle n’au-
roit ofé entreprendre.
Il cite enfuite la fécondé bataille. d’ AFculum ,
où Pyrrhus prit cette difpofition ; celle d’Antio-
chus, dans fa bataille contre L. Scipion, qui eft
à peu près de même ; des Illyriens à Midionicie,
qui par ce moyen défirent les Etoliens ; de Séla-
fie, où les troupes d’Euclidas ne purent foutenir
la pefanteur de l’ordre d’Antigonus ; de Platée, de
Chéronée î il montre que cette ordonnance étoit
ordinaire aux anciens dans leur fortie, 8c en donne
pour exemple les Romains, qui,f à Cafilinum,
culbutèrent l’armée d’ Annibal, 8c même les troupes
que Maharbal amenoit au fecours; d’Aratus,
devant Gléones, qui par ce moyen défit Arif-
tipe, le tyran d’Argos ; enfin, de Sabienus, attaqué
dans fon camp, 8c qui défit entièrement les Barbares.
A la fuite de ces remarques fur l’ufage ancien
de l'ordre fur une grande profondeur 8c peu de
front, l’auteur prétend que le coin n’étoit autre
chofe que la colonne, 8c que c ’eft dans cette difpofition
qu’on voit, après la défaite de Cannes,
fix cents Romains fe faire un chemin à travers
'es vainqueurs, 8c fe rendre à Canufium, 8c non
fur un ordre triangulaire, qui feroit une difpofition
abfurde, n’étant propre à aucun mouvement,
l’ordre dont il eft queftion ne portant le«*rtom de
coin qu’à caufe de fon effets que la colonne remplit
exa&ement. Il ajoute que le coin ou la colonne
doit être aufii favorable à préfent, qu’elle
.l’étoit. jadis aux anciens, furtoyt fi l’on y emploie
des piques; qu’elle le feroit même davantage à
caufe de nos armes:, qui (ont moins embarraflantes
que celles des Romains : d’où il conclut que cet
ordre doit être employé non-feulement pour fe
tirer d’ un mauvais pas, comme le pratiquoient
les anciens, mais.qu’on doit en faire encore fon
fyftëme général de ta&ique v 8c combattre en colonne,
de-même que les Grecs en phalange, les
Romains en manipules ou en cohortes, 8c les modernes
en bataillons.
Pour ajouter à l’excellence de cet ordre 8c à
la certitude de fon effet, l’auteur rapporte le beau
paffage de T ite -L iv e , à l’égard des Romains à
Cannes : l’armée d’Annibal environnoit quelques
reftes malheureux du mafîaere de cette fatale
journée, retirés en.deux camps} ceux du plus
nombreux invitent les autres à les joindre pour
s’évader enfemble 5 quelque morgue de ceux-ci
les arrête; mais le tribun P. Sempronius Tudila-
nus adreffe la parole à ceux qui pouvoient avoir
affez de courage pour ofer entreprendre de joindre
leurs compagnons, 8c tenter de s’échapper
avec eux : « Aimez-vous donc mieux, leur diwl,
« être pris par un ennemi avare 8c implacable,
w qui mettra vos têtes à prix pour vous rendre
» efclaves, qui vous foumettra aux flétriffantes
» épreuves de quittions injurieufes à votre di-
» gnité de Romains, confondue avec celle d’allié
» des Latins; enfin., que l’ennemi, glorieux de
» Votre honte, accroiüe fon audace avec fes ou-
» trages ; certes, que vous reflemblez bien peu au
» refpe&able Emilius, qui a mieux aimé mourir
» honorablement, que de furvivre à tant de bra-
» ves gens que l’honneur a entafles autour de lui ;
» mais, croyez-moi, avant que le jour paroifle,
1 8c que nous foyons environnés-de plus d’ enne-
» mis, faifons - nous un partage glorieux au tra-
» vers des corps„qui nous inveftiflent : on fe fait
« un chemin glorieux au milieu des ennemis les
» plus nombreux quand on a des armes 8c de la
» valeur : fuivez -moi. » Après cette harangue
il met l’épée à la main, forme un coin du peu
d’hommes qu’il peut raffembler, pafle à travers de
l’ennemi, pénètre à l’autre camp des Romains, 8c
réuni à eu x , ils arrivent à Canufiüm.
: Après ces raîfons en faveur de l’ordre] qu’ il
propofe, l’auteur parte à l’examen des corps vides
fermés, c’eft-à-dire, dont le centre eft vide : telles
font les difpofitions, en rond 8c en carré, qui,
n’ayant pas plus de confiftance à leurs .faces que
les bataillons ordinaires, n’en font que plus propres
à être enfoncés pas l’ennemi, qui eft toujours
fupérieur où il le veut être pour prendre ce
parti, puifque l’ on ne l ’eût pas pris fans cela; 8c
fi l’enneirti reuftit dans une partie, la déroute fera
générale. Les anciens, en fe foumettant à cette
forme, étoient expofés aux mêmes inconyéniens;
âiiffi Tite-Live dit-il : In orbem pugnantes ad unum
interfefti funt.
Entre mille exemples on en voit un frappant
à l’égard de P. Craffus, dont l’armée, formée en
carré v id e, fut détruite par les Parthes. Ce far
parle aufii d’un corps de fon armée, que fes lieu-
tenar.s firent la faute de former en centre v id e,
8c qui fut taillé en pièces par Ambiorix.
On doit ajouter, au défaut de cet ordre, l'immobilité
néceflaire du corps qui l’adopte; 8c,
comme le vient de dire Tite-Live, il faut refter
8c périr jufqu’au dernier, ad unum interfefti, ou
prendre la fuite. Quelque fimples que foient les dé-
ploiemens pour fe remettre dans un ordre de marche,
ils ne peuvent être fi prompts, que l’ennemi
ne puifle profiter du mouvement 8c détruire la
troupe qui l’exécute.
Les bataillons carrés pleins, s’ ils font peu nombreux,
ne font qu’une pa tie de colonne de pléfion
ou de pléfionnette; s’i's le font beaucoup,
ils font des martes pefantes 8c inutiles. Si l’on dit
qu’on les divifera en parties mobiles , pourquoi
prendre un ordre qu’il faudra quitter pour fe fervir.
d’ un autre ? Et alors ce feroit la pléfion.
- Le bataillon rond eft une difpofition impoffibley
ainfi que le s figures à plus de côtés que le carré.
Quant au rond à centre vide, outre le défaut
fondamental de ne pouvoir fe: mouvoir, il a encore
le défayantage de pouvoir être enfoncé par
la colonne, o u , fi l’ennemi le combat par le feu ,
d’être battu par de.s arcs de cercles, plus étendus
que les fiens,. 8c. d’ê:tre; accablé de feux qui fe,
çroifent quand les fiens font divergëns ; ce qui
doit occafionner un défordre néceflaire, dont
fennemi peut aifément profiter.
L’auteur revient encore à comparer les moyens
de: fes pléfions dans tous les cas d’ attaque avec
ceux des bataillons formant des ronds, des carrés
qu autres figures quadrangulaires, 8c il entreprend
de prouver que, dans tous les cas, elles
ne feront jamais arrêtées ; qu’environnées même
de toutes parts, avec de fimples .mouvemens, lès
pléfionnettes pafieroient furie ventre dès troupes
environnantes,. Que feroit-çe fi plufieurs pléfions
fe combinoient dans leurs-mouvemens pour un
même objet
L’auteur .examine enfuite 8c compare les différentes
ordonnances. A l’égard de là phalange , il
foutient que' les pléfions , avec le double de leur
hauteur, ont la mobilité que les autres n’ont pas,
8c la facilité d’aller en avant dans toutes fortes de
terrein, de droite 8c de gauche, 8c de renverfer.
tout ce qu’elles rencontrent ; au lieu que la phalange
ne pou voit Je mouvoir dans les lieux difficiles
, que là mafle. 1J rendoit-lente dans tous fes
mouvemens; qu’à la vérité elle avoit des divifions
mais qu’alors elles eu fient été des pléfions fi elles
euflent été plus profondes, plus divifibles., 8c fi
les phalangiftes euflent eu des armes moins ern-
barraffantes.
Cet ordre, félon l’auteur, eft encore fupérieirr
à celui des Romains , qui étoit par cohortes fur
dix de hauteur , & qui en plaine rafe étoit infé