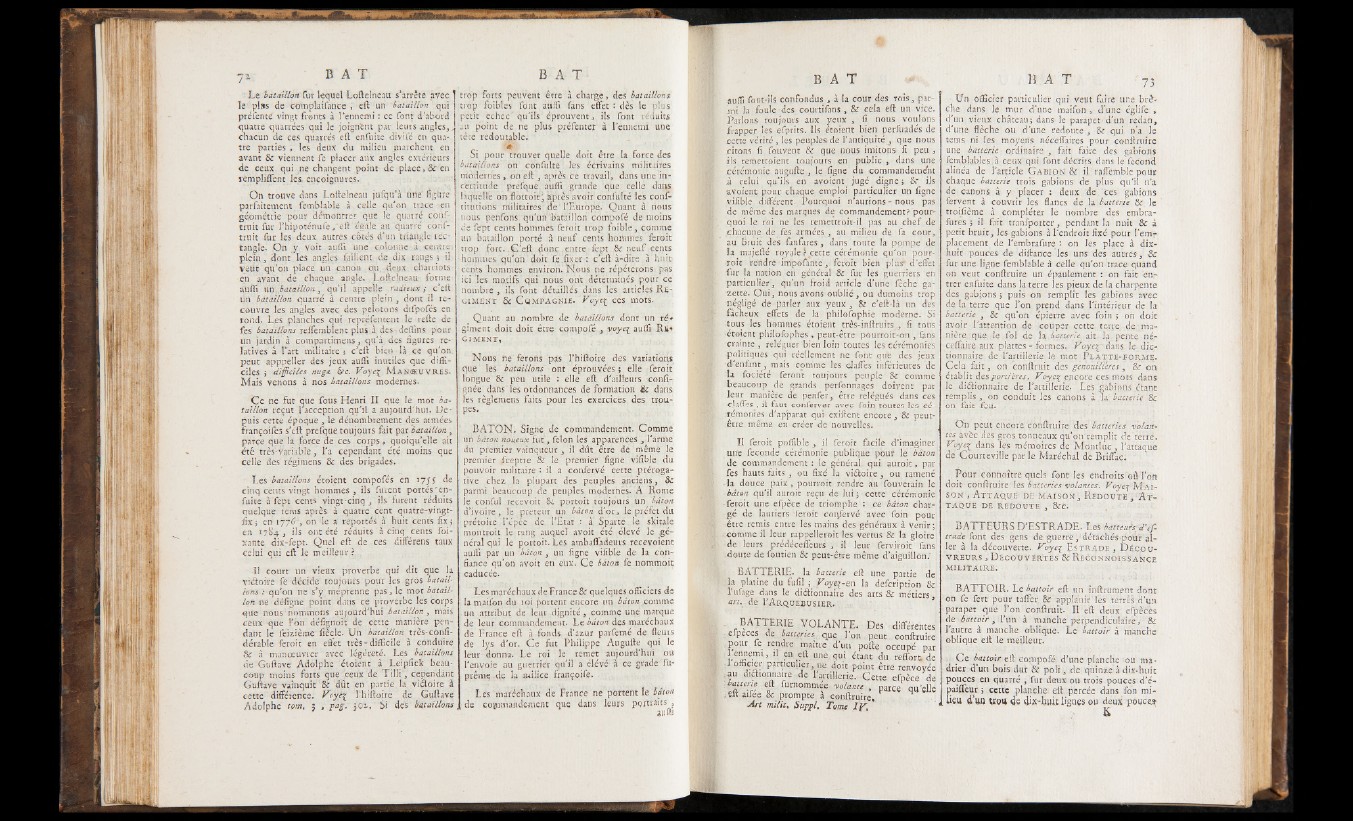
B A T B A T
Le bataillon fur lequel Loftelneau s'arrête avec '
le pl»s de côlnplaifance , eft un bataillon qui
préfenté vingt fronts à l'ennemi : ce font d’abord
quatre quarrées qui le joignant par leurs angles,,
chacun de ces quarrés eft enfuite divifé en quatre
parties , les deux du milieu jnarchent en
avant & viennent fe placer aux angles extérieurs
de ceux qui ne changent point de place, & en
ïempüflenc les encoignures..
On trouve dans Loftelneau jufqu’à une' fîgüré
parfaitement femblable à celle qu'on trace en
géométrie pour démontrer que le quarré conf-
truit fur Thipoténufe/eft égalé au quarré conf- !
nuit fur les deux autres côtés d'un triangle rectangle.
.On y voit aufli une colonne à centre,
plein, dont les angles faillent.:de dix rangs; il
veut qu’on place un canon ou, deux charriots
en avant de chaque angle. Loftelneau: forme
aufli un.,bataillon.3 qu’il appelle radieux ,* c’ eft
un bataillon quarré à centre plein , dont il recouvre
les angles avec des pelotons difpofés en
tond. Les planches qui repréfencent le refte de
lès bataillons reflemblent plus à. des deflins pour
un jardin à compartimens, qu’à des figures relatives
a l’art militaire j c’ eft bien là .çe qu’on,
peut apppeller des jeux aufli inutiles que difficiles
; difficiles nug& &c. Voye% MANOEUVRES.
Mais venons à nos bataillons modernes.
C e ne fut que fous Henri II que le mot bataillon
reçut l’acception qu’il a aujourd’hui. D e puis
cette époque, le dénombrement des armées
françoifes s’ eft prefque toujours fait par bataillon,
parce que la force de ces corps, quoiqu’elle ait
été très-Variable, l’a cependant été moins que
celle des régimens 8c des brigades.
Les bataillons étoient compofés en 175y de
cinq cents vingt hommes , ils furent portés'en-
fuite à fept cents vingt-cinq, ils furent réduits
quelque tems après à quatre cent quatre-vingt-
fix j en 1776 , on le a reportés à huit cents fix>.
en 1784 , ils ont été réduits à cinq cents foi-
xante dix-fept. Quel; eft de ces différens taux
celui qui eft le meilleur ? . Il
Il court un vieux proverbe qui dit que la
victoire fe décide toujours pour les gros bataillons
: qu’on ne s’y méprenne pas, le mot bataillon
ne défigne point dans ce proverbe les corps
que nous nommons aujourd’hui bataillon, mais
ceux que l’ on défignoit de cette manière pendant
le feizièrae fiècle. Un bataillon très-confi-
dérable feroit en effet très-difficile à conduire
& à manoeuvrer avec légéreté. Les bataillons
de Guftave Adolphe étoient à Leipfick beaucoup
moins forts que ceux de T i l l i , cependant
Guftave vainquit & dût en partie la victoire à
cette différence. Vàÿê^ l ’hiftoîre de Guftave
Adolphe tom. 3 , pag: 302., Si des Ht aillons
trop forts peuvent être à charge, des bataillons
trop foibles font aufli fans effet : dès le plus
petit echec' qu’ils éprouvent, ils font réduits
|au point de ne plus préfente): à l ’ennemi une
têce redoutable. *
; . ik\'.
Si pour trouver quelle doit être la force des
'bataillons on confulte les écrivains militaires
modernes , on eft , après, ce travail, dans une incertitude
prefque. aufli grande que celle dans
laqué!le on flottoit, après avoir confulté les conflit
uti on s militaires'.de rEurôpe. Quant à nous
nous penfons qu’un bataillon compofé de moins
de fept cents hommes feroit trop roible, comme
un bataillon porté à neuf cents hohimes feroit
trop fo r t .,(C’e ftd o n c .entre, fept 8c neuf cents
hommes qu’on doit fé fixer : c’eft à-dire à huit
cents hommes environ. Nous ne répéterons: pas
ici les motifs qui nous ont déterminés pour ce
nombre, ils font détaillés dans lès articles R eg
i m e n t & C o m p a g n i e . Voye^ ces mots.
Quant au nombre de bataillons dont un ré»
giment doit doit être c o m p o f é voye[ aufli R i t
G I M E N T ,
Nous ne ferons pas l’hiftoire des variations
que les bataillons ont éprouvées ; elle feroit
longue 8c peu utile : elle eft d’ailteurs confî-
gnée dans les ordonnances de formation & dans
les règlemens faits pour les exercices des troupes.
‘ BATOÎ^. Signe de commandement. Comme
un bâton noueux fu t, félon les apparences , l’arme
du premier vainqueur, il dût être de même le
premier feeptre 8c le premier fîgnê vifîble du
pouvoir militaire : il a confervé cette prérogative
chez la plupart des peuples anciens, 8c
parmi beaucoup de peuples modernes* A Rome
le conful recevoit & portoi,t toujours, un bâton
d’ivoire, le prêteur un bâton d’or , le préfet du
prétoire l’épée de l’Etat : à Sparte le skiçale
montroit le rang auquel avoit été élevé le .général
qui le portoit. Les ambafïàdeurs recevoient
aufli par un bâton , un ligne vilible de la confiance
qu’on avoit en eux. C e bâton fe nommoit
caducée.
Les maréchaux de France 8c quelques officiers de
la maifon du roi portent encore un Æaro/z,comme
u-n attribut de leur dignité , comme une marque
de leur commandement. Le bâton des maréchaux
de France eft à fonds d’azur parfemé de fleurs
de lys d’or. C e fut Philippe Augufte qui le
leur donna. Le roi le remet aujourd’hui ou
l’envoie au guerrier qu’il a élevé a ce grade fu-
. prenne de la milice françoife.
Les "maréchaux de France ne portent le bâton
de commandement que dans leurs portraits} auflü
B A T B A T 73
aufli font-ils confondus , à la cour des rois, parmi
la foule des courtifans , 8c cela eft un vice.
Parlons toujours aux yeux , fi nous voulons
frapper les efprits. lis étoient bien perfuadés de
cette vérité, les peuples de l'antiquité ^ que nous
citons fi fouvent 8c que nous imitons fi peu ,
ils remettoient toujours en publie , dans une
cérémonie augufte , le ligne du commandement
.à celui qu’ils en avoient jugé digne ; 8c ils
«voient pour chaque emploi particulier un ligne
vilible différent. Pourquoi n’aurions - nous pas
de même des marques de commandement? pourquoi
le roi ne les remettroit-il pas au chef de
chacune de fes armées au milieu de fa cour,
au Bruit des fanfares , dans toute la pompe de
la majefté royale ? cette cérémonie qu’ on pour-
•roit rendre im'pofante , feroit bien p lu s 'd ’effet
fur la nation en général 8c fur les guerriers en
particulier , qu’un froid article d’une fèche. gazette.
Oui, nous avons oublié, ou dumoins trop
négligé de parler aux yeux , 8c c’ eft-là un des
fâcheux effets de la philofophie moderne. Si
tous les hommes étoient très-inftruits., fi tous
étoient philofophes , peut-être pourroit-on , £ans
crainte, reléguer bien loin toutes les cérémonies
politiques qui réellement ne font que des jeux
d’enfant, mais comme les cJafles inférieures de
la fociété feront toujours .peuple 8c comme
beaucoup^ de grands perfonnages doivent par
leur manière de penfer, être relégués dans ces
ejaffes, il faut conferver avec foin toutes les cérémonies
d’apparat qui exiftent encore , 8c peut-
être même en créer de nouvelles.
Il feroit poffible il feroit facile d’imaginer
une fécondé cérémonié publique pour le bâton
de commandement: le général qui auroit, par
fes hauts faits , ou fixé la victoire ou ramené
la douce paix, pourroit rendre au fouverain le
bâton qu’il auroit reçu de lu i, cette cérémonie
feroit une efpèce de triomphe : ce bâton chargé
de lauriers'feroit coipèrvé avec foin pour
être remis entre les mains des généraux à venir ;
comme il leur rappelleroit les vertus 8c la gloire
de leurs prédécefieurs , il leur ferviroit fans
doute de foutien 8c peut-être même d’aiguillon.’ :
BATTERIE , la batterie eft une partie de
la platine du fufil ; Voye^-tn la defeription 8c!
l’ufage dans le di&ionnai're des arts 8c métiers, ««•. de TArqueBusier.
efpeces de batteries qu$ l’on peut conftruire
pour fe rendre maître d’un polie occupé par
1 ennemi, il en eft une. qui étant du refforu de
I officier; particulier , ne doit point être renvoyée
m diôionnaire. de Tarrillerie. Cette efpèce de
l Unr t furnommee volante , parce M J J
;Çit aifee 8c prompte a conftruire.
Art milit. Suppl. Tome J K
Un officier particulier qui veut faire une brèche
dans le mur d’ une maifon , d’une églife ,
d’un vieux château; dans le parapet'd’ un redan,
d’une flèche ou d ’une redoute, 8c qui n’a Je
tems ni les moyens néceflaires pour conftruire
une batterie ordinaire , fait faire des gabions
fernblabjes.à ceux qui font décrits dans le fécond
alinéa de l’article G a b i o n & il raftemble pour
chaque batterie trois gabions de plus qu’il n’a
de canons, à y placer : deux de. ces gabions
fervent à couvrir les flancs de la batterie 8c le
troisième à compléter le nombre des embra-
fures ; il fait tranfporter, pendant la nuit 8c à
petit bruit, les gabions à l’endroit fixé pour Tenir
placement de Tembrafure : on les place à dix-
huit pouces de diftanCe les uns des autres, 8c
fur une ligne femblable à celle qu’on trace quand
on veut conftruire un épaulement : on fait “en.-
trer enfuite dans la terre les pieux de la charpente
des gabions ; puis on remplit les gabions avec
de la terre que Ton prend dans, l ’intérieur de la
batterie , 8c qu’on épierre avec foin ; oh doit
avoir l ’attention, de couper cette terre de manière
que, le fol de la batterie ait, Iji pente né-
cefîaire aux plattes - formes. Voye% dans, le dictionnaire
de l ’artillerie le mot P l a t t e - f o r m e .
Cela fa it, oh 'conft.ruit des genouillères | & on
établit des portières. Voyeç encore ces mots dans
le dictionnaire de l ’artillerie. Les .gabions étant
remplis , on conduit les canons à ia bàtterie 8c
on fait feu.
On peut encore conftruire des b a t t e r ie s v o la n te
s avec des gros tonneaux qu’on remplit de terré.
Voyez ^ans les mémoires de Mdntluc, l’attaque
de Courteville par le Maréchal de Brïflac. ■'
Pour connoître quels font les endroits où Ton
doit conftruire'les batteries volantes. Voye% M a i s
o n , A t t a q u é - d e m a i s o n , R e d o u t e , A t t
a q u e DE R E D O U T E , 8CC.
B A T T EU R S D ’E STRADE . U^baeteu^Téfi
trade font des gens de guerre ,• déïachés-.poût aller
à la découverte. Voyei E s t r a d e , D écou v
r eu r s , D é c o u v e r t e s & R E c d N N O rs s A N C E
m i l i t a i r e .
B A T TO IR . Le battoir eft un inftruraent dont
on fe fert pour rafler 8c appîànir les .terres d’un
parapet que Ton conftruit. Il eft deux efpècès
de battoir s Y un à manche perpen.dicula'irè, 8c
l’autre à manche oblique. Le battoir à manche
oblique eft. le meilleur.
-■ C e battoir eft compofé d’une planche ou madrier
d un bois dut 8c poli s de quinze à dix-huit
pouces en quarré ,'fur deux ou trois pouces d’é-
paifîeur ; cette planche ell percée dans fon milieu
d’uu trou 4e dix-huit lignes ou deux pouce.»