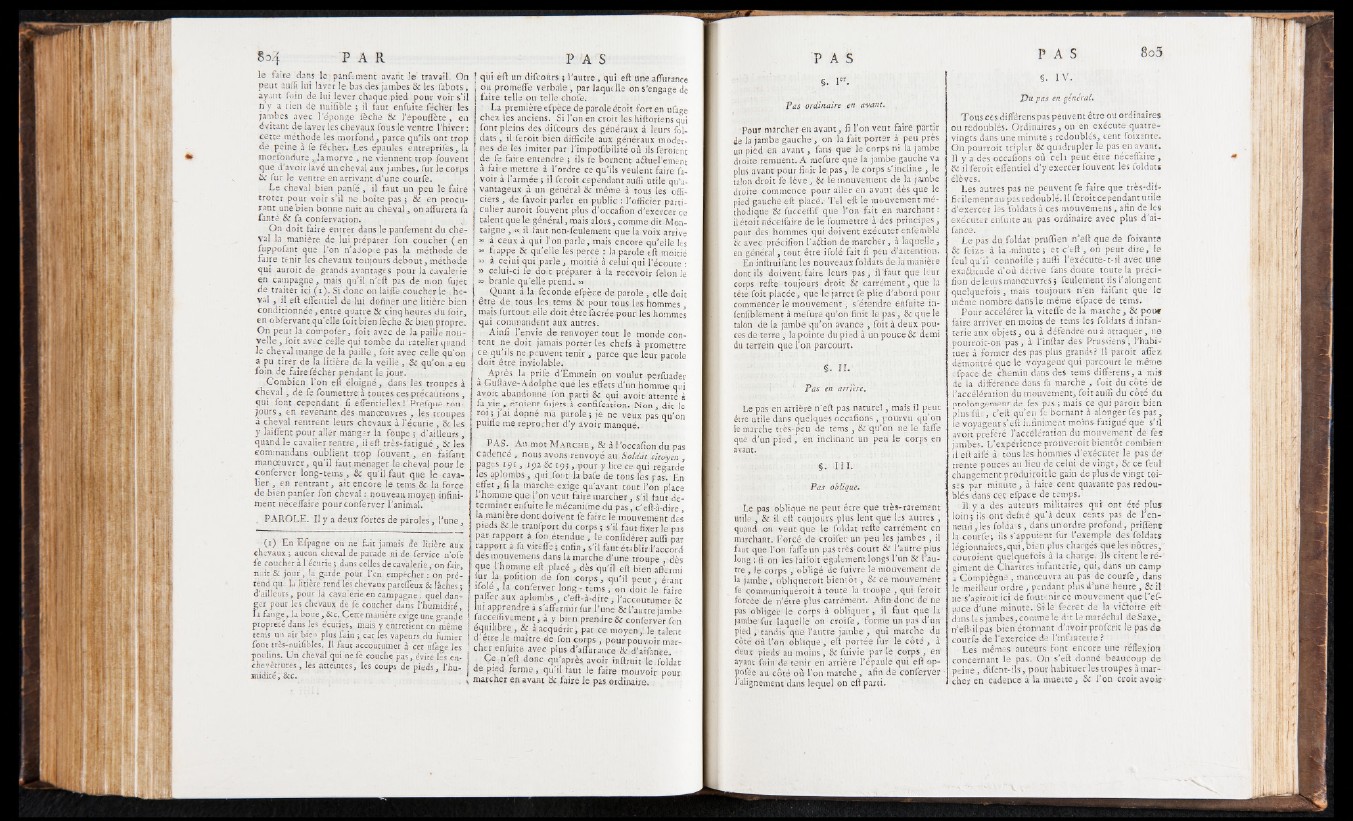
8 o, P A R
le faire dans le panftment avant le travail. On
peut auffi lui laver le bas des jambes & les fabots,
ayant foin de lui lever chaque pied pour voir s’il
n’y a rien de nuifible ; il faut enfuite fécher les
jambes avec l ’éponge fèche & l’époufïete, en
évitant de laver les chevaux fous le ventre l’hiver :
cette méthode les morfond , parce qu’ils ont trop
de peine à fe fécher. Les épaules entreprises, la
morfondure via morve , ne viennent trop fouvent
que d’avoir lavé un cheval aux jambes, fur le corps
& fur le ventre en arrivant d’une courfe.
Le cheval bien panfé, il faut un peu le faire
troter pour voir s’il ne boîte pas j & en procurant
une bien bonne nuit au cheval , on affurera fa
fanté & fa confervation.
On doit faire entrer dans le panfement du cheval
la manière de lui préparer fon coucher ( en
fuppofant que l’on n’adopte pas la méthode de
faire tenir les chevaux toujours debout , méthode
qui auroit de grands avantages pour la cavalerie
en campagne , mais qu’il n’eft pas de mon fujet
.de traiter ici ( i) . Si donc on laifle coucher le . he-
val , il eft efientiel de lui donner une litière bien
conditionnée , entre quatre & cinq heures du foir,
en obfervant qu elle foit bien fèche & bien propre.
On peut la coirpofer, foit avec de la paille nouvelle
, foit avec celle qui tombe du râtelier quand
le cheval mange de la paille , foit avec celle qu’on
a pu tirer de la litière de la veille , & qu’on a eu
foin, de faire fécher pendant le jour.
Combien l’on eft éloigné , dans les troupes à
cheval , de fe foumettre à toutes ces précautions,
qui font cependant fi efièntielles l'Prefque toujours
, en revenant des manoeuvres , les troupes
à cheval rentrent leurs chevaux à l’écurie, & les
y lai fient pour aller màngsr la fpupe j d’ailleurs,
quand le cavalier rentre, il eft très-fatigué , & les
commandans oublient trop fouvent , en faifant
manoeuvrer, qu’il faut ménager le cheval pour le
conferver long-tems, & qu'il faut que le cavalier
, en rentrant, ait encore le tems & la force
de bien panfer fon cheval : nouveau moyen infiniment
nécefiairé pour conferver l’animal.
. PAROLE. U y a deux fortes de paroles, l’une,
(i) En Efpagne on ne fait jamais de litière aux
chevaux j aucun cheval de parade ni de fervice n’ofe
fe coucher à l’écurie ; dans celles de cavalerie * on- fait,
nuit & jour, la garde pour l’en empêcher : on prétend
qu la litière rend lés chevaux parefieux & lâches ;
d’ailleurs, pour la cava’érie en campagne . quel dan- f
gér pour les chevaux dé fe coucher dans l’humidité , j
la fange, la boue , &c. Cette manière exige une grande !
propreté dans les écuries, mais y en;re,tient en même j
tems un air bien plus fain 5 car les vapeurs du fumier j
font très-nuifibles. Il faut accoutumer à cet iifage. les ?
poulins. Un cheval qui nefe couche pas, évite les\en- j
chevêtrures, les atteintes, les coups de pieds, l’humidité,
&c. 1
P a s
1 qui ëft un difconrs j l'autre, qui eft une afturance
ou promefie verbale, par laquelle on s’engage de
faire telle ou telle chofe.
La première efpèce de parole étoit fort en ufage
chez les anciens. Si l’on en croit les hiftoriens qui
font pleins des difeours des généraux à leurs fol-
dats, il feroit bien difficile aux généraux modernes
de les imiter par l’impoffibilité où ils feroient
de fe faire entendre 5 ils le bornent aéluerenient
à faire mettre à l’ordre ce qu’ils veulent faire lavoir
à l’armée j il feroit cependant atiflî utile qu’avantageux
à un général & même à tous les officiers
, de favoir parler en public : l’officier particulier
auroit fouvent plus d’occafion d’exercer ce
talent que le général, mais alors, comme dit Montaigne
, « il faut non-feulement que la voix arrive
1 » à ceux à qui l’on parle, mais encore qu’elle les
| ao fiappe & qu’elle les perce : la parole eft moitié
” à celui quUparle , moitié à celui qui l’écoute :
, » celui-ci fe do;t préparer à la recevoir félon le
» branle qu’elle prend. *>
Quant à la fécondé efpèce de parole, elle doit
1 être de tous les. tems & pour tous les hommes,
mais furtout elle doit êtrefacrée pour les hommes
qui commandent aux autres,
j Ainfi l’envie de renvoyer tout le monde con-
j tent ne doit jamais porter les chefs à promettre
] ce qu’ils ne peuvent tenir , parce que leur parole
doit être inviolable.
1 ^ Après la prife d'Ëmmein on voulut perfuader
a Guftav.e-Adolphe que les effets d’un homme qui
av.oit abandonné fon parti & qui avoit attenté à
£* vie , éfioient fujets à confifcation. Non > dit le
roi 5 j’ai donné ma parole 5 je ne veux pas qu’on
puiife me reprocher d’y avoir manqué..
PAS.^ Au.mot Ma r ch e , & à l'ôccafton du.pas
cadencé , nous avons renvoyé au S o ld a t [c itoy en ,
pages^91, 192 & 195, pour y lire ce qui regarde
les aplombs , .qui font la bafe de tous les pas. En
effet j 5 la marche exige qu'avant tout l’on place
l’homme que l’on veut faire marcher, s’il faut déterminer
enfuite le mécanifme du pas, c’eft-à-dire
la manière dont doivent fe faire le mouvement des
pieds & le tranfport du corps ; s’il faut fixer le pas
par rapport fon étendue , le confîdérer auffi par
rapport à fa viteffe; enfin , s’il faut établir l’accord
dés mquvemens dans la marche d’une troupe , dès
que l’homme eft placé , dès qu’il eft bien affermi
fur la pofition de fon cqrps, qu’ il peut, étant
ifole, la conferver long - tems, on doit le faire
paffer aux aplombs , c’eft-à-dire , l’accoutumer &
lui apprendre à s’affermir fur l’une & l’autre jambe
fucceffi ventent, à.y bien prendre & conferver.fon
équilibre , & à acquérir, par ce moyen, le talent
d etre de maître de fon corps , pour pouvoir marcher
enfuite avec plus d’aflurance &,d’aifanée..
_ Ce n’eft donc qu’après avoir inflruit lë.foldat
de pied ferme, qu il faut le faire mouvoir pour
marcher en avant S i faire le pas ordinaire.
PAS
ç. I” .
8 o 5
P a s o r d in a ir e en a v a n t.
Pour marcher en avant, fi l’on veut faire partir
de la jambe gauche, on la fait porter à peu près
un pied en avant, fans que le corps ni la jambe
droite remuent. A mefure que la jambe gauche va
plus avant pour finir le pas, le corps s’incline , le
talon droit fe lève, & le mouvement de la jambe
droite commence pour aller en avant dès que le
pied gauche eft placé. Tel eft le mouvement méthodique
& fucceffif que l’on fait en marchant :
il étoit néceffaire de le foumettre à des principes,
pour des hommes qui doivent exécuter enfemble
& avec précifîon l’aélion de marcher, à laquelle ,
en général, tout être ifolé fait fi peu d’attention.
En inftruifant les nouveaux foldats de la manière
dont ils doivent, faire leurs pas, i f faut que leur
corps refte toujours droit & carrément, que la
tête foit placée, que le jarret fe plie d’abord pour
commencer le mouvement, s'étendre enfuite in-
fenfiblement à mefure qu’on finit le pas, & que le
talon de la jambe qu’on avance , foit à deux pouces
de terre, la pointe du pied à un pouce & demi
du terrein que l’on parcourt.
§. II.
P a s en a rr ié r é .
Le pas en arrière n’eft pas naturel, mais il peut
être utile dans quelques occafions , pourvu qu’on
le marche très-peu uê tems , & qu’on ne le faffe
que d’un pied, en inclinant un peu le corps en
avant.
§. I I I .
P a s o b liq u e .
Le pas oblique ne peut être que très-rarement
utile , & il eft toujours plus lent que les autres ,
quand on veut que le foldat refte carrément en
marchant. Forcé de croiferun peu les jambes , il
faut que l’on faffe un pas très court & l'autre plus
long : fi on les faifoit également longs l’un & l’autre
, le corps , obligé de fuivre le mouvement de
la jambe, obliqueroit bientôt, & ce mouvement
fe cemmuniqueroit à toute la troupe , qui feroit
forcée de n’être plus carrément. Afin donc de ne
pas obliger le corps à obliquer, il faut que la
jambe fur laquelle on croife, forme un pas d’un
pied, tandis que l’autre jambe , qui marche du
côté où l’on oblique , eft portée fur le côté , à
deux pieds au moins, & fuivie par le corps , en
ayant foin de tenir en arrière l’épaule qui eft op-
pofée au côté où l’on marche, afin de conferver
t alignement dans lequel on eft parti.
P A S
§. I V.
J7u p a s en g én é ra l.
Tous ces différens pas peuvent être ou ordinaires
ou redoublés. Ordinaires, on en exécute quatre-
vingts dans une minute j redoublés, cent foixante.
Oh pourroit tripler & quadrupler le pas en avant.
Il y a dés occafions où céla peut être néceffaire ,
& il feroit effentiel d’y exercer fouvent les foldats
élèves. . , .
Les autres pas ne peuvent fe faire que très-difficilement
au pas redoublé. 11 feroit cependant utile
d’exercer les foldats à ces mouvemens, afin de les
exécuter enfuite au pas ordinaire avec plus d’ai-
fance. -
Le pas dujoldat pruffien n’eft que de foixante
& feize à la .minute j et c’eft, on peut dire,Te
feul qu’il connoiffe ; auffi l’exécute-1-il avec une
exaéticude d’où dérive fans doute toute la préci-
fion de leurs manoeuvres} feulement ils l’alongent
quelquefois, mais toujours n’en faifant que le
même nombre dans le même efpace de tems.
Pour accélérer la viteffe de la marche, & pou*
faire arriver en moins de tems les foldats d infanterie
aux objets, ou à défendre ou à attaquer , ne
pourroic^on pas, à l’inftar des Prussiens, l’habituer
à former des pas plus grands? 11 paroit affez
démontré que le voyageur qui parcourt le même
efpace de chemin dans des tems différens, a mis
dé la différence dans fa marche , foit du côté dé
l’accélération dù mouvement, foit auffi du côté du
prolongement de fes pas ; mais ce qui paroît bien
plus fur, c’eft qu’en fe bornant à alonger fes pas,
le voyageur s’eft infiniment moins-fatigué que s’il
avoit préféré l’accélération du mouvement de les
jambes. L’expérience prouveroit bientôt combien
il eft aifé à tous les hommes d’exécuter le pas de
trente pouces au lieu de celui de vingt, & ce feul
changement produiroitle gain de plus de vingt toi-
sss par minute, à faire cent quarante pas redoublés
dans cet efpace de temps.
Il y a dès auteurs militaires qui ont été plus
loin; ils ont defiré .qu’à deux cents pas de l’ennemi,
les foldavs , dans un ordre profond, priffent
la courfe; ils s'appuient fur l’exemple des foldats
légionnaires, qui’, bien plus chargés que les nôtres,
couroient quelquefois à la charge. Us citent le régiment
de Chartres infanterie, qui, dans un camp
à Compïègne, manoeuvra au pas de courfe, dans
le meilleur ordre, pendant plus d’une heure, & il
ne s’agiroit ici de foutenir ce mouvement que l’ef-
: pace d’une minute. Si le fecret de la vi&oire eft
dans L s jambes, comme le dit le maréchal deSaxe,
n’eft-ilpas bien étonnant d’avoir proferit le pas de
courfe de l’exercice de l’infanterie ?
Les mêmes auteurs font encore une réflexion
concernant le pas. On s’eft donné beaucoup de
peine, difent-ils, pour habituer les troupes à marcher
en cadence à la mueue, de l’on croit avoir