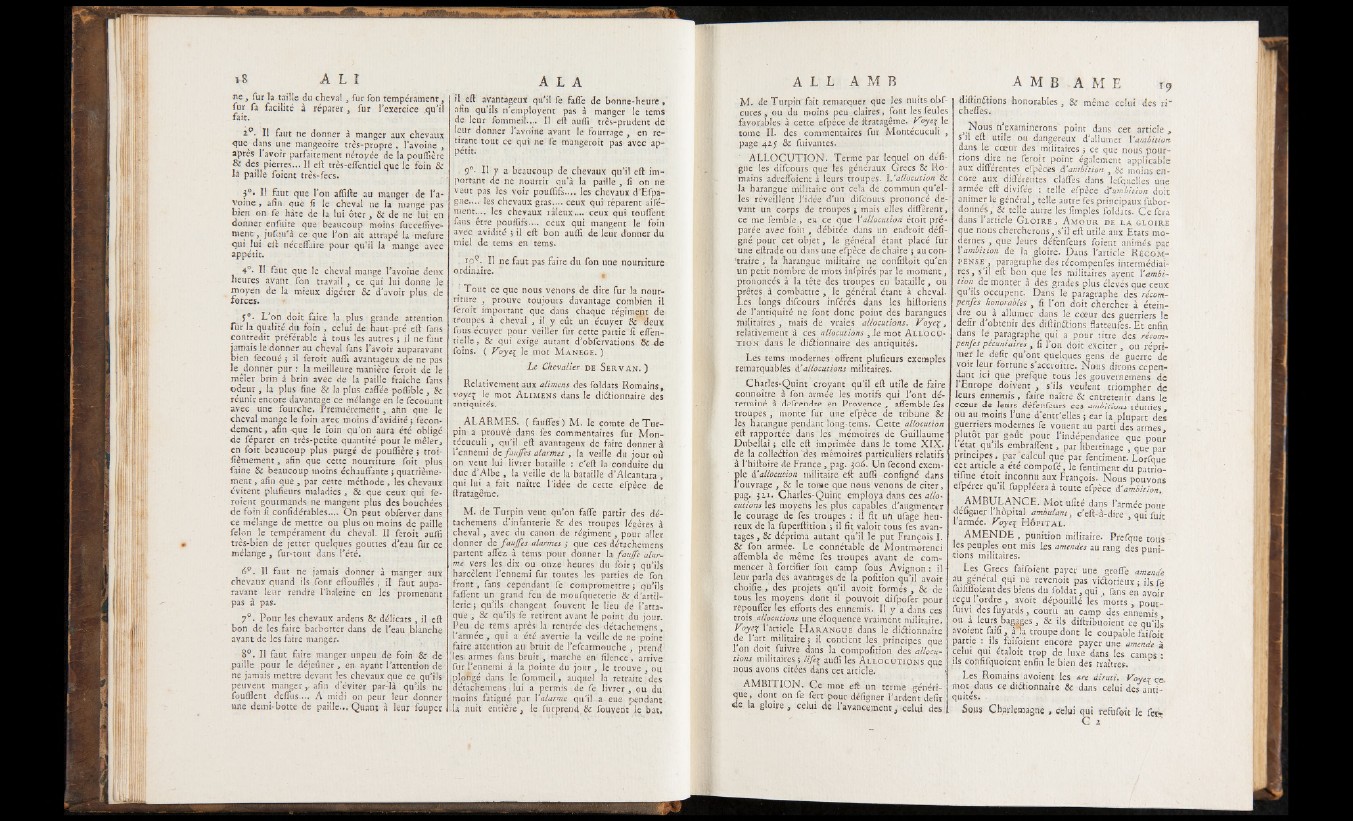
»8 A L I
ne , fur 1a taille du cheval , fur fon tempérament,
fur fa facilité à réparer 3 fur l'exercice .qu'il
fait.
Il faut ne donner à manger aux chevaux
que^ dans une mangeoire très-propre , l’avoine ,
après l'avoir parfaitement nétoyée de la pouflière
& des pierres... Il elt très-effentiel que le foin &
la paille foient très-fecs.
3°. Il faut que l'on aflifte au manger de l'avoine
, afin què fi le cheval ne la' mangé pas
bien on fe hâte de la lui ôter 3 & de ne lui en
donner enfuite que beaucoup moins fuccefîiye-
j jufqu'à ce que l'on ait attrapé la mefure
qui lui elt nécefiaire pour qu'il la mange avec
appétit.
4°* II faut que le cheval mange l’avoine deux
heures avant fon travail , ce qui lui donne le
moyen de la mieux digérer 8c d'avoir plus de
forces.
j ° . L'on doit faire la plus grande attention
fur la qualité du foin , celui de haut-pré eft fans
contredit préférable à tous les autres j il ne faut
jamais le donner au cheval fans l'avoir auparavant
bien fecoué j il feroit aufli avantageux de ne pas
le donner pur : la meilleure manière feroit de le
mêler brin à brin avec de la paille fraîche fans
odeur , la plus fine & la plus caflee poffible 3 &
réunir encore davantage ce mélange en le fecouant
avec Une fourche. Premièrement, afin que le
cheval mange le foin avec moins d’avidité j fecon-
dement, afin que le foin qu'on aura été obligé
de féparer en très-petite quantité pour le mêler,
en foit beaucoup plus purgé de pouflière ; troi-
fièmement, afin que cette nourriture foit plus
faine & beaucoup moins échauffante j quatrièmement
, afin què, par cette méthode , les chevaux
évitent plufieurs maladies, & que ceux qui fe-
roient gourmands ne mangent plus des bouchées
de foin ii confidérables.... On peut obferver dans
ce mélange de mettre ou plus ou moins de paille
félon le tempérament du cheval. II feroit aufli
très-bien de jetter quelques gouttes d'eau fur ce
mélange, fur-tout dans l'été.
6Ç. Il faut ne jamais donner à manger aux
chevaux quand ils .font effoufflés , il faut auparavant
leur rendre l'haleine en les promenant
pas à pas.
7°. Pour les chevaux ardens 8c délicats , il eft
bon de les faire barbotter dans de l’eau hlanche
avant de les faire manger.
8°. Il faut faire manger unpeu de foin 8c de
paille pour le déjeûner , en ayant l'attention de
ne jamais mettre devant les chevaux que ce qti'ils-
peuvent manger,. afin d’éviter par-là qu'ils ne
fouffient demis ... A midi on peur leur donner
une demi-botte de paille... Quant à leur fouper
A L A
il eft avantageux qu'il fe faflfe de bonne-heure,
afin qu'ils n'employent pas à manger le tems
de leur fommeil.... Il eft aufli très-prudent de
leur donner l ’avoine avant le fourrage , en retirant
tout ce qui ne fe mangeroit pas avec appétit.
9°- II y a beaucoup de chevaux qu’il eft important
de ne nourrir qu'à la paille, fi on ne
veut pas les voir pouflifs.... les chevaux d'Efpa-
gne.... les chevaux gras.... ceux qui réparent aifé-
rnent.... les chevaux râleux.... ceux qui touffent
fans être pouflifs.... ceux qui mangent le foiri
avec avidité j il eft bon aufli de leur donner du
miel de tems en tems.
. Il ne faut pas faire du fon une nourriture
ordinaire.
Tout ce que nous venons de dire fur la nourriture
, prouve toujours davantage combien il
feroit important que dans chaque régimept de
troupes à cheval , il y eût un écuyer 8c deux
fous écuyer pour veiller fur cette partie fi eflen-
tielle, & qui exige autant d’obfervations & .de
foins. ( Voyc[ le mot M anege. )
Le Chevalier DE Se r v AN. )
Relativement aux alimens des foldats Romains,,
voyei le mot A limens dans le dictionnaire des
antiquités.
ALARM E S . ( faufles) M. le comte de Turpin
a prouvé dans fes commentaires fur Mon-
técuculi , qu'il eft avantageux de faire donner à
l'ennemi de faujfcs alarmes , la veille du jour où
on veut lui livrer bataille : c ’eft la conduite du
duc d'Albe , la veille de la bataille d'AIcantara ,
qui lui a. fait naître l'idée de cette efpèce de
ftratagême.
M. de Turpin veut qu’on fafle partir des dé-
taehemens d’infanterie & des troupes légères à
cheval, avec du canon de régiment, pour aller
donner de faujfes alarmes ; que ces détachemens
partent aflez à tems pour donner la faujfe alar-
>me vers les dix ou onze heures du foirj qu'ils
harcèlent l'ennemi fur toutes les parties de fon
front, fans cependant fe compromettre j qu’ils
faffent un grand feu de moufqueterie & d'artillerie
j qu’ils changent fouvent le lieu de l ’attaque
, 8c qu’ils fe retirent avant le point du jour.
Peu de tems après la rentrée des détachemens,
l’armée, qui a été avertie la veille de ne point
faire attention au bruit de l’efcarmouche , prend
les. armes fans bruit , marche en filence, arrive
fur l’ennemi à la pointe du jo u r , le trouve , ou
iplofigé dans le fommeil, auquel la retraire des
détachemens lui a permis de fe livrer, ou du
moins fatigué par l‘alarme qu'il a eue pendant
là nuit entière, le furprend,& fouvent le bat.
A L L A M B
M. de Turpin fait remarquer que les nuits obf-
cures, ou du moins peu claires » font les feules
favorables à cette efpèce de ftratagême. Voyelle.
tome II. des commentaires fur Montécuculi ,
page 42J 8c Avivantes.
A L L O C U T IO N . Terme par lequel on défi-
gne les difcôurs que les généraux Grecs & Romains
adreftoient à leurs troupes. L 'allocution &
la harangue militaire ont cela de commun qu'elles
réveillent l’idée d’un difcôurs prononcé devant
un corps de troupesi mais elles different,
ce me femble., en ce que Y allocution étoit préparée
avec foin , débitée dans un endroit défî-
gné pour cet ob jet, le général étant placé fur
une eftrade ou dans une efpèce de chaire -, aucon-
'traire, la harangue militaire ne confiftoit qu’en
un petit nombre de mots infpirés par le moment,
prononcés à la tête des troupes en bataille, ou
prêtes à combattre, le générai étant à cheval.
Les longs difcôurs inférés dans les hiftoriens
de l’antiquité ne font donc point des harangues
militaires, mais de vraies allocutions. Voyeç,
relativement à ces allocutions 3 Je mot A l lo cu t
io n dans le di&ionnaire des antiquités.
Les tems modernes offrent plufieurs exemples
remarquables dJallocutions militaires,.
Charles-Quint croyant qu’il eft utile de faire
connoître à fon armée les motifs qui l’ont déterminé
à defeendre en Provence , aflemble fes
troupes , monte fur une efpèce de tribune &
les harangue pendant long-tems. Cette allocution
eft rapportée dans les mémoires de Guillaume'
Dubellai ; elle eft imprimée dans le tome XIX.
de la collection "des mémoires particuliers relatifs
à l'hiftoire de France, pag. 306. Un fécond exemple
d'allocution militaire eft aufli configné dans
l ’ouvrage , 8c le tome que nous venons de citer,
pag. 3 21. Charles-Quint employa dans ces allocutions
les moyens les plus capables d’augmenter
le courage de fes troupes : il fit ufi ufage heureux
de la fuperftition j il fit, valoir tous fes avantages
, 8c déprima autant qù’il le put François I.
& fon armée. Le connétable de Montmorenci
aflembla de même fes troupes avant de commencer
à fortifier fon camp fous Avignon : il
leur parla des avantages de la pofition qu’il avoit
choifie , des projets qu’il avoit formés , 8c de
tous les moyens dont il pouvoit difpofer pour
repoufier les efforts des ennemis. Il y a dans ces
trois allocutions une éloquence vraiment militaire.
Voye^ l'article H ar angu e dans le dictionnaire
de 1 art militaire j il contient les principes que
l’on doit fuivre dans la composition des allocu- ;
tions militairesfc â jg jaufli les A l lo cu tio n s que’
nous avons citées dans cet article. ?
AM B IT IO N . C e mot eft un terme générique,
dont on fe fert pour défigner l’ardent‘défir
c e la g lo ire, celui de l’avancement, celui des
A M B A M E 19
diftinCtions honorables, 8c même celui des ri"
chefifes.
Nous n’examinerons' point dans cet article ,
s’il eft utile ou dangereux d’allumer l'ambition
dans le coeur des militaires j ce que nous pourrions
dure, ne feroit point également applicable
aux différentes ëfpèces & ambition . & moins encore
aux différentes claffes dans lefquelles une
armée eft divifée : telle efpèce d'ambition doit
animer le general , telle autre fes principaux fubor-
donnéSj & telle autre les (impies foldats! C e fera
dans 1 article Gl o ir e . A m ou r de l a gloire
que nous chercherons, s’il eft utile aux Etats modernes
, que Jeuts défenfeurs foient animés par
l’ambition de la gloire. Dans l’article R é com pense
. paragraphe des récompenfes intermédiaires.
s il eft bon que les militaires ayent l'ambi-
ti°n dé monter à des grades plus élevés que ceux
qu ils occupent. Dans le paragraphe des récompenfes
honorables , fi l’on doit chercher à éteindre
ou a allumer dans le, coeur des guerriers le
défît d’obtenir des diftinâions flatteufes. Et. enfin
dans lé paragraphe, qui a pour titre des rêcom-
penfes pécuniaires | fi l’on doit exciter , ou réprimer
le defir qu’ont quelques gens de guerre de
voir leur fortune s’accroître. Nous dirons ceperr-
dant ici que prefque tous les gouvernemens de
j Europe doivent . s’ils veulent triompher de
leurs ennemis , faire naître & entretenir dans le
coeur de leurs défenfeurs ces ambitions réunies ,
ou au moiris l’une d’entr’elles ; car la plupart des
guerriers modernes fe vouent au parti des armes,
plutôt par goût pour l’indépendance que pour
1 état qu’ils embraffent, par libertinage , que par
principes, par calcul que par fentiment. Lorfque
cet article a cte compofé, le fentiment du patriot
e etoit inconnu aux François. Nous pouvons
efpérer qu’il fuppléera à toute efpèce d‘ambition.
AM B U L A N C E . Mot ufité dans l’ armée pour
defigner l’hôpital ambulant, c’eft-à-dire-, qui fuit
1 armee. Viye{ H ô p it a l .
AM E N D E , punition militaire. Prefque tous -
les peuples ont mis les amendes au rang des punitions
militaires.
Les Grecs faifoienc payer une grofle amende
au général qui né reVenoit pas viâorieux ; iis fe
faififloient des biens du foldat, q u i, fans en avoir
reçu 1 ord re, avoit dépouillé les morts, pour-
fuivt des fuyards, couru au camp des ennemis
ou a leurs bagages, & ils diftribuoient ce qu’ils
avotent faifi, àTa troupe dont le coupable faifoit
partie : jR faifoient encore payer une amende à
celui qui etaloit trop de luxe dans les camps *
ils confifquoiént enfin le bien des traîtres. v
Les Romains avoient les are diruti. Voyer ce.
mot dans ce diélionnaire & dans celui des antiquités.
Sous Charlemagne , celui qui refufoit le fetr