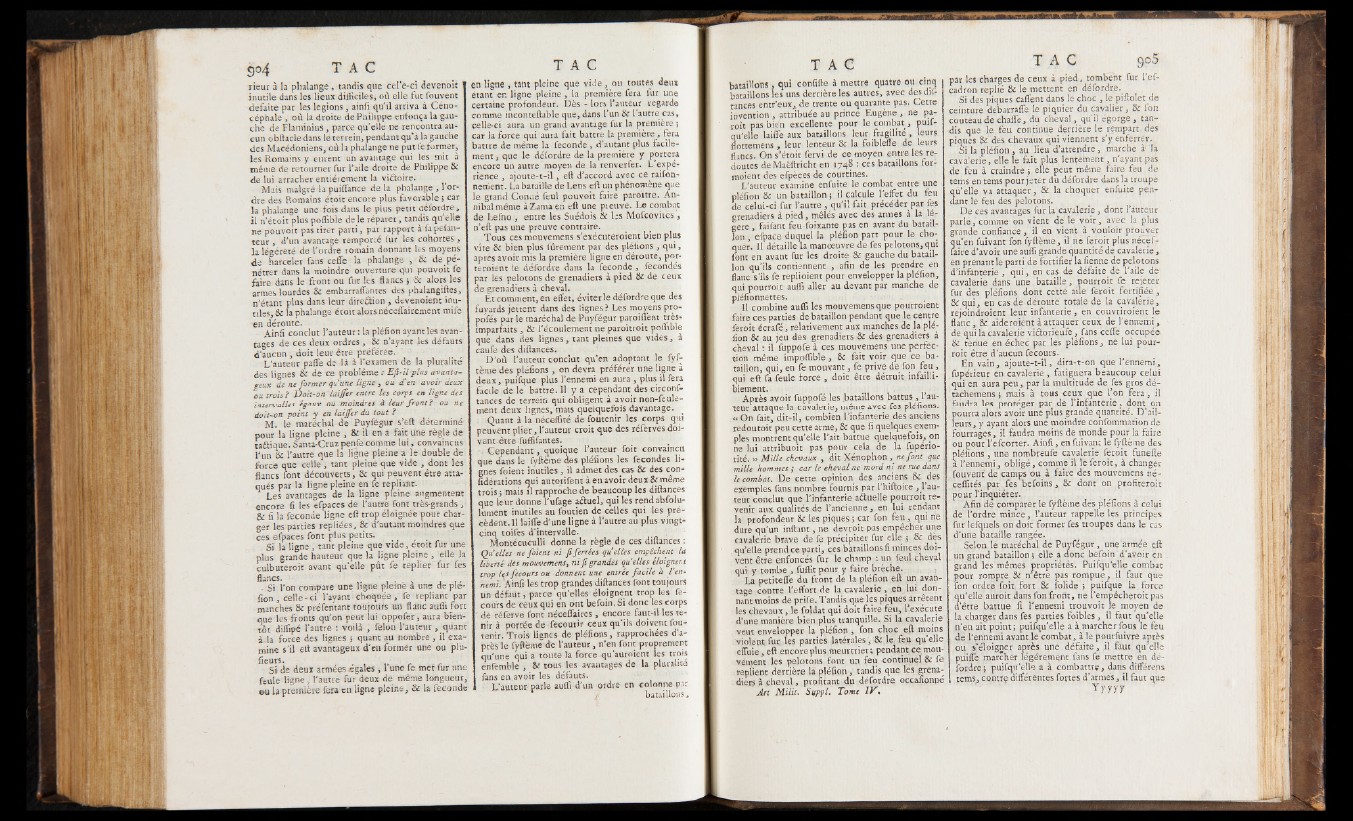
ge>4 T A C
rieur à la phalange, tandis que cel'e-ci devenoit
inutile dans les lieux ditïàciles, où elle fut fouvent
défaite par les légions, ainfi qu'il arriva à Céno-
çéphale , où la droite de Philippe enfonça la gauche
de Flaminius, parce qu’elle ne rencontra aucun
obftacle dans le terrein, pendant qu'à la gauche
des Macédoniens, où la phalange ne put le former j
les Romains y eurent un avantage qui les mit à
même de retourner fur l’ aile droite de Philippe &
de lui arracher entièrement la viétoire.
Mais malgré la puiffance de la phalange, l’ordre
des Romains étoit encore plus favorable j car
la phalange une fois dans le plus petit défordre,
il n’étoit plus pofliple de le réparer, tandis qu elle
ne pouvoir pas tirer parti, par rapport à fa pefan-
teur , d’ un avantage remporté lur les cohortes ,
la légéreté de l’ ordre romain donnant les moyens
de harceler fans celîe la phalange , & de pénétrer
dans la moindre ouverture qui pouvoit fe
faire dans le front ou fur les flancs ; & alors les
armes lourdes & embarraffantes des phalangiftes,
n’étant plus dans leur direction , dcvenoient inutiles,
& la phalange étoit alors néceffairement mife.
en déroute.
Ainfi conclut l’auteur : la pléfion ayant les avantages
de ces deux ordres , & n’ayant les défauts
d’aucun, doit leur être préférée.
L ’auteur paffe de là à l’ examen de la pluralité
des lignes & de ce problème Eft-ilplus avantageux
de ne former qu’une ligne , ou £ en avoir deux
ou trois ? Doit-on laijfer entre lés corps en ligne des
intervalles égàux ou moindres à leur front ? ou ne
doit-on point y en laijfer du tout ? „ !
M. le maréchal de Puyfégur s’eft déterminé
pour la ligne pleine , & il en a fait une règle de
taétique. Santa-Cruz penfe comme lu i, convaincus
l ’ un 8c l’autre que la ligne pleine à le double de
force que ce lle , tant pleine que vide , dont les'
flancs font découverts, & qui peuvent être attaqués
par la ligné pleine en fe repliant.
n Les avantages de la ligne pleine augmentent
encore fl les efpaces de l’autre font très-grands,
& fi la fécondé ligne eft trop éloignée pour charger
les parties repliées, & d’autant moindres que
ces efpaces font plus petits. ; .
Si la ligne, tant pleine que vide, etoit fur une
plus grande hauteur que la ligne pleine, elle la
culbuteroit avant quelle pût fe replier fur fes
flancs. " « : , , „ c , . , ,
- Si l’on compare une ligne pleine a une de pléfion,
celle-ci l'ayant choquée, fe repliant par
manches & préfentant toujours un flanc aufli fort
que les fronts qu’on peut lui oppofér, aura bientôt
diflipé l’autre : voilà , félon l’auteur . quant
à la force des lignes ; quant au nombre, il examine
s’il ett avantageux d'en former une ou plu-
fieurs.
Si de deux armées é g a le s , 1 une fe met fur une
feule ligne, l’autre fur deux de même longueur,
eu la première fera en ligne pleine, Sc la fécondé
T A C
en ligne, tant pleine que v id e , ou toutes deux
étant er. ligne pleine, la première fera fur une
certaine profondeur. Dès - lors l’auteur regarde
comme inconteûable que, dans l'un & l ’autre cas,
celle-ci aura un grand avantage fur la première j
car la force qui aura fait battre la première, fera
battre de même la fécondé, d’autant plus facilement
, que le défordre de la première y portera
encore un autre moyen de la renverfer. L expérience
, ajoute-t-il, eft d'accord avec ce raifon-
nenient. La bataille de Lens eft un phénomène que
le grand Conué feul pouvoit faire paroïtre. An-
nibalmême àZamaen eft une pteuve. Le combat
de Lefno , entre les Suédois & las Mofcovitês,
n’eft pas une preuve contraire.
Tous ces mouvemens s’exécuteroient bien plus
vite & bien plus fûrement par des pléfions , qui,
après avoir mis la première ligne en déroute, por-
teroient le défordre dans la fécondé , fécondés
par les pelotons de grenadiers à pied & de ceux
de grenadiers à cheval.
Et comment, en effet, éviterle défordre que des
fuyards jettent dans des lignes ? Les moyens pro-
pofés par le maréchal de Puyfégur paroiuent très-
imparfaits , & l’ écoulement ne paroîtroit poflible
que dans des lignes, tant pleines que vides , à
caufe des diftances.
D ’où l’auteur conclut qu’ en adoptant le fyf-
tème des pléfions, on devra préférer une ligne à
deux, puifque plus l'ennemi en aura, plus il fera
facile de le battre. Il y a cependant des circonf-
tances de terrein qui obligent à avoir non-feulement
deux lignes, mais quelquefois davantage.
Quant à la néceffité de foutenir les corps qui
peuvent plier, l’auteur croit que des réferves doivent
être fuffifantes.
I-i Cependant, quoique l’auteur foit convaincu
que dans le fyftème des pléfions les fécondés lignes
foient inutiles, il admet des cas & des con-
fidérations qui autorifent à en avoir deux 8çmême
trois t mais il rapproche de beaucoup les diftances
que leur donne l’ ufage aéfuel, qui les rend abfolu-
lument inutiles au foutien de celles qui les précèdent.
1) laide d’une ligne à l’autre au plus vingt-
cinq toifes d’ intervalle.
Montécuculli donne la règle de ces diftances :
Qu’elles ne foient ni fi ferries quelles empêchent la
liberté des mouvemens, ni f i grandes quelles éloignent
trop les fecours ou donnent une entrée facile à l ’ennemi.
'Ainfi les trop grandes diftances font toujours
un défaut, parce qu’elles éloignent trop les fe-
cohrs de ceux qui en ont befoin. Si donc les corps
' de réferve font néceffaires, encore faut-il les tenir
à portée dé recourir ceux qu’ ils doivent fop-
tenir. Trois lignes de pléfions, rapprochées d’après
le fyftème de l’auteur, n’ en font proprement
qu’une qui a toute la force qu’auroient les trois
enremble , & tous les avantages de la pluralité
fans en.avoir les défauts.
L'auteur parle aufli d'un ordre en colonne par
bataillons,
T A C
bataillons, qui confifte à mettre quatre ou cinq
bataillons les uns derrière les autres, avec des diftances
entr’eux, de trente ou quarante pas. Cette
invention , attribuée au prince Eugène, ne pa-
roît pasbién excellente pour le combat, puif-
qu'elle laiüe aux bataillons leur fragilité, leurs
flottemens, leur lenteur & la foiblefl'e de leurs
flancs. On s’étoit fervi de ce moyen entre les redoutes
de Maëftricht en 1748 : ces bataillons for-
moient des efpèces de courtines.
L'auteur examine enfuite le combat entre une
pléfion & un bataillon 5 il calcule l'effet du feu
de celui-ci fur l'autre, qu'il fait précéder par fes
grenadiers à pied, mêlés avec des armes à la légère,
faifanç feu foixante pas en avant du bataillon,
efpace duquel la pléfion part pour le choquer.
Il détaille la manoeuvre de fes pelotons, qui
font en avant fur les droite & gauche du bataillon
qu'ils contiennent. , afin de les prendre en
flanc s'ils fe replioient pour envelopper la pléfion,
qui pourroit aufli aller au devant par manche de
piéfionnettes.
11 combine aufli les mouvemens que pourroient
faire ces parties de bataillon pendant que le. centre
feroit écrafé, relativement aux manches de la pléfion
& au jeu des grenadiers & des grenadiers à
cheval : il fuppofe à ces mouvemens une perfection
même impoflible , & fait voir que ce bataillon,
qui, en fe mouvant, fe prive de fon feu ,
qui eft fa feule fo rc e , doit être détruit infailliblement.
. , |}
Après avoir fuppofé les bataillons battus, 1 auteur
attaque la cavaletie, même avec fes pléfions.
«On fait, dit-il, combien l ’infanterie des anciens
redoutoit peu cette arme, & que fi quelques exemples
montrent qu'elle l’ait battue quelquefois, on
ne lui attribuoit pas pour cela de la fupério-
rité. » Mille chevaux , dit Xénophon , ne font que
mille hommes ; car le cheval ne mord, ni ne rue dans
le combat. De cette opinion des anciens & des
exemples fans, nombre fournis par l'hiftoire , l'au- ‘
teur conclut que l'infanterie actuelle pourroit re- ;
venir aux qualités de l'ancienne, en lui rendant;
la profondeur & les piques ; car fon feu , qui nei
dure qu'un inftant, ne devroit pas empêcher une
cavalerie brave de fe précipiter fur elle ; & dès
qu’elle prend ce parti, ces bataillons fi minces doivent
être enfoncés fur le champ : un feul cheval
qui y tom b e fu ffit pour y faire brèche.
La. petiteffe du front de la pléfion eft un avantage
contre l'effort de la cavalerie, en lui donnant
moins de prife. Tandis que les piques arrêtent
les chevaux, le foldat qui doit faire feuy 1 exécute
d'une manière bien plus tranquille., Si la cavalerie
veut envelopper la pléfion, fon choc eft moins
violent fui- lçs parties latérales , le fe-q qu'elle
efluie, eft encore plus.meurtrier; pendant ce, mou-
vévqent les pelotons font un feu continuel & fe
replient derrière là pléfion, tandis que les grenadiers
à cheval, profitant. d,u défordre occafionné
An Milit. Suppl. Tome IV .
T A C go5
par les charges de ceux à pied, tombent fur l’ef-
cadron replié & le mettent en défordre.
Si des piques caffent dans le choc , le piftolet de
ceinture débarraffe le piquier du cavalier, & fon
couteau de chaffe, du cheval, qu’il égorge, tandis
que le feu continue derrière le rempart des
piques & des chevaux qui viennent s'y enferrer.
Si la pléfion, au lieu d'attendre, marche à' la
cavalerie, elle le fait plus lentement, n’ayant pas
de feu à craindre ; elle peut même faire feu de
tems entems pour jeter du défordre dans la troupe
qu'elle va attaquer, & la choquer enfuite pendant
le feu des pelotons.
De ces avantages fur la cavalerie, dont l’auteur
parle, comme on vient de le voir, avec la plus
grande confiance, il en vient à vouloir prouver
qu’en fuivant fon fyftème, il ne feroit plus nécef-
faire d’avoir une aufli grande quantité de cavalerie,
en prenant le parti de fortifier la fienne de pelotons
d’infanterie, qui, en cas de défaite de l'aile de
cavalerie dans une bataille , oourroit fe rejeter
fur des pléfions dont cette aile feroit fortifiée ,
& qui, en cas de déroute totale de la cavalerie,
.rejoindroient leur infanterie, en couvriroient le
f la n c a id e r o i e n t â attaquer ceux de l'ennemi,
de qui la cavalerie vi&orieufe, fans ceffe occupée
& tenue en échec par les pléfions, ne lui pourroit
être d’aucun fecours.
En vain, ajoute-t-il, dira-t-on que l'ennemi,
fupérieur en cavalerie, fatiguera beaucoup celui
qui en aura peu, par la multitude de fes gros dé-
tachemens; mais à tous ceux que fon fera, il
faudra, les protéger par de l’infanterie, dont on
pourra alors avoir une plus grande quantité. D’ailleurs,
y ayant alors une moindre confommation de
fourrages, il faudra moins de monde pour la faire
ou pour l'efcorter. Ainfi, en fuivant le fyftème des
pléfions , une nombreufe cavalerie feroit funefte
à l’ennemi, obligé, comme il le feroit, à changer
fouvent de camps ou à faire des mouvemens né-
çeflités par fèsb e fo in s , & dont on profiterait
pour l'inquiéter.
Afin de comparer le fyftème des pléfions à celui
de l’ordre mince, l’auteur rappelle les principes
fur lefquels on doit former fes troupes dans le cas
d'une bataille rangée.
Selon le maréchal de Puyfégur, une armée eft
un grand bataillon; elle a donc befoin d’avoir en
grand les mêmes propriétés. Puifqu’elle combat
pour rompre & n'être pas rompue, il faut que
fon ordre, foit fort & folide ; puifque la force
qu'elle auroit dans fon front, ne l empêcheroit pas
d’être battue fi l'ennemi trouvoit le moyen de
la charger dans fes parties foibles , il faut qu'elle
n’en ait point; puifqu'elle a à marcher fous le feu
de l'ennemi avant le combat, à le pour Cuivre après
ou s'éloigner après une défaite, il faut qu'elle
puiffe marcher légèrement fans fe mettre en dé-
for'dre; puifqu’elle a à combattre, dans différens
tems, contrç différentes fortes d’ armés, il faut que