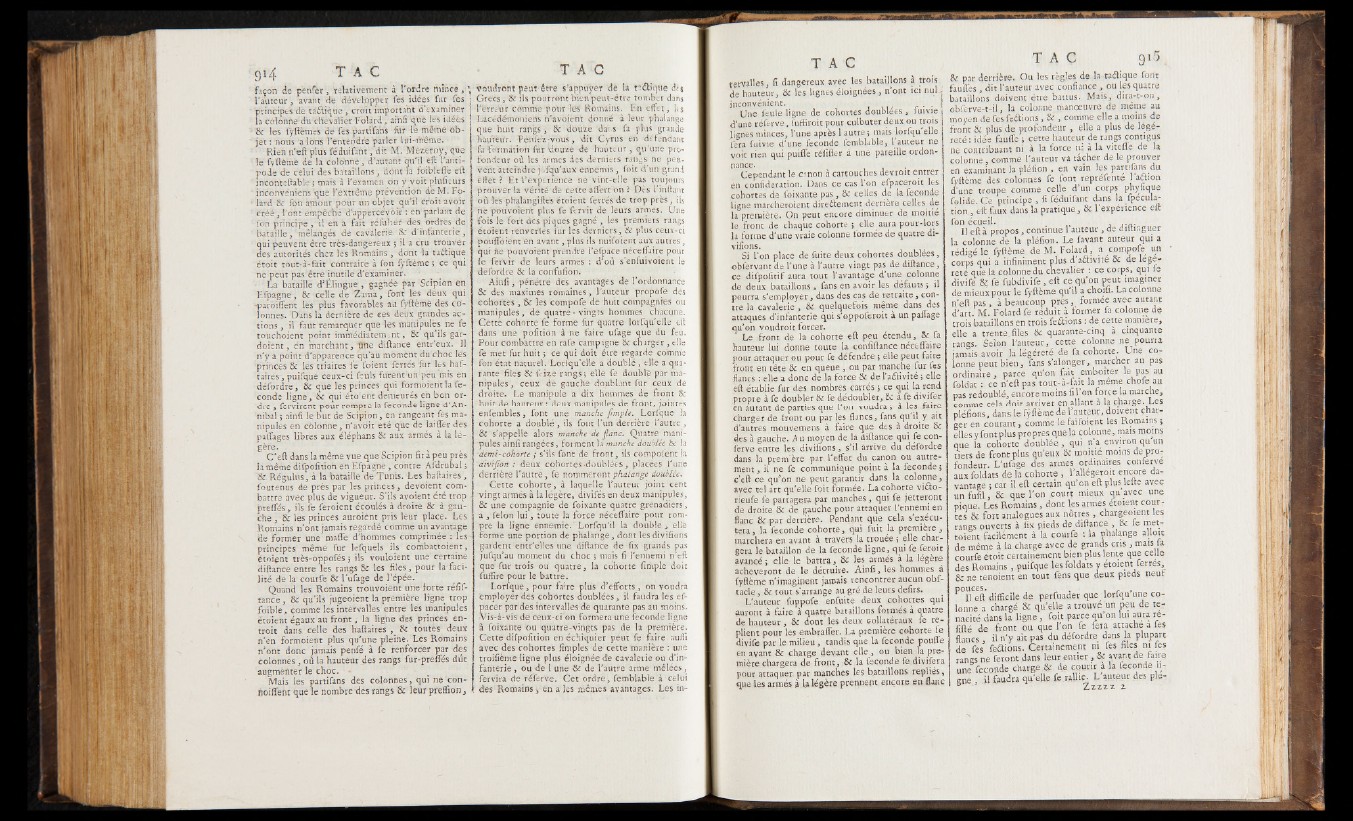
914 TAC
façon de penfer, relativement à l’ordre minee, ^
l’ auteur , avant de développer fes idées fur fes
principes de ta&ique , croit important d’examiner
la colonne du chevalier Folard, aiïifî que les idées
8c les fyftèmes de fes partisans fur lé même objet
: nous 'a lotis l’éntèndrè parler lui-même.
Rien n’eft plus féduifant, dit M. Mexetoy, que
le fyftème de la colonne, d’autant qu’il eft l’antipode
de celui des bataillons , dont la foibleffe eft
inconteftable 5 mais à l’examen on y voit plufieurs
inconvéniens que l’extrême prévention dè M. Fo*
lard 8c fon amour pour Un objet qu’il croit a voir
créé j Font empêché d’apperce’ÿôir : en parlant de
fon principe , ‘il en a fart réfulier des ordres de
bataille, mélangés de cavalerie & d'infanterie 3
qui peuvent être très-dangereux 5 il a cru trouver
des autorités chez les Romains, dont la taéfique
étoit tout-à-fait contraire à fon fyftème > ce qui
ne peut pas être inutile d’examiner.
- La bataille d’Éîingue , gagnée par Scipion en
Efpagne, &• celle de Zàma, font les deux qui
~paroi(Tent les plus favorables au fyftème des colonnes.
Dans la dernière de ces deux grandes actions
, il faut remarquer que les manipulés ne fe
touchoient point immédiatement, 8c qu’ils gar-
doient, ën marchant 3 fine diftance ëritrèux. Il
n’y a point d’apparence qu’au momènt du choc lés
princes & les triaires fe foient ferrés fur les haf- i
taires'j puifqüe ceux-ci feuls furent uh peu mis en
défordre, 8c que les princes qui formoientla fe- ■
conde ligne, Ôc qui éto ent demeurés eh bon ordre
, fervirent pour rompre la fécondé ligne d’An-
nibal 5 ainfi le but de Scipion, en rangeant fes manipules
en colonne, n’avbit été que de laiffer des
palfages libres aux éléphans & aux armés à la lé-1
gère. ■ x ' ‘ , ;
C ’ eft dans la même vue que Scipion fit a peu près
la même difpofition en Efpagne, contre Afdrubal 3
& . Régulus, à la bataille de Tunis. Les haftaires,
foutenus de près par les princes, dévoient combattre
avec plus de vigueur. S’ils avoient été trop -
preffés y ils fe feroient écoulés à droite 8c à gauche
, & les princes auroient pris leur place. Les
Romains n’ont jamais regardé comme un avantage
de Former une mafl'e d’hommes comprimée V ie s -
principes même fur lefquels ils combattoient,
étoient très-oppofés 3 ils vouioient une certaine
diftance entre les rangs & les files, pour la facilité
de la courfe 8c l’ufage de l ’épée.
Quand les Romains trouvoient une forte réfif-
tance, 8c qu’ils jugeoient la première ligne trop
Jfoîble, comme les intervalles entre les manipules
étoient égaux au front, la ligne des princes én-
troit dans celle des haftaires , 8c toutes deux
n’ en formoient plus qu’ une pleine. Les Romains
n’ ont donc jamais penfé à fe renforcer par des
colonnes, où la hauteur des rangs fur-preffés dût
augmenter le choc. -
Mais les partifans des colonnes, qui ne con-
poiffent que le nombre des rangs 8c leur preflion,
T A C
voudront peut-être s’appuyer de la r étique de $
Grecs, 8c ils pourront bien peut-être tomber dans
Terreur comm‘e pour les Romains. En effet, k$
Lacédémoniens n’avoieht donné à leur phalange
que huit rangs , 8e douze dar.s fa plus grande
haiftëur. -Pênféz;vous, dît Cyrus en défendant
fa Formation for douze de hauteur, qu’une profondeur
où les armes des derniers rangs ne peu-
vë'n'tatteindre-jù:fqu’aux ennemis, foit d’un grand
effet ? Et l’ expérience ne vint-elle pas toujours
prouver la vérité de cette afferron l Dès i’inüant
où les phalangiftes étoient ferrés de trop près, ils
né poùvôîent plus fe fervir de leurs armes. Une
fois le fort des piques gagné , les premiers rangs
étoient renvertës inr les derniers, & plus ceux-ci
poufioient en avant, plus ils nuifoient aux autres,
qui ne pouvoient prendre l’efpace néceffaire pour
fe ferVir de leurs armes : d’où s’enfüivoient le
defordre & la confufîon.
Ainfi 3 pénétré des avantages de l’ordonnance
& des maximes romaines, Fauteur propofe des
cohortes , 8c les compofe de huit compagnies ou
manipules, de quatre-vingts hommes chacune.
Cette cohorte fe forme fur quatre lorfqifelle eft
dans une pofition à ne faire ufage que du feu.
Pour combattre en rafe campigne & charger, elle
fe met fur huit 5 ce qui doit être regardé comme
fon état naturel. Lorfqu’ elle a doublé , elle a quarante
files 8c feize rangs; elle fe double par manipules,
ceux de gauche doublant fur ceux de
droite. Le manipule a dix hommes de front 8c
huit de hauteur : deux manipules de front, jointes
enfembles, font une manche fimple. Lorfque la
cohorte a doublé, ils font l’un derrière• l’autre ,
& s’appelle alors manche de flanc. Quatre manipules
ainfi rangées, forment la manche doublée bc la
demi-cohorte 3 s’ ils font de front, ils compofent la
divifton : deux cohortes doublées, placées l’ une
derrière l’autre, fe nommeront phalange doublée.
Cette cohorte, à laquelle Fauteur joint cent
-vingt armés à la légère, divifés en deux manipules,
8c une compagnie de foixante quatre grenadiers,
a , félon lui, toute la force néceffaire pour rompre
la ligne ennemie. Lorfqu’il la double j elle
forme une portion de phalange, dont les divifîons
gardent entr’elles une diftance de fix grands pas
jufqu’au moment du choc ; mais fi l’ennemi n’eft
que fur trois ou quatre, la cohorte firhple doit
fuffire pour le battre..
Lorfque, pour faire plus d’ efforts, on voudra
employer des cohortes doublées, il faudra les ef-
paeer par des intervalles de quarante pas au moins.
Vis-à-vis de ceux-ci on formera une fécondé ligne
à foixante ou quatre-vingts pas de la première.
Cette difpofition en échiquier peut fe faire auffi
avec dès cohortes fimples de cette manière : une
troifième ligne plus éloignée de cavalerie ou d’infanterie,
ou de 1 une & de l’ autre arme mêlées,
fervira de ré fer Ve. Cet ordre, femblable à celui
dés Romains y en a les mêmes avantages. Les intervalles,
fi dangereux avec les batailjons à trois
de hauteur, & les lignes éloignées, n’ont ici nul-j
inconvénient. ■ • • . .
Une feule ligne de cohortes doublées, luivie
d’une réferve, fuffiroit pour culbuter deux ou trois
lignes minces, l’une après 1 autre 5 mais lorfqu elle
fera fuivie d’une fécondé femblable, l’auteur ne
voit rien qui puiffe rélî'fter à une pareille ordonnance.
.
Cependant le canon à cartouches devroit entrer
en confédération. Dans ce cas 1 on efpaceroit les
cohortes de foixante pas, 8c celles de la fécondé
ligne marcheroient dire&ement derrière celles de
la première. On peut encore diminuer de moitié:
je. front de chaque cohorte 3 elle aura pour-lors
la forme d’une vraie colonne torméë de quatre divifîons.
Si l’on place de fuite deux cohortes doublées,
obfervant de l’ une à l’autre vingt pas de diftance, j
ce difpofitif aura tout l’avantage d’une colonne
de deux bataillons, fans en avoir les défauts 5 il
pourra s’employer, dans des cas de retraite, contre
la cavalerie, 8c quelquefois meme dans des
attaques d’infanterie qui s’oppoferoit à un paffage
qu’on voudroit forcer.
Le f front de la cohorte eft peu étendu, 5 c fa
hauteur lui donne toute la -confiftance neeeffaire
pour attaquer ou pour fe défendre 3 elle peut faire
front en tête 8c en queue , ou par manche fur fes
flancs : elle a donc de la force & de 1 activité 3 elle
eft établie fur des nombres carrés 5 ce <^ui la rend
propre à fe doubler 8c fe dédoubler, 8c a fe divifer
en autant de parties que l’ on voudra 3 a les faire
charger de front ou par les flancs, fans qu il y ait
d’autres mouvemens a faire que des a droite 8c
des à gauche. A u moyen de la diftance qui fe con-
ï'erve entre les divifions, s’ il arrive du defordre
dans la prem ère par», l’effet du canon ou autrement,
il ne fe communique point à la fécondé 3
c’eft ce qu’on ne peut garantir dans la colonne,
avec tel art qu’elle foit formée. La cohorte viéto-
rieufe fe partagera par manches, qui fe jetteront
de droite 8c de gauche pour attaquer l'ennemi en
flanc 8c par derrière. Pendant que cela s’exécutera
, la fécondé cohorte, qui fuit la première,
marchera en avant à travers la trouée 3 elle chargera
le bataillon de la fécondé ligne, qui fe feroit
avancé 3 elle le battra, 8c les armés a la légère
achèveront de le détruire. Ainfi, les hommes à
fyftème n’ imaginent jamais rencontrer aucun obf-
tacle, 8c tout s’ arrange au gré de leurs defirs.
L’auteur fuppofe enfuite deux cohortes qui
auront à faire à quatre bataillons formés à quatre
de hauteur, 8c dont les deux collatéraux fe replient
pour les embraffer. La première cohorte fe
divife par le milieu, tandis que la fécondé pouffe
en avant 8c charge devant elle , ou bien la première
chargera de front, 8c la fécondé fe divifera
pour attaquer, par manches les bataillons repliés,
que les armés à la légère prennent encore en flanc
8c par derrière. Ou les règles de la taéhque font
fauffes , dit Fauteur avec confiance, ou les quatre
bataillons doivent être battus. Mais, dira-t-on,
obferve-t-il, la colonne manoeuvre de même au
moyen de fes fe r io n s , 8c , comme elle a moins de
front 8c plus de profondeur, elle a plus de légèreté:
idée fauffe 3 cette hauteur de rangs contigus
ne contribuant ni à la force ni a la vitefle de la
colonne, comme l’auteur va tacher de le prouver
en examinant la pléiion , en vain les partifans du
I fyftème des colonnes fe font reprefente 1 action
d’une troupe comme celle d un corps phyfîque
folide. Ce principe , fi féduifant dans la fpecula-
tion., eft faux dans la pratique, 8c l'expérience eft
fon écùeil. ,>n.
Il eft à propos, continue 1 auteur, de diltinguer
la colonne de la pléfion. Le favant auteur qui a
rédigé le fyftème de M. Folard, a compofe un
corps qui a infiniment plus d aétivite 8c de legé-
reté que la colonne du chevalier : ce corps, qui fe
divife 8ç fe fubdivife, eft ce qu’on peut imaginer
de mieux pour le fyftème qu’il a choifi. La colonne
n’eft pas , à beaucoup près, formée avec autant
d’art. M. Folard fe réduit à former fa colonne de
trois bataillons en trois feétions : de cette maniéré,
elle a trente files 8c quarante-cinq a cinquante
rangs. Selon Fauteur, cette colonne ne pourra
jamais-avoir la légéreré de fa cohorte. Une colonne
peut bien, fans s’alonger, marcher au pas
ordinaire , parce qu’on fait emboîter le pas au
foldat : ce n’ eft pas tout-à-fait la même chofe au
pas redoublé, encore moins fi Fon force la marche,
comme cela doit arriver en allant à la charge. Les
pléfions, dans le fyftème de l’auteur, doivent char-
• ger en courant j comme le faifoienc les Romains ;
; elles y font plus propres que la colonne, mais moins
que la cohorte doublée j qui n a environ qu un
tiers de front plus qu’eux 8c moitié moins de profondeur.
L’ ufage des armes ordinaires conferve
aux foldats de la cohorte , l’allégeroit encore davantage
3 car il eft certain qu’ on eft plus lefte avec
un fufil, 8c que l’ on court mieux qu avec une
pique. Les Romains, dont les armes étoient courtes
8c fort analogues aux nôtres, chargeoient les
rangs ouverts à lix pieds de diftance , 8c fe
toient facilement à la courfe : la phalange all°*c
de même à la charge avec de grands c r is , mais fa
courfe étoit certainement bien plus lente que celle
des Romains , .puifque les foldats y etoient ferres,
8c ne tenoiept en tout fens que deux pieds neut
Il eft difficile de perfuader que lorfqu une colonne
a chargé 8c qu’elle a trouvé un peu de ténacité
dans la ligne, foit parce qu on lui aura re-
fifté de front ou que Fon fe fera attache a fes
flancs , il n’v ait pas du défordre dans la plupart
de fes ferions. Certainement ni fes files m fes
rangs ne feront dans leur entier, 8c avant de faire
une fécondé charge 8c de courir à la fécondé ligne
il Faudra qu’elle.fe rallie. L’auteur des ple-
& ' 7.17 7. 7. 2.