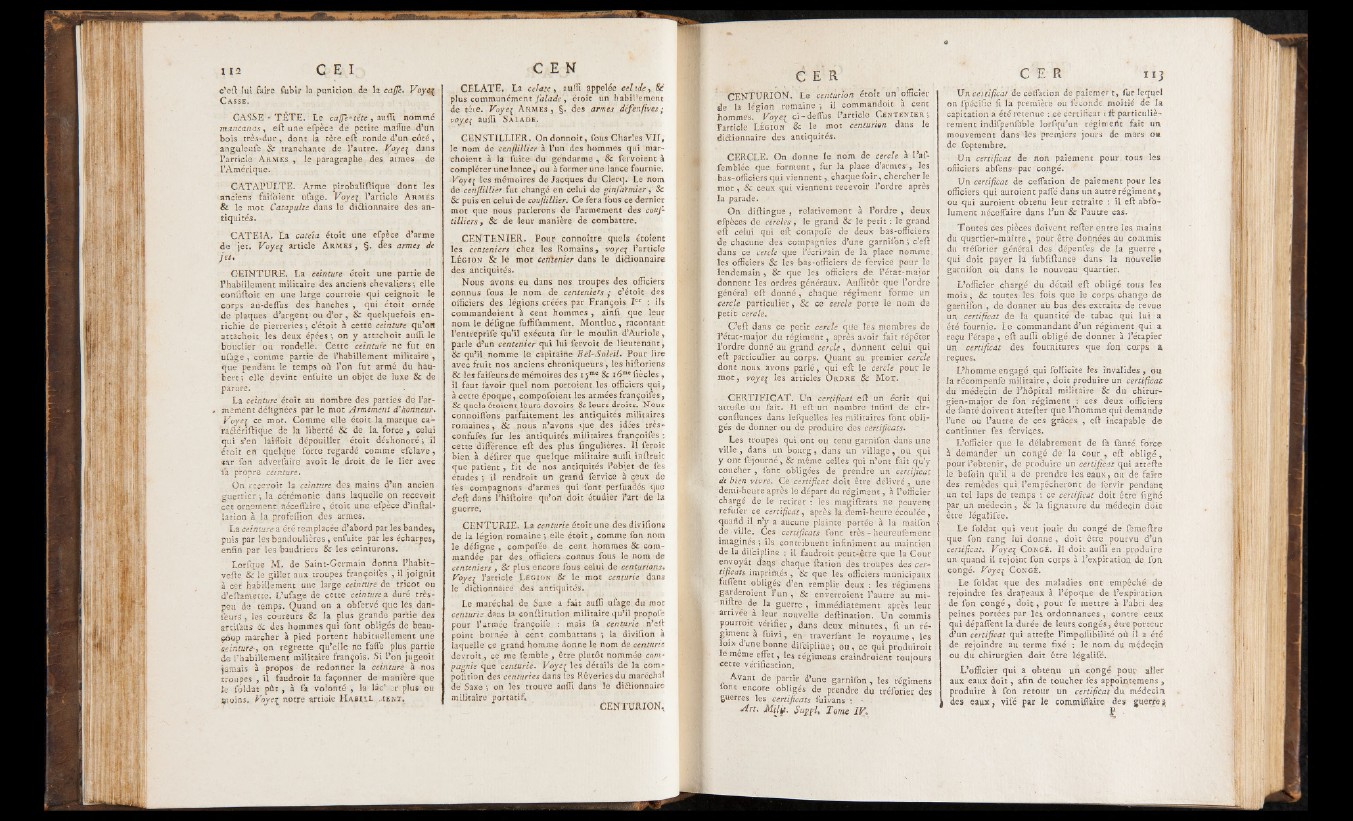
c’eft lui faire fubir la punition de la c a f je . V o y
C asse.
CASSE - TÊTE. Le c a f l e - t é t e , au fit nommé
m 3.nca .na s y eft une efpèce de petite maflue d’un
bois très-dur, dont la tête eft ronde d’un côté,
anguleufe & tranchante de l’autre. V o y c { dans
l’article A rmes , le paragraphe des armes de
l'Amérique.
CATAPULTE. Arme pirobaliftique dont les
anciens faifoient ufage. V o y e \ l’article A rmés
& le mot C a ta p u l t e dans le dictionnaire des antiquités.
CATEÏA. La ca te 'ia étoit une efpèce d’arme
de jet. V o y e [ article Armes, §. des a rm e s de
j e t ,
CEINTURE. La c e in tu r e étoit une partie de
l’habillement militaire des ancien^ chevaliers•> elle
confiftoit en une large courroie qui ceignoit le
corps ati-deffus des hanches , qui étoit ornée
de plaques d’argent ou d’o r , & quelquefois enrichie
de pierreries*, c’étoit à cette c e in tu r e qu’on
attachoit, les deux épées *, on y attachoit aulîï le
bouclier ou rondelle. Cette c e in tu r e ne fut en
ufage , comme partie de l’habillement militaire ,
que pendant le temps où l’on fut armé du haubert
*, elle devint enluite un objet de luxe & de
parure.
La c e in tu r e étoit au nombre des parties de l’armement
défignées par le mot A rm em e n t d? h o n n e u r .
V o y e { ce mot. Comme elle étoit la marque ca-
raélêrifiique de la liberté 8c de la. force , celui
qui s’en laiffoit dépouiller étoit déshonoré*, il
étoit en quelque forte regardé comme efclave,
*ar fon adverfaire avoit le droit de le lier avec
la propre c e in tu r e .
On recevoit la c e in tu r e des mains d’un ancien
guerrier *, la cérémonie dans laquelle on recevoit
cet ornement- néce(faire, étoit une • efpèce d’inftal-
lation à la profellion des armes.
La c e in tu r e a été remplacée d’abord par les bandes,
puis par les bandoulières, enfuite par les écharpes,
enfin par les baudriers & les ceinturons.
Lorfque M. de Saint-Germain donna l’habit-
vefte & le giliet aux troupes françoifes , il joignit
2 cet habillement une large c e in tu r e de tricot ou
d’eftamette. L’ ufage de çette c e in t u r e z duré très-
peu de temps. Quand on a obfervé que les dan-
feurS , les coureurs 8c la plus grande partie des
artilans 8c des hommes qui font obligés de beau-
çôup marcher à pied portent habituellement uné
c e in tu r e - , on regrette qu’ elle ne fade plus partie
de l’habillement militaire françois. Si l’on jugeoit
jamais à propos de redonner la c e in tu r e à nos
troupes , il faudroit la façonner de manière que
le foldat pût, à fa volonté , la lac1’ or plus ou
pleins. V o y e \ notre article Ha b i l l .,ient.
CELATE. La c e l a t e , auffi appelée c e l i d e , &
plus communément J a la d e , étoit un habillement
de têie. V o y e { A rmes, §. des a rm e s d é f e n f îv e s ;
voy.e\ audi Salade.
CENSTILLIER. Ondonnoit, fous Charles VII,
le nom de c e n f i i l l i e r à l’un des hommes qui mar-
choient à la fuite du gendarme , & fervoient à
compléter une lance, ou à former une lance fournie.
les mémoires de Jacques du Clerq. Le nom
de c e n j l i l l i e r fut changé en celui de g in fa Y m ie r , 8c
& puis en celui de c o u f ii l lie r . Ce fera fous ce dernier
mot que nous parlerons de l’armement des co u f--
t i l l i e r s , & de leur manière de combattre.
CENTENIER. Pour connoître quels étoient
les c e n t e n ie r s chez les Romains, v o y e \ l’article
Légion & le mot c e r iten ie r dans le dictionnaire
des antiquités.
Nous avons eu dans nos troupes des officiers
connus fous le nom de c e n t e n ie r s y c’étoit des
officiers des légions créées par François Ier : ils
commandoient à cent hommes, ainfi que leur
nom le déligne fuffifamment. Montluc, racontant
l’entreprile qu’il exécuta fur le moulin d’Auriole,
parle d’un c e n t e n i e r qui lui fervoit de lieutenant,
8c qu’il, nomme le capitaine B e l - S o l e i l . Pour lire
avec fruit nos anciens chroniqueurs , lès hiftoriens
& les faifeurs de mémoires des i jme & iéme liècles ,
il faut lavoir quel nom portoient.les officiers qui,
à cette époque, compofoient les armées françoifes,
& quels étoient leurs devoirs 8c leurs droits. Nous
connoiffons parfaitement les antiquités militaires
romaines, & nous n’avons que des idées très-
confufes lur les antiquités militaires françoifes :
cette différence eft des plus fingulières. Il feroit
bien à défirer que quelque militaire aulfi inftrait
que' patient, fît de nos antiquités l’objet de lès
études *, il rendroît un grand fervice à ceux de
les compagnons d’armes qui font perljiadés que
c’eft dans l’hiftoire qu’on doit étudier l’art de la
guerre.
CENTURIE. La c e n tu r ie étoit une des divifions
de la légion romaine *, elle étoit, comme fon nom
le défigne , compofée de cent homn>es & commandée
par des officiers connus fous le nom de
c e n t e n ie r s , & plus encore fous celui de c e n tu r io n s .
V o y e^ l’article L égion 8c le mot c e n tu r ie dans
le dictionnaire des antiquités.
Le maréchal de Saxe a fait auffi ufage du mot
c e n tu r ie dans la conftitution militaire qu’il propofe
pour l’armée françoife : mais fa c e n tu r ie n’eft
point bornée à cent combattans *, la divifion à
laquelle ce grand homme donne le nom de c e n tu r ie
devrait, ce me femble , être plutôt nommée c om p
a g n ie que " c e n tu r ie . V o y e { les détails de la com-
poïition des c e n tu r ie s dans les Rêveries du maréchat
de Saxe *, on les trouve auffi dans le dictionnaire
militaire portatif..
CENTURION.,
sérnmMMHH
' CENTURION. Le centurion .étoit un officiér
à e la légion romaine *, il commandoit a cent
hommes. V o y e[ c i -d e (lus l’article C e n t e n ie r ;
l’article Légion & le mot centurion dans le
dictionnaire des antiquités.
CERCLE. On donne le nom de cercle a l ’af-
femblée- que.forment, fur la place d’armes', les
bas-officiers qui viennent,. chaque foir, chercher le
mot, & ceux qui viennent recevoir l’ordre après
la parade.
On diftingue , relativement à l’ordre, deux
efpèces de cercles, le grand & le petit : le grand
eft celui qui eft compofé de deux bas-officiers
de chacune des compagnies d’une garnifon.; c’eft
dans ce cercle que l’écrivain de la place nomme,
les officiers & les bas-officiers de fervice pour le
lendemain , & que les officiers de l’état-major
donnent les ordres généraux. Auffitôt que l’ordre
général eft donné, chaque régiment forme un
cercle particulier, & ce cercle porte le nom de
petit- cercle.
C’eft dans ce petit cercle que les membres de
l’état-major du régiment, apres avoir fait répéter
l’ordre donné au grand cercle , donnent celui qui
eft particulier au corps. Quant au. premier cercle
dont nous, avons parlé, qui eft le cercle pour le
mot, voye[ les articles O rdre & M o t .
CERTIFICAT. LTn certificat eft un écrit qui
attefte un fait. Il eft un nombre infini de cir-
conftances dans lefquellès l'es militaires font obligés
de donner ou de produire des certificats.
Les troupes qui .ont ou tenu garnifon dans une
ville, dans un bourg, dans un village, ou qui
y ont féjourné, & même celles qui n’ont fait qu’y
coucher , font obligées de prendre un certificat
de bien vivre. Ce certificat doit être délivré, une
demi-heure après le départ du régiment, à l’officier
chargé de le retirer : les magiftrats ne peuvent
refufer ce certificat, après la demi-heure écoulée,
quaiîd il n’y a aucune plainte portée à la maifon
de ville. Ces certificats font très—heureufement
imaginés *, ils contribuent infiniment au maintien
de la difcipline : il faudroit peut-être que la Cour
envoyât dînas chaque ftation dès troupes des certificats
imprimés , & que les officiers municipaux
fuffent obligés d’en remplir deux : les régimens
garderaient F un , & enverroient l’autre au minière
de la guerre , immédiatement après leur
ai rivée a leur nouvelle deftination. Un commis
pourrait vérifier, dans deux minutes, fi un ré- -
giment a fuivi, en traverfant le royaume, les
loix d une bonne difcipline *, ou, ce qui produiroit
le meme effet, les régimens craindroient toujours
cette vérification.
Avant de partir d’une garnifon, les régimens
lont encore obligés de prendre du tréforier des
guerres les certificats fuivans : - 4 rt. Miljt. Sugpl, Tome IF .
Un c e r t i f i c a t de ceffation de paîemer t, fur lequel
on fpécifiè fi là première ou fécondé moitié de la
capitation a été retenue : .ce certificat t ft particulièrement
indifpenfàble lorfqu’un régiment fait un
mouvement dans les premiers jours de mars- o»
de feptembre.
Un c e r t i f i c a t de non paiement pour, tous les
officiers abfens- par congé. '
Un c e r t if ic a t de ceffation de paiement pour les
officiers qui auroient paffé dans un autre régiment,
ou qui auroient obtenu leur retraite : il eft abfo-
lument néceffaire dans l’un & Fauve cas.
Toutes ces pièces doivent, refter entre les . mains
du quartier-maître, pour être données au commis
du tréforier général des dépenfes de la guerre ,
qui doit payer la fubfiftancè dans ' la nouvelle
garnifon ou dans, le nouveau quartier.
L’officier chargé du détail eft obligé tous les
mois, & toutes les fois que le corps change de
garnifon , de donner au bas dés extraits de revue
un c e r t i f i c a t de la quantité-de tabac qui lui a
été fournie. Le commandant d’un régiment qui a
reçu l’étape , eft auffi obligé de donner à l’étapier
un c e r t i f i c a t des fournitures que fon corps &
reçues.
L’homme engagé, qui foîîicîte les invalides , ou
la récompenfe militaire, doit produire un c e r t i f i c a t
du médecin de l’hôpital militaire & du chirurgien
major de fon régiment : ces deux officiers
de fan-té doivent attefter que l ’homme qui demande
l’une ou l’autre de ces grâces , eft incapable de
continuer fes fervice s,.
L’officier que le délabrement de £a fantê. force
à demander un congé de la cour , eft obligé,
pour l’obtenir, de produire un c e r t i f i c a t qui attefte
le befoin qu’il a de prendre les eaux, ou de faire
des remèdes qui. l’empêcheront de fervir pendant
un tel laps de temps : ce c e r t i f i c a t doit être fighé
par un médecin, & la fignature du médeçin doit
être légaîifée.
Le foldat qui veut jouir du congé de. femeftre
que fon rang lui donne, doit être pourvu d’un
c e r t i f i c a t . V oy e \ [ C ongé. Il doit auffi en produire
un quand il rejoint fon corps à l’expiration, de fon
congé. V oy e[ C ongé,.
Le foldat que des maladies ont empêché de
rejoindre fes drapeaux à l’époque de l’expiration
de fon congé, doit, pour fe mettre à l’abri des
peines portées par les ordonnances , contre ceux
qui dépaffentla durée de leurs, congés, être porteur
d’un c e r t i f i c a t qui attefte l’impoffibilité où il a été
de rejoindre au terme fixé : Je nom du médecin
ou du chirurgien doit être légalifé.
L’offiçier qui a obtenu un congé pout' aller
aux eaux doit, afin de toucher fes appointemens ,
produire à fon retour un c e r t i f i c a t du médecin
des eaux, vifé par le commiflake des guerres
P