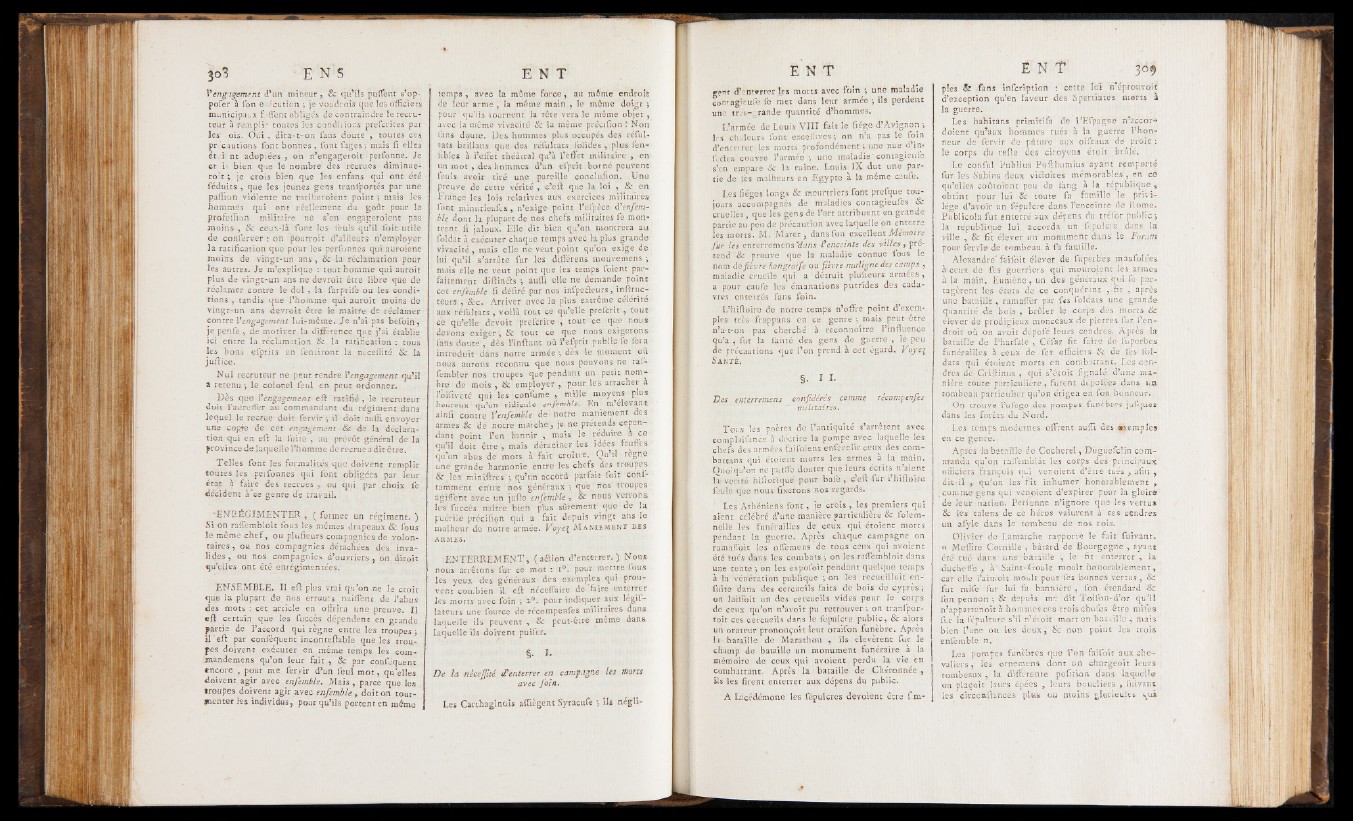
l’ engigement d’un mineur , 8c qu’ ils puffent s’op-
pofer à Ion e -.édition •, je voudrois que les officiers
municipaux f. filent obligés de contraindre le recruteur
à »remplir toutes les conditions prefcrites par
les ois. Oui , dira-1-on Taris doute , toutes ces
pr cautions font bonnes , font fages mais fi elles
et. i nt adoptées j on n’engageroit perfonne. Je
cr i.s bien que le nombre des recrues diminueront
; je crois bien que les enfans qui ont été
féduits , que les jeunes gens traniportés par une
palfion violente ne ïatifieroient point -, mais les
hommes qui ont réellement du goût pour la
profeffton militaire ne s’en engageraient pas
moins , & ceux-Ja font les ieuls qu’il ibit utile
de conlerver : on ^ourroit d’ailleurs n’employer
la ratification que pour les personnes qui auroient
moins de vingt-un ans , & la réclamation pour
les autres. Je m’explique : tout homme qui auroit
plus de vingt-un ans ne devroit être libre que de
réclamer contre le dol , la farprife ou les conditions
5 tandis que l’homme qui auroit moins de
vingtrun ans deyroit être le maître de réclamer
contre V engagement lu ir rue me..Je n’ai pas bel’oin,
je penfe , de motiver la différence que j’ai établie
ici entre la réclamation & la ratification : tous
les bons efprits en fendront la ncceffité 8c la
juftice.
Nul recruteur ne peut-rendre Rengagement qu’il
a retenu j le colonel letil en peut ordonner.
Dès que R engagement eft ratifié, le recruteur
doit l'adreffer au commandant du régiment dans
lequel le recrue doit fervir \ il doit aulli envoyer-
une copie de cet engagement 8c de la déclaration
qui en efl la lui te , au prévôt général de la
province de laquelle l’homme de recrue a dit être.
Telles font les formalités que doivent remplir
toutes les perfonnes qui font obligées par leur
état à faire des recrues , ou qui par choix le
décident à ce genre de travail.
•ENRÉGIMENTER, (former un régiment.)
Si on raffembloit fous les mêmes drapeaux 8c fous
le même chef, ou plufieurs compagnies de volontaires
, ou nos compagnies détachées des invalides
, ou nos compagnies d’ouvriers , on. diroit
qu’elles ont été enrégimentées.
ENSEMBLE. Il efi plus vrai qu’on ne le croit
que la plupart de nos erreurs naiffent de l’abus
dés mots : cet article en offrira une preuve. Il
eft certain que les fuccès dépendent en grande
partie de l’accord qui règne entre les troupes ;
il'eft par conléquent inconteftable que les troupes
doivent exécuter en même temps les com-
mandemens qu’on leur fait , 8c par coniequ.ent
encore , pour me feryir d’un feul mot, qu’elles
doivent agir avec enfernble. Mais , parce que les
troupes doivent agir avec enfernble > doiton tourmenter
les individus, pour qu’ils portent en même
temps , avec la même force, au même endroit
de leur arme , la même main , le même doigt ;
pour qu’ils tournent la tête vers le même objet,
’ avec la même vivacité 8c la même précifion ? Non
fans doute. Des hommes plus occupés des réful-
tats brillans que des réfukats fol ides , plus fen-
iibles à l’effet théâtral qu’à l’effet militaire , en
un mot , des hommes d’un eiprit borné peuvent
: feuls avoir tiré une pareille conclusion. Une
preuve de cette vérité , c’eft que la loi , & en.
France les lois relatives aux exercices militaires
font minutieufes, n’exige- point l’efpèce (Renfem-
ble dont la plupart de nos chefs militaires fe montrent
fi jaloux. Elle dit bien qu’on montrera au
foldat à exécuter chaque temps avec la plus grande
vivacité , mais elle ne veut point qu’on exige de
lui qu’il s’arrête fur les différens mouvemens ;
mais elle ne veut point que les temps foient parfaitement
diftincls -, aulli elle ne demande point
cet enfernble fi défiré par nos infpecteurs, infi:rlicteurs
, &c. Arriver avec la plus extrême célérité
aux réfukats, voilà tout ce qu’elle prefcrit , tout
ce qu’elle devoir prefcrire , tout ce que nous
devons exiger', 8c tout ce que nous exigerons
fans doute , dès l’inftant où l’efprit public fe fera
introduit dans notre armée -, dès le moment où
nous aurons reconnu que nous pouvons ne ra(-
fembler nos troupes que pendant un petit nombre
de mois , 8c employer , pour les arracher à
l’oifiveté qui les confume , mille moyens plus
heureux qu’un ridicule enfernble. En m’élevant
ainfi contre Ÿenfernble de notre maniement dès
armes 8c dé notre marche, je. ne prétends cependant
point l’en bannir , mais le réduire a ce
qu’il doit être , mais déraciner les idées faillies
qu’un abus de mots à fait croître. Qu’il régné
une grande harmonie entre les chefs des troupes
& les* miniftres -, qu’un accord parfait foit coni-
tamment entre nos généraux •, que ’ nos troupes
agiffent avec un jufte enfernble & nous verrons
les fuccès naître bien plus sûrement que de la
puérile précifion qui a fait depuis vingt ans le
malheur de notre armée. Voye\ M a n i e m e n t d e s
a r m e s .
ENTERREMENT, ( a&ion. d’enterrer. ) Nous
nous arrêtons fur ce mot : i°. pour, mettre fous
les yeux des généraux1 des exemples qui prouvent
combien il efi riéceffaire de faire enterrer
les morts avec foin j 2.°. pour indiquer aux legil-
lateurs une fource de récompenfes, militaires dans
laquelle ils peuvent , 8c peut-être même dans,
laquelle ils doivent puifer«
§. I.
De la néeejjîeé d’enterrer en campagne les morts
avec foin.
Les Carthaginois affligent Syracufe -, ils négligent
d’enterrer les morts avec foin *, une maladie
contagieufe lé met dans leur armée -, ils perdent
une très-grande quantité d’hommes.
L’armée de Louis VIII fait le fiége d’Avignon -,
1rs chaleurs font excellives-, bn n’a pas le foin
d’enterrer les morts profondément -, une nue d’inc
frètes couvre l’armée -, une maladie' contagieufe
s’en empare 8c la ruine. Louis IX dut une partie
de les malheurs en Egypte a la meme csuie.
Les lièges longs & meurtriers font prefque toujours
accompagnés de maladies contagieufes 8c
cruelles , que les gens de l’arr attribuent en grande
partie au peu de précaution avec laquelle on enterre
les morts. M. Maret, dans fon excellent Mémoire
fur les enterremen s ’dans P enceinte des villes, prétend
8c prouve que la maladie connue fous le
nom de fièvreho ngroife ou fièvre maligne des camps ,
maladie cruelle qui a détruit plufieurs armées ,
a pour caufe les émanations putrides des cadavres
enteirés fans foin.
L’hifioire de notre temps n’offre point d’exemples
très-frappans en ce genre -, mais peut-être
n’a't-on pas cherché à reconnoître l’influence
qu’a , fur la fan té des géns de guerre , le peu
de précautions que l’on prend à cet égard. Voyc\
Santé.
§. I IDes
enterremens confédérés comme récompenfes
- militaires.
Tous les poètes de l’antiquité s’arrêtent avec
eomplaifance à décrire la pompe avec laquelle les
chefs des armées faifoient enfévelir ceux des com-
battans qui étoiént morts les armes à la main.
Quoiqu’on ne pi.iffe douter que leurs écrits n’aient
la-vérité hiûorique pour baie, ç’eft fur- i’hiftoire
feule que nous fixerons nos regards.
Les Athéniens font, je crois , les premiers qui
aient célébré d’une manière particulière & folem-
nelle les funérailles de ceux qui étoient morts
pendant la guerre. Après chaque campagne on
ramafibit les o(Ternens de tous ceux, qui avoient
été tués dans les combats j on les raffembloit dans
une tente -, on les expofoit pendant quelque temps
à la vénération publique -, on les recueilloit en-
luite dans des cercueils faits de bois de cyprès-,
on laiffoit un des cercueils vides pour le corps
de ceux qu’on n’avoit pu retrouver-, on tranfpor-
toit ces cercueils dans le fépulcre public, & alors
un orateur prononçoit leur oraifon funèbre. Après
la-bataille de Marathon , ils élevèrent fur le
champ de bataille un monument funéraire à la
mémoire de ceux qui avoient perdu la vie en
combattant. Après la bataille de Chéronnée ,
ils les firent enterrer aux dépens du public.
A Lacédémone les fépulcres dévoient être Cmpies
& fans infeription : cette loi n’éprouvoit
d’exception qu’en faveur des Spartiates morts à
la guerre.
Les habita-ns primitifs de l’Efpagné n’accor-*
doient qu’aux hommes tués à la guerre l’honneur
de fervir de pâture aux oiféaux de proie :
le corps du refie des citoyens étoit brûlé.
Le conful Pnbiius Pofthumius ayant remporté
fur les Sabins deux victoires mémorables, en ce
qu’elles coûtoient peu de fan g à la république ?
obtint pour lui 8c toute fa famille lé privilège
d’avoir fin fépulcre dans l’enceinte de Rome.
Publicola fut enterré aux dépens du tréfor public -,
la république lui accorda un fépulcre dans la
ville , 8c fit élever un monument dans le Forum
pour fervir de tombeau à fa famille.
Alexandre' faifôit élever de fuperfces maufolées
à ceux de fes guerriers qui mouroient les armes
à la main. Eu mène , un des généraux qui fe-partagèrent
les états de ce conquérant , fit , après
une bataillé , ramaffer par f*s foldats une grande
quantité de' bois , brûler le corps des morts &
élever de prodigieux monceaux de pierres fur l’endroit
où on avoit depeie leurs cendres. Après la
bataifle de Pharfale , Célar fit faire de luperbes
funérailles à ceux de fes officiers & de. fes fcl-
dats qui étoient morts en combattant. Les cendres
de Criftimis , qui s’étoit fignale d’une manière
toute particulière, furent dépofées dans i-ua
tombeau particulier qu’on érigea.en fon honneur.
On trouve l’ufage des pompes funèbres jufques
dans les forces du Nord.
- Les temps modernes offrent suffi. des exemples
en ce genre.
Après la bataille de Cocherel, Duguefclin commanda
qu'on raffemblât les corps des principaux
officiers françois qui ve-n oient d’être tués , afin ,
dit-il , qu’on les fit inhumer honorablement ,
comme gens qui venoient d’expirer pour la gloire
de leur nation. Perfonne n’ignore que les vertu*
& les talens de ce héros valurent à ces cendres
un alyle dans le tombeau de nos rois. R - i
Olivier de Lamarche rapporté le fait fuivant.
« Meffire Cornille , bâtard de Bourgogne , ayant
été tué dans une-bataille , le fit enterrer, la
ducheffe , à Saint-Goule moult honorablement,
car elle l’aimoic moult pourTes bonnes vertus, &
fut mife fur lui fa bannière., fon étendard 8c
fon pennon \ 8c depuis me dit Toiibn-d’or qu’il
n’appartenoit à hommes ces trois choies être miles
fur la fépulture s’il n’ étoit mort en bataille mais
bien l’une ou les deux, 8c non po-iat les trois
enfernble ».
Les pompes funèbres que l ’on faifoit aux chevaliers,
les ornemens dont on chargeoit leurs
tombeaux, la différente pofition dans laquelle
on plaçoit leurs épées , leurs boucliers > fuivans
'les circcnihnçes plus ou moins glorieulès qui