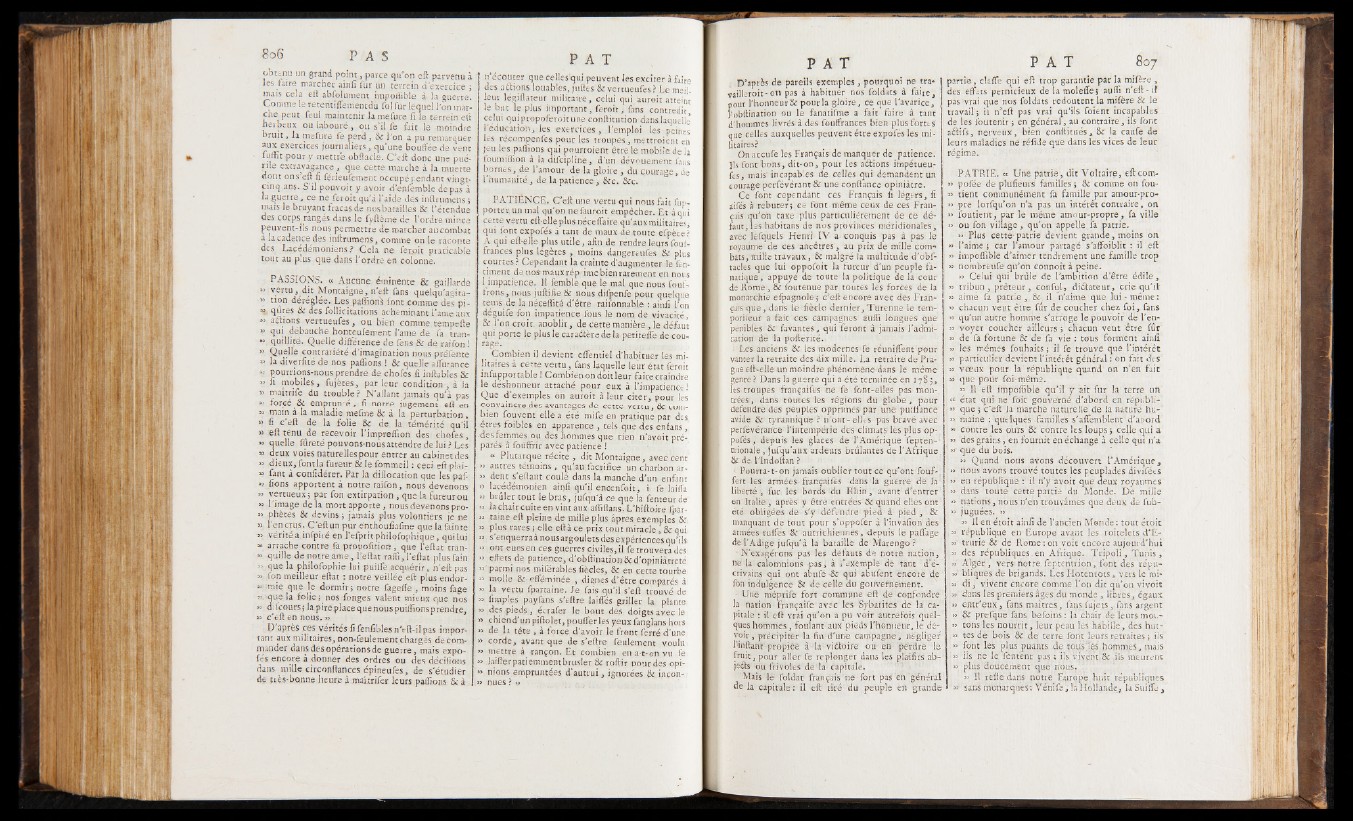
806 P A S
obtenu un grand point, parce qu’on eft parvenu à
les faire marcher ainfï fur un terrein d'exercice j
mais cela eft abfolument impolfible à la guerre.
Comme le reteritiiTementdu fol fur lequel l'on marche
peut feul maintenir la mefure fi le terrein eft
herbeux ou labouré, ou s’il fe fait le moindre
bruit, la mefure fe perd, & l’on a pu remarquer
aux exercices journaliers , qu’une bouffée de vent
fuffit pour y mettre obftacle. C’eft donc une puérile
extravagance., que cette marche à la muette
dont on s eft fi férieufement occupé pendant vingt-
cinq ans. S’il pouvoit y avoir d’enfêmble de pas à
la guerre, ce ne ferait qu’à l’aide des inft rumens j
mais le bruyant fracas de nos batailles & l’étendue
des corps rangés dans le fyftème de l’ordre mince
peuvent-ils nous permettre de marcher au combat
a la cadence des inftrumens, comme on le raconte
des Lacedemoniens ? Cela ne ferpit praticable
tout au plus que dans l’ ordre en colonne.
PASSIONS. « Aucune éminente & gaillarde
»» vertu, dit Montaigne,, neft fans quelqu’agita-
» tion déréglée. Les paffion^ font comme des pi-
% 4ures & des follicitations acheminant l’ame aux
31 allions vertueufes, ou bien comme tempefte
» qui débauche honteufement l’aine de fa tranquillité.
Quelle différence de fens & de raifon !
» Quelle contrariété d'imagination nous préfente
** la diverfité de nos paffions ! & quelle affurance
t pourrions-nous prendre de chofes fi inftables &
w fi mobiles, fujètes, parleur condition , à la
» maitrife du trouble ? N’allant jamais qu’à pas
« forcé & emprun.é, fi notre jugement eft en
33 main a la maladie meftne & à la perturbation ,
» fi c eft de la folie & de la témérité qu’il
» eft tenu de recevoir l’impreffion des cho.fes,
»» quelle fureté pouvons-nous attendre de lui ? Les
» deux voies naturelles pour entrer au cabinet des ;
» dieux,fontla fureur & Ie fommeil : ceci eft plai-
33 faut à confidérer, Par la diflocation que les paf-
» fions apportent à notre raifon, nous devenons
» vertueux j par fon extirpation , que la fureur ou
» l 'image de la mort apporte , nous devenons pro-
» phètes & devins } jamais plus volontiers je ne
» l ’en crus. C ’eft un pur e'nthoufîafme queïafainte
» vérité a infpiié en refpritphilofophique, qui lui
» arrache contre fa propofition, que l’eftat tran-
» quille de notreame, l’eftat raffî, l’eftat plusfain
33 que la philofophie lui puilfe acquérir, n’eft pas
» fon meilleur eftat : notre veiilée eft plus endor-
33 :mfé que îe dormir} notre fagefte, moins fage
?»-que la folie 5 nos Congés valent mieux que nos
53 dffcoursj la pire place que nous puiffions prendre,
» c’eft en nous. »
D’après ces vérités fi fenfiblesn'eft-ilpas important
aux militaires, non-feulement chargés décommander
dans des operations de guerre, mais expo-
fés encore à donner des ordres ou des dédiions
dans mille circonftances épineufes, de s’étudier
4e çiès-bqnne heure à maïrrifer leurs paffions & à
P A T
n’écouter que celles‘qui peuvent les exciter à faire
des actions louables, juftes & vertueufes ? Le meü-
leur légiflateur militaire, celui qui àuroit atteint
le but le plus important, feroit, fans contredit,
celui quipropoferoitune conftitution dansJaquelle
1 éducation, les exercices, l’emploi les peines
les récompenfes pour les troupes, mettroient en
jeL1 les paffions qui pourroient être le mobiïe.de la
foumiffion à la difcipline, d’un dévouement fans
bornes, de l’amour de la gloire, du courage, de
l’humanité, de la patience, &c. &c.
PATIENCE. C’eft une vertu qui nous fait fup-
porter un mal qu’on nefauroit empêcher. Et à qui
cette vertu eft-elle plus néceffaire qu’aux militaires,
qui font expofés à tant de maux de toute efpèce?
A qui eft-elle plus utile, afin de rendre leurs foul-
frances plus légères , moins dangereufes & plus
courtes ? Cependant la crainte d’augmenter le fen-
timent de nos-maux réprime bien rarement en nous
1 impatience. Il femble que le mal que nous fouf-
frons, nous juftifie & nous difpenfe pour quelque
rems de la néeefîité d’être raifonnable : ainfi l'on
déguife fon impatience fous le nom de vivacité,
& l’on croit, anoblir, de cette manière, le défaut
qui porte le plus le caractère de la petitelfe dé couragé.
:
Combien il devient effentiel d’habituer les militaires
à cette vertu, fans laquelle leur état feroit
infupportable ! Combien on doitleur faire craindre
le déshonneur attaché pour eux à l’impatience!
Que d’exemples ôn auroit à leur citer, pour les
convaincre des avantages de cette vertu, & combien
fouvent elle a été mife en pratique par des.
êtres foi blés en apparence , tels que des enfans,
des femmes ou des hommes que rien n’avoit préparés
à foüffrir avec patience !
« Plutarque récite, dit Montaigne, avec çent
33 autres témoins, qu’au .facrifice un charbon ar-
33 dent s’efiant coulé dans la manche d’un enfant
r» lacédémonien ainfi qu’il encenfoit, t; fe laiffa
| »» brûler tout le bras, jufqu'à ce que la fenteur de
: « la chair cuite en vint aux affiftans. L’hiftoire fpàr-
: »» taine eft pleine de mille plus âpres exemples &
; 33 pjus rares} elle eft à ce prix tout miracle, & qui,
; » s'enquerraà nousargoulets des expériences qu’ils
» ont euesen ces guerres civiles,il fe trouvera des
j ” effets de patience, d’obftination & d’opiniâtreté
; »». parmi nos miférables fiècles, & en cette tourbe
33 molle & efféminée , dignes d’être comparés à
30 la vertu fpartaine. Je fais qu’il s’eft trouvé de
» firaples payfans s’eftre laifles griller la plante
» des pieds , écrafer le bout des doigts avec le
» chien d’un piftolet, pouffer les yeux fanglans hors
» de la tete, a force d’avoir le front ferré d’une
» corde, avant que de s’eftre feulement voulu
» mettre à rançon. Et combien en a-t-on vu. fe
33 laiffer patiemment brasier & roftir pour des opi-
» nions empruntées d’autrui, ignorées & incon-
;» nues ? »
P A T
D’après de pareils exemples, pourquoi ne tra*
vailleroit*on pas à habituer nos foldats à faire,
pour l’honneur & pour la gloire, ce que l’avarice,
Pobftination ou le fanatifme a fait faire à tant
d'hommes livrés à des fouffrances bien plus fortes
que celles auxquelles peuvent être expofés les militaires?
On accufe les Français de manquer de patience.
Ils font bons, dit-on, pour les actions impétueuses,
mais’ incapables de. celles qui demandent un
courage perfévérant & une confiance opiniâtre.
Ce font cependant ces Français fi légers, fi
aifés à rebuter} ce font même ceux de ces Français
qu’on taxe plus particuliérement de ce défaut,
les habitans de nos provinces méridionales,
avec lefquels Henri IV a- conquis pas à pas le
royaume de ces ancêtres, au prix de mille combats,
mille travaux, & malgré la multitude d’obf-
tacles que lui oppofoit la fureur d’un peuple fanatique,
appuyé de toute la politique de la cour
de Rome, & foutenue par toutes les forces de la
monarchie efpagnole $ c’eft encore avec des Français
que, dans le fiée le dernier, Turenne le tem-
porifeur a fait ces campagnes auffi longues que
pénibles & favantes, qui feront à jamais l'admiration
de 4a pofférité.
. Les anciens & les modernes fe réunifient pour
vanter la retraite des dix mille. La retraite de Pra- ;
gue eft-elle un moindre phénomène dans lé même
genre ? Dans la guerre qui a été terminée en 1783,
les troupes françaifèS“ ne fe font-elles pas montrées',
dans toutes les régions du globe, pouf
défendre des peuples' opprimés par une puiflance
avide & tyrannique ? n'ont-elles pas bravé avec
perfévérancè l’intempérie dës ci i mats lès plus op-
pofés, depuis les glaces de l’Amérique fepten-
trionale, jufqu’aux ardeurs brûlantes de l’Afrique.
& de- l'Indoftan ?
■ Pourra-t-on jamais oublier tout ce qu’ont fouf-,
fert les armées françaifes dans là guerre dé la
liberté, fur les bords du Rhin,'avant dentrer
en Italie, après y être-entrées & quand elles ont
été obligées de s’ÿ défendre pied à pied, &
manquant de tout pour s’oppofer à l'invafion des
armées ruffés & autrichiennes , depuis le paflage
de l’Adige jufqu’à la bataille de Marengo?
“ N’exagérons pas les défauts de notre nation,
ne la calomnions pas, à l’exemple dè tant d’écrivains
qui ont abufé qui abfffent encorè de
fon indulgence & de celle du gouvernement.
- Une méprife fort commune eft de confondre
la nation françaife avec les Sybarites de là capitale
: il eft vrai qu’on à pu voir autrefois quelques
hommes, foulant aux pieds l’honneur, le devoir
, précipiter la fin d’une campagne , négliger
l'inftahr propice à la vièloire ou en perdre ' le
fruit , pour aller fe replonger dans les plaifirs ab-
jeèls ou frivoles de la capitale.
Mais lé: foldat français ne fort pas eft général
de la capitale : il eft tiré du peuple en grande
P A T 807
partie, claffe qui eft trop garantie par la mifère,
des effets pernicieux de la moleffej auffi n’eft-if
pas vrai que nos foldats redoutent la mifère & le
travail } il n’eft pas vrai qu’ils foient incapables
de les foutenir} en général, au contraire, ils font
aétifs, nerveux, bien conüitués, & la caufe de
leurs maladies ne réfide que dans les vices de leur
régime.
PATRIE. « Une patrie, dit Voltaire, efteom-
» pofée de plusieurs familles} & comme on fou-
» tient communément fa famille par amour-pro-
» pre lorfqu’on n’a pas un intérêt contraire, on
» foutient, par le même amour-propre, fa ville
» ou fon village, qu’on appelle fa patrie.
» Plus cette patrie devient grande, moins on
» l’aime} car l’amour partagé s affbiblit : il eft
» impoflible d’aimer tendrement une famille trop
» nombreufe qu’on connoît à peine.
» Celui qui brûle de l’ambition d’être édile,
» tribun, prêteur, conful, dictateur, crie qu’it
; » aime fa patrie,. & il "n’aime que lui-même:
» chacun veut être fûr de coucher chez foi, fans
■ » qu’nn autre homme s’arroge le pouvoir de l’en-
» voyer coucher ailleurs} chacun veut être fûr
» de fa fortune & de fa vie : tous forment ainfi
» les mêmes fouhaits ; il fe trouve que l’intérêt
» particulier devient l’intérêt général on fait des
» voeux pour la‘ république quand on n’en fait
» que poiir foi-même.
» Il eft impoifible qu’il y ait fur la terre un
état qui ne foit gouverne d’abord en républi-
: » que} c’eft la marche naturelle de la nature hu-
»? màine : quelques familles s’affemblent d’abord
, » contre les ours & contre les loups} celle qui a
» des grains, en fournit en échange à celle qui n’a
| »»“ qüë du bois.
»» Quand nous avons découvert l’Amérique,
>» nous avons trouvé toutes les peuplades divifées
»» en république : il n’y avoit que deux royaumes
»» dans toute cette partie du Monde. De mille
» nations, nous n’en trouvâmes que deux de fub-
»» juguées. »»
»» Il en étoit ainfi de l’ancien Monde : tout étoit
^»» république en Europe avant les roitelets d’E-
»» trurie & de Rome : on voit encore aujourd’hui
»» des républiques. en Afrique. Tripoli, Tunis ,
» Alger, vers notre feptentrion, font des répu-
x> bliques de brigands. Les Hotencots, vers le mi-
!»»' di, vivent encore comme l’on dit qu’on vivoit
» dans les premiers âges du monde, libres, égaux
» entr’eux, fans maîtres, fans.fujets, fans argent
>» & prefque fans befoins : la chair de leurs moi.-
.»» tons les nourrit, leur peau les habille, des hui-
,» tes de bois & de terre font leurs retraites} ils
»» font les plus puants de toûsiês hommes, mais
» ils ne le. fentént pas ; ils vivent;& ils meurent
>» plus doucement que nous/ '
' »» Il re’fte dans notre Europe huit républiques
» sans mbharques: Vénife; là.Hollande, la Suiffe ,