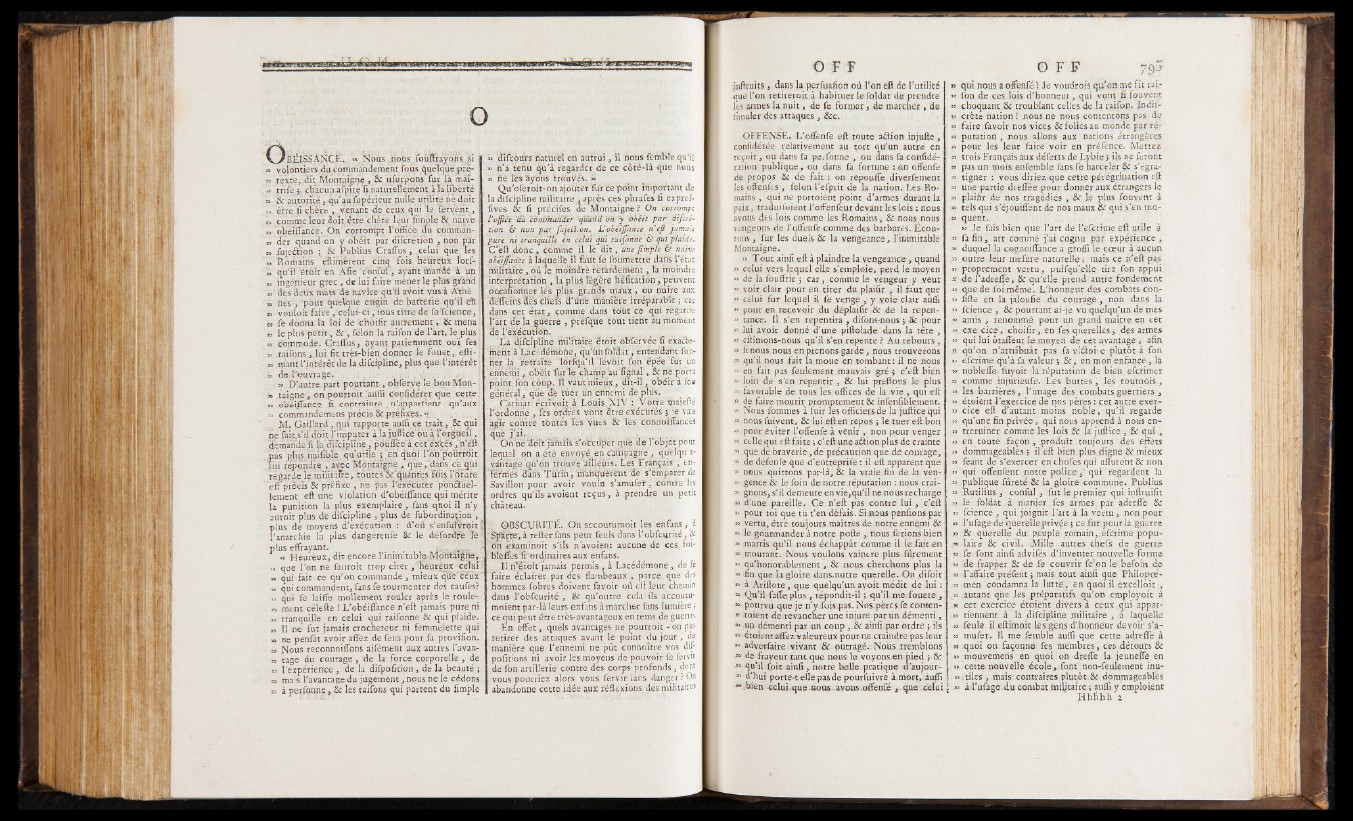
( ) M i$SANCÈ. V« ftôùs .nous foüftrayons si
» volontiers du commandement fous Quelque prë-
_» texte, dit Môntafgne , 8c ufurppns fur là 'rnâî- !
À irife 5:.'chacun.aii>ir,e fi natùreïïémènt à la liberté i
» & autorité, qu’au Supérieur nulle utilité nèffÔic
« être fi chère , venant de ceux qui ’le fervent, |
» comme leur doit être'chère leur fîmple & naïve
» obéiffahce. On corroiript l’ office du commun- j
» der quand on y obéit par dîfcrétiôn , non par j
»s Juje&ion ; & Publius Craffus, . .celui que les
» Romains éftimërent cinq fois hèïirètix îbrf-
5, qu’il rét6lr en Àfîe 'côn'ful, ayant rfiaridé à un |
» ingénieur grec, de lui faire mener le pîxis- grànff j
-» des deUx mâts de navire qu’tl avoit vus à A*thè j
« fiés-, 'pour quelque eftgin de batterie qu’ il eh j
» vouloit faite, cêlui-ci, fous titre de fa fcience , j
co fe donna la loi de chôifir autrement, & mena -
» le plus petit-, 8c 3 félon la raifon de l’ art, le plus ;
» commode. Craffus, ayant patiemment ouï fes |
» raifons , lui fit très-bien d o n n e r le fo u e t, efti-
» mant l’intérêt de la difciplirie, plus que l'intérêt
:à> de:l'ouvrage.., ... i j , V. »
» D’autrepart pourtant, obferye le bon Mon- ■
» taigne, onipourroit aûfîi çonfiderer que cette,
oo obéiffaîicé h contrainte ^'appartient qu’aux
oo commandemens précis & préfixes.»,^
M. Gaillard, qui rapporte ^ufl\çe trait, & qui
ne faits j f doit l’imputer àîà juftïçe pù-àTqrgueil,
demande fi ladifcipline, pdüffee'à cet exces /n’eft
pas plus .nuiubie ‘ qu’utile j~en quoi Tph pourroit
lui répondre . aveclWôntâïgp| > que,‘dans ce'gui
regarde le militaire, toute s'8cqùârites fois rprare
eft précis Séprefixe , ne pas Tex'écutfer 'pon&ùel-
lement eft une violation d’obéiffance qui mérite
la punition la plus exemplaire , fans quoi il n'y
auroit plus de difcipline , plus de fubordination ,
plus de moyens d’ exécution : d’où s'enfuîyroitl
l'anarchie la plus dangereufe 8c le déforme fe
plus effrayant. I ; s|L
« Heureux, dit encore l'inimitable- Mo'nfàighe,
»o que l ’on ne fauroit trop c ite r , heureux celui
o» qui fait ce qu'on commande, mieux q p ’ cèu'x
» qui commandent, fans fe tourmenter des caufes?
3> qui fe laiffe mollement rouler après le roule-
*> ment célefte ! L’obéiffance n’eft jamais pure ni .09 tranquille en celui qui raifonne & qui plaide.
» Il ne fut jamais crocneteur ni femmelette qui
oo ne penfat avoir affez de fens pour fa provifion.
*> Nous reconnoiffons aifément aux autres l’avan-
» tage du courage, de la force corporelle, de
»o l ’expérience , de 1a difpofition, de la beauté ;
o» mais l’avantage du jugement, nous ne le cédons
oo à perfonne » .& les raifons qui partent du fïmple
o» difcôuVs ffatùrël eti âûtrüi, il flous femble qu'il
» n’a tefiu qu'à regarder de ce côté-là que nous
*> riè Tes ayons trouVés. »
Qu oferoit-on ajouter fur Ce point important de
la difeipline militaire .après ces phrafes fi expref-
fives & fi précifess de Montaigne ? On corrompt
L'office 'HU cbmfhaiïder 'qiTand orl y àbéit par Hifcré-
tion 6' non par fujcëfcçn. L’obéiffance nefi jamais
pure ni tranquille én cèïui qüi raifoïïne & qui plaide..
C ’ëft donc.,, cofnme il le d it , Une ftinple & naïve
obéiffance à tàquéllè il faut fe fdurnèttre dans l’état
militaire, où le môiriùrë fëfardemënt, l'a moindre
interprétation , la plus legèré hëfîtatiÔn, peuvent
boçâiïbnner les plus grahffs mâù'x , ou nuire aux
àènéinà âès chefs 'd’ürîe lïiânïërë irrépâraljlè ; car
dans cet éta t, comme dans fôüt'ce qui regarde
l’ art dë la gûërré , prêfqû'e tôüt tiëtït au moment
aèrëxécutiôfi.
La ffifcïpiîne mihïâire etôït obfeïvée fi exactement
'à Lacedéhiohe, qu'iih (biffât., entendant fo'n-
nër Ta, fe traite ‘lorsqu’ il lëvôit fo'n fûr un
ehnémi, o'béit fur le champ ^aü fîgrtâl, èc né p’cirra
point fon coup. 11 Vàùt'm'iëüx, dit-il,/obéir à foa
général, que cfe fuer un éilnemi dè plus.
Çatinat écfîvbit à Lôüiis XIV : Votre pàajefté
rprüonne , fès ÔrÜVës vont être eXécüfés j. je vais
agir contre tbutês lès VUés & lès connolffances
que ‘j'âi.,
Dn neffÔit'jamais s’otèilpèr que de l’objet pour
lequel on a été envoyé èn campffghe' , queîqu'a-
yaïitage qu'on trouve 'âiliéùfs-. Les Français , en-
. fermés ffaiis Tûrïh , vriMqifèi!è‘nt^"ffé’ s’emparer de
Savillon pour avoir voulu s’amufer , contre les
ordres qu’ils avoient reçus, à- prendre un petit
. château.
~ OBSCURITÉ. On accourumoit les enfans, à
. Spârte;à refterfans peur feuls dans l’obfcurité, &
Ôh eXaminoit s'ils n'avoient aucune de ces foi-
: blèffes iî'ordinaires aux enfans.
Il n^ëtbit jamais permis, à Lacédémone, de fe
faire éclairer par des flambeaux ,■ parce que des
: hommes fobres doivent favoir où eft leur chemin
dans Tobfcurité-, &: qu’outre cela ils aècoutu-
moîent par-là leurs enfans à marcher fans lumière}
; ce qui peut être très-avantageux en tems de guerre.
F.n effet, quels avantages ne pourroit - on pas
retirer des- attaques avant le point du jou r, de
manière que l’ennemi ne pût connoître vos dij'
pôfitions ni avoir les moyens dè pouvoir fe fervir
de fon artillerie contre des corps profonds, donc
; vous pourriez alors vous fervir fans danger ? On
abandonne cette idée aux réflexions des militais
o F F
inftruits , dans la perfuafion où l’on eft de Futilité
que l’on retireroit à habituer le foldat de prendre
les armes |a nuit, de fe forrner \ de marché! , de
iîmuler des attaques , & c .
OFFENSE. L’offenfe eft toute aélion înjufte,
confidérée relativement au tort qu’ un autre en
reçoit, ou dans fa perfonne , ou dans fa conlïdé-
ration publique, ou dans fa fortune : on oifenfe
de propos & de fait : on repouffe diverfement
les offenfts, felqn l’efprit de la nation. Les Romains
, qui ne portoient point d'armes durant la
paix, traquifoient l'otfenfeur devant les lois : nous
avons ctes lois comme les Romains, & nousynous
vengeons de l’oflènfe comme des barbares. Écoutons
,'fu r les duels & la vengeance, rinimitable
Montaigne.
« Tout ainfi eft à plaindre la vengeance, quand
» celui vers lequel elfe s’emploie, perd le moyen
»> de la fouffrir j car, comme le vengeur y veut
m voir clair pour en tirer du plaifir , il faut que
»> celui fur lequel il fe venge , y voie clair auffi
»> pour en recevoir du déplaifir & de la repen-
« tance. Il s’en repentira, difons-nous ; 8c pour
" lui avoir donné d’ une piftolade dans la tête ,
»» eftimons-nous qu’il s’en repente ? Au rebours,
» fi nous nous en prenons garde, nous trouverons
» qu’il nous fait la moue en tombant : il ne nous
=» en fait pas feulement mauvais g r é } c’ eft bien
» loin de s en repentir , & lui preftons le plus
gy favorable de tous les offices de la vie , qui eft
» de faire mourir promptement 8c infenfiblement.
» Nous fommes à fuir les officiers de la juftieequi
» nous fui.vent, 8c lui eft en repos } le tuer eft bon
33 pour éviter l’offenfe à venir , non pour venger
» celle qui eft faite s c’ eft une adtion plus de crainte
>» que de braverie, de précaution que de courage,
» de défenfe que d’entreprife : il eft apparent que
33 nous quittons par-là, 8c la vraie fin de la ven-
« gence.& le foin de notre réputation : nous crai-
» gnons, s’il demeure en vie,qu’il ne nous recharge i
v» d’une pareille. Ce n’eft pas contre lu i , e’eft
» pour toi que tu t’en défais. Si nous penfions par '
»•vertu, être toujours maîtres de notre.ennemi &
» le gourmander à notre pofte nous ferions bien
» marris qu'il nous échappât comme il le fait en
» mourant. Nous vpulons vaincre plus fûrement.
»■ qu'honorablement, & nous.cherchons plus la
» fin que la gloire dans-notre querelle. On difoit ;
» à Ariflote ,.que quelqu'un ayoit médit de lui :
» Qu’il faffe plus répondit-il ; qu’ il me fouete ,
» pourvu que je n’y .fois.pas. Nos pères fe con«en-
» toient derevaneher une injure par un démenti, ;
» un démenti, par un coup, .8c ainfi par ordre j ils
» étoientaffëz valeureux pour ne. craindre pas leur
» adversaire vivant & outragé.;Nous tremblons
.» de frayeur, pant que nous lé vo.yons.en pied j 8c
* a in fin o tre belle pratique d’aujoiir-
V o hui porte-t ellepasde pourfuivre à.morvaujTi
»•Tbien celui.que nous avons offenfé , que .celui
O F F 7Q»
» qui nous a offenfé ï Je voudroïs qu’on me fît rai-
»a fon de ces lois d’honneur, qui vont fi fouvent
» choquant 8c troublant celles de la raifop. Indif-
» crête nation ! nous ne nous contentons pas de
» fajre favoir nos vices 8c folies au monde par ré-
» putation, nous allons aux nations étrangères
« pour les leur faire voir en présence. Mettez
m trois Français aux déferts de Lybie 3 ils ne feront
» pas un piois enfemble fans fè harceler 8c s’égra^-
» tigner : vous diriez que cette pérégrination eft
» une partie dreffée pour donner aux étrangers le
plaifir de nos tragédies , 8c le plus fouvent à
» tels qui s’éjouiffent de nos maux 8c qui s’en mo-
» queue«
« Je fais bien que l ’art de l’efcrime eft utile à
» fa fin, art commé j'ai côgnu par expérience,
30 duquel la cognoiffance a groffi le coeur à aucun
.m outre leur mefure naturelle > mai.s ce n'eft pas
»? proprement vertu, puifqu’.el.îe tire fop appui
x de l’ adreffe, 8c qu'elle prend autre fondement
»? que de foi-même. L'honneur des combats con-
» nfte en la jaloufie du courage, nçn dans la
?» fcience , 8c pourtant ai-je vu quelqu'un de mes
»? amis , renommé pour un grand ipaî.tre en cet
»» exercice, choifir, en .fes querelles, des a.rjnes
»» qui lui ôtafiènt Je.moyen de cét avantage, afi#
» qu’on n'attribuât pas fa viâoi: e plutôt à fon
»» eferime qu’à fa valeur *, & , en mon enfance, la
» nobleffe fùyoit là réputation de bien efçrimer
» comme injurieufe. Les buttes, les tournois,
» les barrières, l’image des combats guerriers ,
étoient l ’exercice de nos pères : cet autre exer-
»» cice eft d’autant moins noble, qu’ il regarde
?» qu’ une fin privée, qui nous apprend à nous en-
.»» treruiner comme les lois 8c la' juftice, 8c qui ,
»» en toute façon, produit toujours des effets
| »» dommageables.} il eft bien plus.digne 8c mieux
»» féant de s’exercer en chofes qui affurent 8c non
»» qui offenfent notre police f qui ' regardent la
»» publique fureté 8c la gloire commune. Publius
; » Rutilius , confül , fut je premier qui inftruifit
»» le foldat à manier fes armes par adreffé 8c
»» fcience , qui joignit l ’art à la vertu, non pour
9» l’ ufage de querelle privée ; ce fut pour la guerre
?» 8* querelle du peuplé romain, eferime popu-
»».laire 8c civil. Mille autres chefs de guerre
?» ; fe font ainfi advifes d'inventer nouvelle forme
»» de frapper ,8c de ,fe couvrir fe'.on le befoih de
»» l’affaire préfetit j mais .tout ainfi que Philopoe- »9 ,men condamna la lutté j en quoi il ëxçelloit ,
t»ï autant qiie j.es préparatifs .qu’ on employoit à
x» cet .exercice étoient divers à ceux qui appar- 9» tiennent à là .difeipline „militaire , à laquelle
?» feule il eftimoit lës.gëus d’honneur devoir s’a- »9 mufer. Il me femble auffi que cette adreffe à 9i quoi on façonné fes membres, ces détours &
»9 mouvemeris en quoi'oh d'reffe la jeuneffé en »9 cette nouvelle école, font non-feülement inu- »9 .tiles , mais contraires plutôt-8c dommageâblës
j »? àTufage .du combat militaire} auffi y emploient
Hhfihh 1