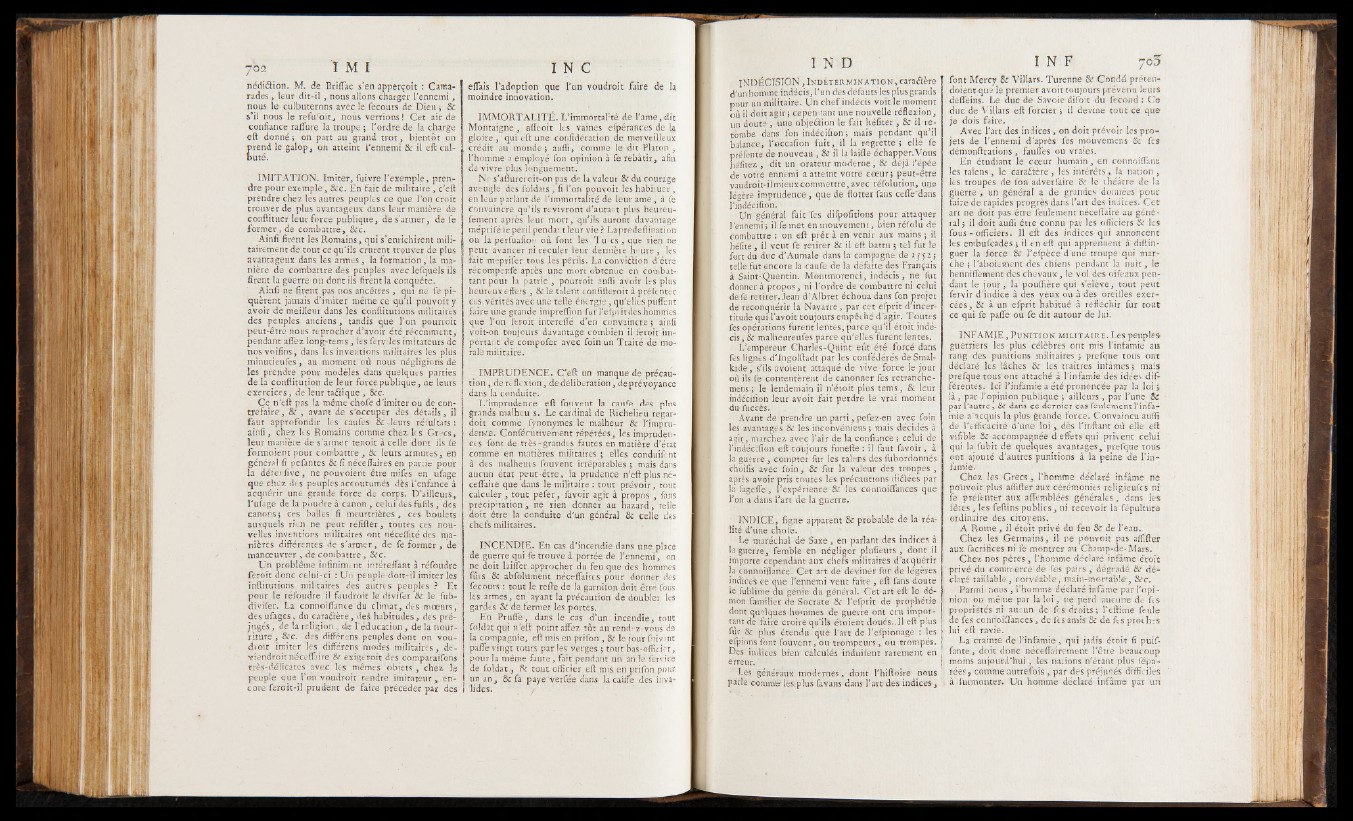
7*02 1 M I
nédiétion. M. de Briflac s’ en apperçoit : Camarades
, leur d it- il, nous allons charger l’ennemi,
nous le culbuterons avec le fecours de Dieu; &
s’il nous le refufoit, nous verrions! Cet air de
confiance rafîure la troupe ; l’ordre de la charge
eft donné j on part au grand trot y bientôt on
rend le galop, on atteint l’ennemi & il eft cul-
uté.
IMITATION. Imiter, fuivre l’exemple, prendre
pour exemple, &c. En fait de militaire , c’eft
prendre chez les autres peuples ce que l ’on croit
trouver de plus avantageux dans leur manière de
conftituer leur force publique, de s’armer, de fe
former, de combattre, &c.
Ainfi firent les Romains, qui s’enrichirent militairement
de tout ce qu’ils crurent trouver de plus
avantageux dans les armes, la formation, la maniéré
de combattre des peuples avec lefquels ils
firent la guerre ou dont ils firent la conquête.
Ainfi ne firent pas nos ancêtres, qui ne fe piquèrent
jamais d’imiter même ce qu’il pouvoit y
avoir de meilleur dans les conftitutions militaires
des peuples anciens, tandis que l’on pourroit
peut-être nous reprocher d’avoir été récemment,
pendant affez Iong-tems, les ferv-les imitateurs de
nos voifins, dans les inventions militaires les plus
minutieufes, au moment où nous négligions de
les prendre pour modèles dans quelques parties
de la conftitution de leur force publique, de leurs
exercices, de leur taéfique, &c.
Ce n’eft pas la même chofe d’imiter ou de contrefaire,
& , avant de s’occuper des détails, il
faut approfondir les caufes & - leurs réfultats :
ainfi, chez les Romains comme chez les Grecs,
leur manière de s’armer tenoit à celle dont ils fe
formoient pour combattre , & leurs armures, en
général fi pefantes & fi néceflaires en partie pour
la défenfive, ne pouvoient être mifes en ufage
que chez des peuples accoutumés dès l’enfance à
acquérir une grande force de corps. D’ailleurs,
l ’ufage de la poudreà canon, celui desfufils, des
canons } ces balles fi meurtrières, ces boulets
auxquels rien ne peut réfifter, toutes ces nouvelles
inventions militaires ont néceflité des manières
différentes de s’armer, de fe former, de
manoeuvrer , de combattre, & c .
Un problème infiniment intéreflant à refondre
feroit donc celui-ci : Un peuple doit-il imiter les
inftitutions militaires des autres peuples ? Et
pour le réfoudre il faudroit le divifer & le fub-
divifer. La connoiflance du climat, des moeurs,”
des ufages, du caractère, de$ habitudes, des préjugés
, de la religion , de l'éducation , de la nourriture,
Sec. des differens peuples dont on vou-
dtoit imiter les differens modes militaires, deviendrait
néceflaire Se exigerait des comparaifons
très-délicates avec les mêmes objets , chez le
peuple que l’on voudroit rendre imitateur , encore
feroit-il prudent de faire précéder par des
I N C
effais l ’adoption que l’on voudroit faire de la
moindre innovation.
IMMORTALITÉ. L’immortaFté de l’ame, dit
Montaigne, affeoit les vaines efpérances de la
gloire, qui eft une confidération de merveilleux
crédit au monde ; aufli, comme le dit Platon,
l’homme a employé fon opinion à fe rebâtir, afin
de vivre plus longuement.
Ne s’affureroit-on pas de la valeur Se du courage
aveugle des foldars, fi l’on pouvoit les habituer,
en leur parlant de l’ immortalité de leur ame, à fe
Convaincre qu’ ils revivront d’autai-t plus heureu-
fement après leur mort, qu’ ils auront davantage
méprifé le péril pendar.tleur vie ? Laprédefiination
ou la perfuafion où font les Tmcs , que rien ne
| peut avancer ni reculer leur dernière hüure, les
fait méprifer tous les périls. La conviêtion d’être
récompenfé après une mort obtenue en combattant
pour la patrie, pourroit aufli avoir les plus
heureux effets , & le talent confifteroit à préfenter
ces vérités avec une telle énergie, qu’elles puffent
faire une grande impreflion fur l’efprit des hommes
que l’on feroit intérefle d’en convaincre j ainfi
voit-on toujours davantage combien il feroit important
de compofer avec foin un Traité de mo-
ralè militaire.
IMPRUDENCE. C ’eft un manque de précaution
, de réflexion, de délibération, de prévoyance
dans la conduite.
L’imprudence eft fonvent la caufe des plus
grands malheu s. Le cardinal de Richelieu regar-
doit comme fynonymes le malheur & l’imprudence.
Confécutivement répétées, les imprudences
font de très-grandes fautes en matière d’état
comme en matières militaires ; elles conduifent
à des malheuis fouvent irréparables } mais dans
aucun état peut-être, la prudence n’eft plus né-*
ceffaire que dans le militaire : tout prévoir, tout
calculer, tout pefer, favoir agir à propos , fans
précipitation, ne rien donner au nazard, telle
doit être la conduite d’un général & celle d«s
chefs militaires.
INCENDIE. En cas d’incendie dans une place
de guerre qui fe trouve à portée de l’ennemi, on
ne doit laifler.approcher du feu que des hommes
fuis & abfolument néceflaires pour donner des
fecours : tout le refle de la garnifon doit être, fous
les armes, en ayant la précaution de doubler les
gardes Se de fermer les portes.
En Prude, dans le cas d’un incendie, tout
foldat qui n’eff point affez tôt au rendez-vous de
la compagnie, eft mis en prifon, & le jour fniv-mt
pafle vingt tours par les verges ; tout bas-officier ,
pour la même faute; fart pendant un an Té fer vice
de foldat j Se tout officier eft mis en prifon pour
un an, & fa paye verfée dans la caifle des inva-
I lides.
I N D
INDÉCISION, Indétermination, caractère
d’un homme indécis, l’ un des défauts les plus grands
pour un militaire. .Un chef indécis voit le moment
où il doit agir} cependant une nouvelle réflexion,
un doute, une objection le fait héfiter, & il retombe
dans fon indécifion> mais pendant qu’ il
balance, l’occafion fuit, il la regrette} elle fe
préfente de nouveau , & il la laifle échapper.Vous
héfitez , dit un orateur moderne, & déjà l’épée
de votre ennemi a atteint votre coeur; peut-être
vaudroit-il mieux commettre, avec réfolution, urje
légère imprudence, que de flotter fans cefle'clans
l’indécifion.
Un-général fait Tes difpôfitions pour attaquer
l'ennemi} il fe met en mouvement, bien réfolu de
combattre : on eft prêt à en venir aux mains j il
héfite, il veut fe retirer & il eft battu } tel fut le
fort du duc d’Aumale dans la campagne de 1552}
telle fut encore la caufe de la défaite des Français
à Saint-Quentin. Montmorenci, indécis, ne fut
donner à propos, ni l’ordre de combattre ni celui
defe retirer. Jean d’Albret échoua dans fon projet
de reconquérir la Navarre, par cet efprit d’incertitude
qui l’avoit toujours empêché d’agir. Toutes
fes opérations furent lentes, parce qu’il étoit indécis,
Se malheureufes parce qu’ elles furent lentes.
L’empereur Charles-Quint eût été forcé dans
fes lignes d’ ingolftadt par les confédérés deSmal-
kade, s’ils avoient attaqué de vive force le jour
où ils fe contentèrent de canonner fes retranche-
mens ; le lendemain il n’étoit plus tems, & leur
indécifion leur avoit fait perdre le vrai moment
du fuccès.
Avant de prendre un parti, pefez-en avec foin
les avantages Se les inconvéniens ; mais décidés à
agir, marchez avec l’air de la confiance} celui de
l’indécifion eft toujours funefte : il faut favoir, à
la guerre , compter fur les talens des fubordonnés
choifis avec foin, & fur la valeur des troupes ,
après avoir pris toutes les précautions diélées par
la fageffe, l’expérience & les connoiflances que
l’on a dans l’art de la guerre.
> INDICE, ligne apparent & probable de la réalité
d’une chofe.
Le maréchal de Saxe, en parlant des indices à
la guerre, femble en négliger plufieurs, dont il
importe cependant aux chefs militaires d’acquérir
la connoiflance. Cet art de deviner fur de légères
indices ce que l’ennemi veut faire, eft fans doute
le fublime au génie du général. Cet art eft le démon
familier de Socrate & l’efprit de prophétie
dont quelques hommes de guerre ont cru important
de faire croire qu’ils étoient doués.. Il eft plus
fur Se plus étendu que l'art de l’efpionage : les
efpions font fouvent, ou trompeurs , ou trompés.
Des indices bien calculés induifent rarement en
erreur.
Les généraux modernes, dont l’hiftoire nous
parle commé1 lès. plus favans dans l’ art des indices ,
I N F ?o3
font Mercy Se Villars. Turenne & Condé préten-
doient que le premier avoit toujours prévenu leurs
defleins. Le duc de Savoie difoit du fécond : C e
duc de Villars eft forcier} il devine tout ce que
je dois faire.
Avec l’art des indices, on doit prévoir les proi-
jets de l’ennemi d'après fes mouvemens & fes
démonftrations, faufies ou vraies.
En étudiant le coeur humain , en connoiftant
les talens, le caractère, les intérêts, la nation ,
lés troupes de fon adverfaire & le théâtre de la
guerre , un général a de grandes données pour
faire de rapides progrès dans l’art des indices. C e t
arc ne doit pas être feulement néceflaire au gêné -
rai} il doit aufli être connu par les officiers & les
fous - officiers. 11 eft des indices qui annoncent
les embufeades } il en eft qui apprennent à diftin-
guer la force Se l’ efpèce d une troupe qui marche
j l ’aboiement des chiens pendant la nuit, le
henniffement des chevaux, le vol des oifeaux pendant
le jour, la pouflîère qui s’élève, tout peut
fervir d'indice à des yeux ou à des oreilles exercées,
& à un efprit habitué à réfléchir fur tout
ce qui fe pafle ou fe dit autour de lui.
INFAMIE, Punition m ilita ir e. Les peuples
guerriers les plus célèbres ont mis- l’infamie au
rang des punitions militaires 5- prefque tous ont
déclaré les .lâches & les traîtres infâmes j mais
prefque tous ont attaché à l'infamie des idées différentes.
Ici l’infamie a été prononcée par la loi >
là , par l’ opinion publique} ailleurs, par l’une Se
par l ’autre, & dans ce dernier cas feulement l’infamie
a'acquis la plus grande force. Convaincu aufli
de l’ efficacité d’une lo i , dès l’ inftant où elle eft
vifible Se accompagnée d effets qui privent celui
qui la fubit de quelques avantages, prefque tous
ont ajouté d’autres punitions à la peine de l’infamie.
Chez les Grecs, l’homme déclaré infâme ne
po'uvoit plus aflifter aux cérémonies religieufes ni
fe préfenter aux a Semblées générales, dans les
fêtes , les feftins publics, ni recevoir la fépulture
ordinaire des citoyens.
A Rome, il étoit privé du feu & de l’eau.
Chez les Germains, il ne pouvoit pas affifler
aux facrifices ni fe montrer au Ch smp-de- Mars.
Chez nos pères, l’homme déclaré infâme étoit
privé du commerce de fes pairs, dégradé &r déclaré
taillable, corvéable, main-momble-, Sec.
Parmi nous , l’homme déclaré infâme par l’opinion
ou même par la lo i, ne perd aucune de fes
propriétés ni aucun de fes droits; l’ eftfme feule
de fes connoi(Tances , de fes amis Se de fes proches
lui eft ravie.
La crainte de l’infamie, qui jadis étoit fi puif-
fante, doit donc nécefîairement l’être beaucoup
moins aujourd’h ui, les nations n’étant plus réparées
5. comme autrefois , par des préjugés difficiles
à furmonter. Un homme déclaré infâme par un