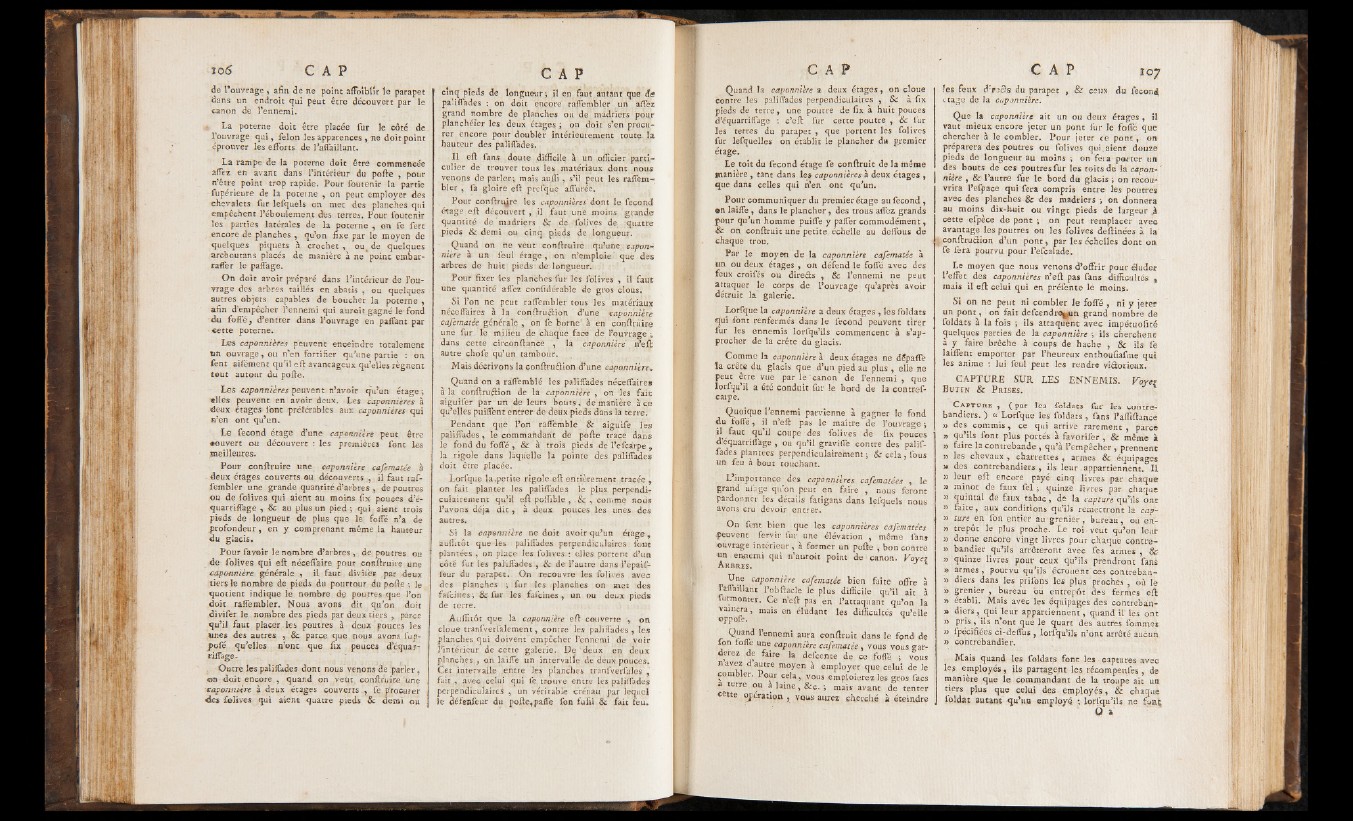
de l’ouvrage , afin de ne point affoiblîr le parapet
dans un endroit qui peut être découvert par le
canon de l’ennemi.
0 La poterne doit être placée fur le côté de
l’ouvrage qui, félon les apparences , ne doit point
. éprouver les efforts de l’affaillant.
La rampe de la poterne doit être commencée
affez en avant dans l’intérieur du porte , pour
n’etre point trop rapide. Pour foutenir la partie
fupérieure de la poterne , on peut employer des
chevalets fur lefquels on met des planches qui
empêchent l’éboulemen.t des terres. Pour foutenir
les parties latérales de la poterne , on fe fert
encore de planches , qu’on fixe par le moyen de
quelques piquets à. crochet , ou de quelques
arcboutans placés de manière à ne point embar-
raflèr le partage.
On doit avoir préparé dans l’intérieur de l’ouvrage
des arbres taillés en abatis , ou quelques
autres objets capables de boucher la poterne ,
afin d’empêcher l’ennemi qui auroit_gagné le- fond
d>u fbffé, d’entrer dans l’ouvrage en partant par
cette poterne.
Les caponnières peuvent enceindre totalement
on ouvrage, ou n’en fortifier qu’une partie : on.
fent aifément qu’il eft avantageux qu’elles régnent
tout autour du porte.
Les caponnicres peuvent n’avoir qu’un étage ;
«lies peuvent en avoir deux. Les caponnières à
deux étages font préférables aux caponnières qui
n’en ont qu’un.
Le fécond étage d’une caponnière peut être
«ouvert ou découvert : les premières font les
meilleures.
Pour conftruire une caponnière cafematée à
deux étages couverts ou découverts , il faut raf-
fembler une grande quantité d’arbres , de poutres
ou de foiives qui aient au moins fix pouces d’é-
quarriffage , & au plus un pied ; qui aient trois
pieds de longueur de plus que le foffé n’a de
profondeur, en y comprenant même la hauteur
du glacis.
Pour favoir le nombre d’arbres , de: poutres ou
de foiives qui eft néceffaire pour conftruire une
caponnière générale , il faut divif’er par deux
tiers le nombre de pieds du pourtour du porte -, le
quotient indique le nombre d§ poutres que l’on
doit raffembler. Nous avons dit qu’on doit
divifer le nombre des pieds par deux tiers , parce
qu’ il faut placer les poutres à deux pouces les
unes des autres , & parce que nous avons fup-
jîofé qu’elles n’ont que fix pouces d’équar-
riffage-
Outre les paliffades dont nous venons de parler,
on doit encore., quand on Vêtit, conftruite une
■ caponnière à deux étages couverts ., fe procurer j
des foiives qui aient quatre pieds 8c demi ou
cinq pieds de longueur-, il en faut autant que de
paîirtades : on doit encore raffembler un affez
grand nombre de planches ou de madriers pour
planchéïer les deux étages ; on doit s’en procurer
encore pour doubler intérieurement toute, la
hauteur des paîirtades, ■
Il eft fans doute difficile à un officier particulier
de trouver tous les matériaux dont nous
venons de parler-, mais aufli , s’il peut les raffem-
bler , fa gloire eft presque affuréb.
Pour conftruire les caponnières' dont le fécond
étage eft découvert , il faut une moins grande
quantité de madriers & de foiives de quatre
pieds & demi ou cinq pieds de longueur.
Quand on ne vèut conftruire qu’une eapon-
nière a un feul étage, ; on, n’emploie que des
arbres de huit pieds de-longueur.
Pour fixer les planches fur les foiives , il faut
une quantité artez confidérable de gros clous.
Si l’on ne peut raffembler tous les matériaux
néceffaires à la conftruciion d’une caponnière
cafematée générale , on fe borne', à en conftruire
une fur. le milieu de chaque face de l’ouvrage-,
dans cette circonftance , là caponnière n’eft
autre chofe qu’un tambour.
Mais décrivons la eonftruélion d’une caponnière•
Quand on a ràffemblé les paliflàdes néceffaires
à la conftruciion de la caponnière , on les fait
aiguifer par un de leurs bouts, de manière à ce
qu’elles puiffententrer de deux pieds dans la terre.
Pendant que l’on raffemble & aiguife les
paliffades, le commandant de porte trace dans
le fond du foffé , & à trois pieds de l’efcàrpe ,
la rigole dans laquelle la pointe des paliffades
doit être placée.
Lorfque la.petite rigole.eft entièrement tracée ,
on fait planter les paliffades le plus perpendiculairement
qu’il eft poffible , .& , comme nous
Pavons déjà d it, à deux pouces les unes des
autres.
Si la caponnière ne doit avoir qu’un étage,
aufiitôt que les paliffades perpendiculaires font
plantées , on place les foiives. : elles portent d’un
côté for les paliffades , & de l’autre dans l’épait-
fèur du parapet. :On recouvre les foiives avec
des planches -, fur les planches on met des
falcines; & for les fai cinés , un ou deux pieds
de terre.
Aufiitôt que la caponnière eft couverte , on
cloue tranfverlalement, contre les paliffades , les
planches qui doivent empêcher l’ennemi de voir
l’intérieur de cette galerie. De dçux en deux
planchas , on laiffe un intervalle de deux pouces.
Cet intervalle entre les planches tranfverfales ,
fait , avec,celui qui fe trouve entre les paliffades
perpendiculaires , un véritable c ré ri a ri par lequel
le déf&nfeur du porte,parte fon fufil 8c fait feu.
Quand la caponnière a deux ét3ges, on cloue
contre les paliffades perpendiculaires , & à fix
pieds de terre, une poutre de fix à huit pouces
d’équarriffage : c’eft fur cette poutre , & fur
les terres du parapet , que portent les foiives
fur lefquelles on établit le plancher du premier
étage.
Le toit du fécond étage fo conftruit de la même
manière , tant dans les caponnières à deux étages ,
que dans celles qui n*en ont qu’un.
Pour communiquer du premier étage au fécond ,
•n laiffe , dans le plancher, des trous artez grands
pour qu’un homme puiffe y paffer commodément,
& on conftruit une petite, échelle au deffous de
chaque trou.
Par le moyen de la caponnière cafematée à
un ou deux étages , on défend le foffé avec des
feux croifés ou direâs , & l’ennemi ne peut
attaquer le corps de l’ouvrage qu’après avoir
détruit la galerie.
Lorfque la caponnière a deux étages , les foldats
qui font renfermés dans le fécond peuvent tirer
fur les ennemis lorfqti’ils commencent à s’approcher
de la crête du glacis.
Comme la caponnière à deux étages ne départe
la crête du glacis que d’un pied au plus , elle ne
peut être vue par le'canon de l’ennemi , que
lorfqu’il a été conduit fur le bord de la contref-
carpe.
Quoique l’ennemi parvienne à gagner le fond
du foffé, il n’eft pas le maître de l’ouvrage ;
il faut qu’il coupe des foiives de fix pouces
d’équarriffage , ou qu’il gravide contre des palif-
Lades plantées perpendiculairement; 8c cela , fous
un feu a bout touchant.
L’importance des caponnières cafematées , le
grand uibge qu’on peut en faire , nous feront
pardonner les détails fatigans dans lefquels nous
avons cru devoir- entrer.
On fent bien que les caponnières cafematées
peuvènt fervit- for une élévation , même fans
ouvrage intérieur, à former un porte , bon contre
un ervnemi qui n’aurait point de canon. Voyez
A r b r e s . x
j auaiuant 1 obitade le plus difficile qu’il ait
lurmonter. Ce n’eft pas en l’attaquant qu’on 1
vaincra, mais en éludant les difficultés qu’ell
oppofe. *
^ennemî aura conftruit dans le fpnd de
Ion forte une caponnière cafematée , vous vous garderez
de faire la defeente de ce foffé ; vous
n avez d autre moyen à employer que celui de Je
combler. Pour cela, vous emploierez les gros facs
a terre ou a laine, 8cc. ; mais avant de tenter
cette opération , vous aurez cherché à éteindre
les feux d;P3cls du parapet , & ceux du fécond
ctage de la caponnière.
Que la caponnière ait un ou deux étages , îl
vaut mieux encore jeter un pont fur le forté que
chercher à le combler. Pour jeter ce pont, on
préparera des poutres ou foiives quis aient douze
pieds de longueur au moins -, on fera porter un
des bouts de ces poutres fur les toits de la capon
J nière , & l’autre fur le bord du glacis ; on recouvrira
l’efpace qui fera compris entre les poutres
avec des planches & des madriers -, on donnera
au moins dix-huit ou vingt pieds de largeur ü
cette efpèce de pont ; on peut remplacer avec
avantage les poutres ou les foiives deftinées à la
| conftruciion d’ un pont, par les échelles dont on
fe ièra pourvu pour l’efcalade.
Le moyen que nous venons d’offrir pour éluder
1 effet des caponnières n’eft pas fans difficultés ,
mais il eft celui qui en préfente le moins.
Si on ne peut ni combler le foffé , ni y jeter
un pont, on fait defeendra^gun grand nombre de
foldats à la fois ; ils attaquent avec impétuofité
quelques parties de la caponnière ; ils cherchent
à y faire brèche à coups de hache , & ils fe
laiffent emporter par l’heureux enthoufiafme qui
les anime : lui feul peut le-s rendr« vidorieux.
CAPTURE SUR LES ENNEMIS. Voyet
B u t in & P rises.
C aptur e , ( par les foldats fur les contrebandiers.
) «’Lorfque les foldats , fans l’affiftancë
» des commis, ce qui arrivé rarement, parce
» qu’ ils font plus portés à favorifer , & même à
» faire la contrebande , qu’à l’empêcher , prennent
» les chevaux , charrettes , armes 8c équipages
» des contrebandiers, ils leur .appartiennent. Il
» leur eft encore payé cinq livres par chaque
» minot de faux fel ; quinze livres par chaque
» quintal de faux tabac, de la capture qu’ils ont
>5 faite, aux conditions qu’ils remettront la cap-
» turc en fon entier au grenier , bureau , où eri-
» trepôt le plus proche. Le roi veut qu’on leur
» donne encore vingt livres pour chaque contre-
» bandier qu’ils arrêteront avec fes armes 8ç-
» quinze livres pour ceux qu’ils prendront fans
» armes, pourvu qu’ils écrouent ces contre ban-
» diers dans les prifons les plus proches , où Iè
» grenier , bureau ou entrepôt des fermes eft
» établi. Mais avec les équipages des contrebàn-
» diers, qui leur appartiennent, quand il lès ont
» pris, ils n’ont que le quart des autres fommes
» fpécifiées ci-deffus , lorfqu’ils n’ont arrêté aucun
» contrebandier.
Mais quand les foldats font les captures avec
les employés, ils partagent les récompensés , de
manière que le commandant de la troupe ait un
tiers plus que celui des employés , & chaque
foldat autant qu’ua employé ; lorfqu’ils ne font
Q *