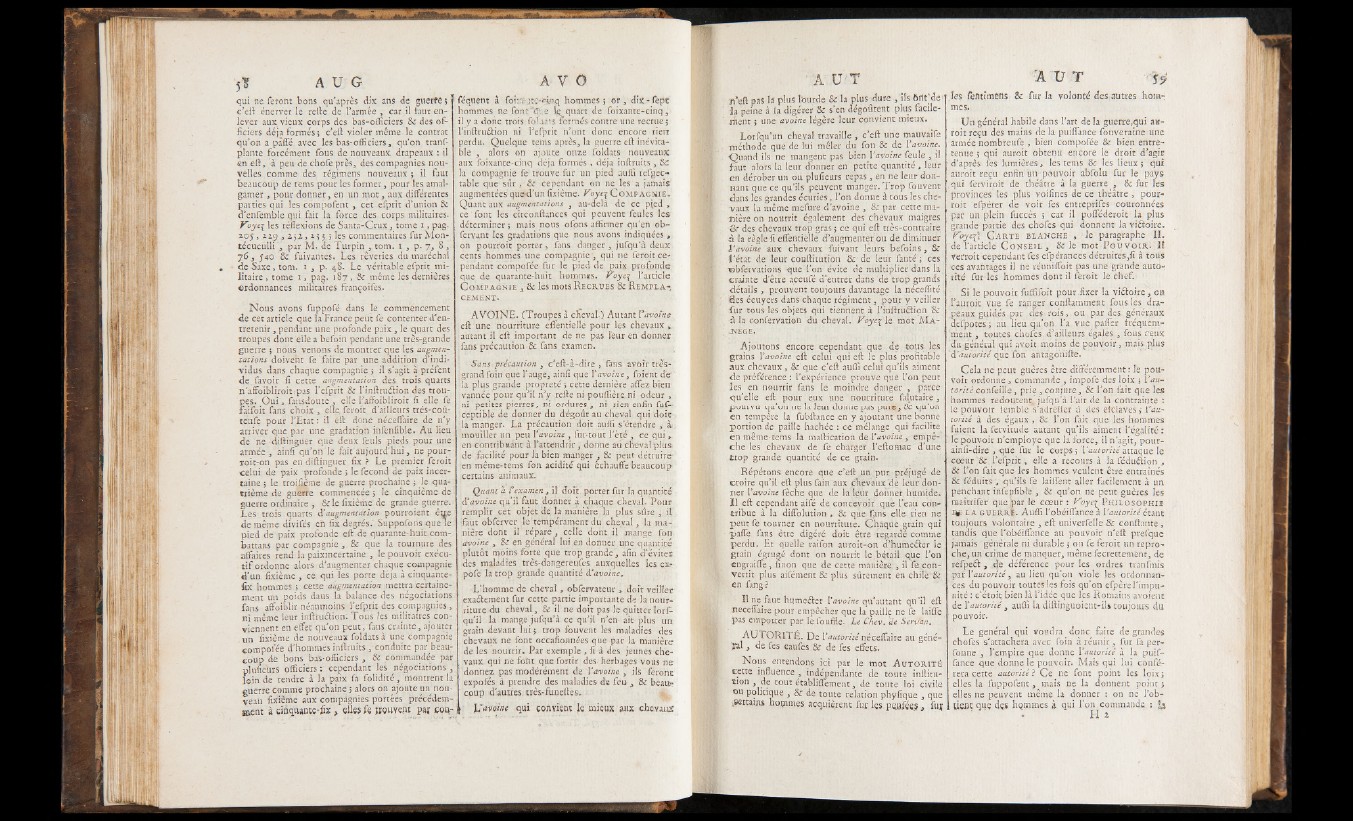
'jïr A U G
qui ne feront bons qu'âpres dix ans de guetté 5
c'eft énerver le refte de l'armée , car il faut enlever
aux vieux corps des bas-officiers 8c des officiers
déjà formés 5 c'eft violer même le contrat
qu'on a pafle avec les bas-officiers, qu’on tranf-
plante forcément fous de nouveaux drapeaux : il
en eft, a peu de chofe près, des compagnies nouvelles
comme des régimens nouveaux 5 il faut
beaucoup de tetris pour les former, pour les amalgamer
, pour donner, en un m o t, aux différentes
parties qui les compofent , cet'efprit d'union &
d'enfemble qui fait la force des corps militaires.
Voye^ les réflexions de Santa-Crux, tome 1 , pag.
2.05, 2 1 9 , 1 32., 233 5 les commentaires fur Mon-
técuculli , par M, de Turpin ,. tom. 1 , p. 7 , 8 ,
7 6 , 540 & fuivantes. Les rêveries du maréchal
de Saxe, tom. 1 , p. 48. Le véritable efprit militaire,
tome 1 , pag. 187, & même les dernières
©rdonnances militaires françoifes.
Nous avons fuppofé dans le commencement
de cet article que la France peut fe contenter d'entretenir
, pendant une profonde paix, le quart des
troupes dont elle a befoin pendant une très-grande
guerre 5 nous venons de montrer que les augmentations
doivent fe faire par une addition d'individus
dans chaque compagnie 3 il s’agit à préfent
de favoir fi cette augmentation des trois quarts
n ’affoibliroitcpas l’efprit 8c l'inftruétion des troupes.
O u i , fansdoute , elle l’affoibliroit fi elle fe
faifoit fans choix , elle, feroit d’ailleurs très-coû-
téufe pour l'Etat : il eft donc néceffaire de n'y
arriver que par une gradation infenfible. Au lieu
de ne diftinguer que deux feuls pieds pour une
armée, àinfi qu'on le fait'aujourd'hui, ne pour-:
Toit-on pas en diftinguer fix ? Le premier feroit
celui de paix profonde 3 le fécond de paix incertaine
3 le troifîéme de guerre prochaine 5 le quatrième
de guerre commencée 3 le cinquième de -
guerre ordinaire , & le fixième de grande guerre.-
JLes trois quarts d’augmentation pourroient eue
de même divifés en fix degrés.' Suppofons qu e le
pied de paix profonde eft de quarante-huit.com-
battans par compagnie, & que la tournure des
affaires rend la paixincertaine , le pouvoir exécut
i f ordonne alors d'augmenter chaque compagnie
d'un fixième , ce qui les porte déjà à cinquante-
fix hommes 5 cette augmentation -mettra certainement
un poids daus la balance des négociations
fans affaiblir néanmoins l’efprit des compagnies ,
ni même leur inftiuétion: Tous les militaires conviennent
en effet qu'on peut, fans crainte, ajouter
,un fixième de nouveaux foldatsà une Compagnie
compofée d’hommes inftruits,-conduite par beaucoup
de bons bas-officiers , & commandée par
plufieurs officiers : cependant les négociations,
loin de rendre à la paix fa- folidité, montrent la
guerre comme prochaine ; alors on ajoute un nouveau
fixième aux compagnies portées précédemment
à cihquante^fix > elles fe peuvent paï coût
A V O
féquent a foirAjtc-fripq hommes 3 o f , dix - fept
hommes n e fo n f t f ie le quart de foixante-cinq,
il y a donc trois foLui ‘s formés contre une recrue ;
l’inftruClion ni l'efprit n'ont donc encore rient
perdu. Quelque tems après, la guerre eft inévitable
, alors on ajoute onze foldats nouveaux
aux foixante-cinq déjà formés , déjà inftruits, 8c
la compagnie fe trouve, fur un pied auffi refgec-
table que sûr , & cependant on ne les a jamais
augmentées que*d'un fixième. Voyeç C o m p a g n i e .
Quant aux augmentations , au-delà de ce pied ,
ce font les circonftances qui peuvent feules les
déterminer 3 mais nous ofons affirmer qu’en ob-
fervant les gradations que nous avons indiquées ,
on pourroit porter, fans danger, jufqu’à deux
cents hommes line compagnie, qui ne feroit cependant
compofée fur le pied de paix profonde
que de quarante-huit hommes. Voye-{ l'article
C o m p a g n i e „ & les mots R e c r u e s 8c R e m p l a c
e m e n t .
A V O IN E . (Troupes à cheval) Autant I*avoine
eft une nourriture effentielle pour lés chevaux >.
autant .il eft important de ne pas leur en donner
fans précaution & fans examen-,
S ans ■ précaution , c'eft-à-dire , fans avoir très-
grand foin que l'auge, ainfi que Y avoine 3 foient de'
la plus grande propreté 5 cette dernière affez bien-
vannée pour qu'il n'y refte ni pouffière ni odeur ,
ni petites pierres,-ni ordures, ni rien enfin fuf~
ceptible de donner du dégoût au cheval qui doit'
la manger. La précaution doit auffi s’étendre , à:,
mouiller un peu Y avoine , fur-tout l’été , ce qui ».
en contribuant à l'attendrir , donne a-u cheval plus,
de facilité pour là bien manger , & peut détruire-
en même-rems fon .acidité qui échauffe beaucoup
certains animaux.
Quant a T examen t il doit porter fur la quantité
éiâvoine qu'il faut donner à chaque cheval Pour
remplir cet objet de la manière, la plus sûre , i l
!faut obférver le‘temperâment du cheyaï, la manière
dont il répare, celle dont il >mange fon.
avoine & en général lui.en donner une quantité
plutôt moins forte que trop grande , afin d'evites
des maladies très-dangereufes auxquelles les ex-
pofe la trop grande quantité d'avoine*
L'homme de cheval, obfervateur, doit veillèr
exaélement fur cetçe partie importante de la nourriture
du cheval, 8c il ne doit pas le quitter lorfc
qu'il la mange j-ufqu'à. ce qu'il n'en- ait plus urr.
: grain devant lui 5. trop fouvent les maladies des
chevaux ne font occafionnées que par la manière
de les nourrir. Par exemple , fi a des jeunes chevaux,
qui ne foflt que fortir des herbages vous ne
donnez pas modérément de Y avoine , ils feront
expofés à prendre des maladies de feu & beau*
coup d'autres, très-funeftes..
. léavoinc qui convient Je mieux *uix chevaux
"A U T
n’eft pas la plus lourde & la plus dure , ils BrttMe |
la peine à la digérer & s'en dégoûtent plus facile-
ment 3 une avoine légère leur convient mieux.
Lorfqu'un cheval travaille, c’eft une mauvaife
•méthode que de lui mêler du fon & de Yavoine. Quand ils ne mangent pas bien Yavoine feule , il
faut alors la leur donner en petite quantité, leur
en dérober un ou plufieurs repas, en ne leur donnant
que ce qu’ils peuvent manger. Trop Couvent
dans les grandes écuries, l’on donne à tous les che-
•vaux la même mefure d'avoine , 8c par cette ma- ,
■ Bière on nourrit également des chevaux maigres
<Sr des chevaux trop gras 5 ce qui eft très-contraire
la règle fi effentièlle d'augmenter,' ou de diminuer
Vavoine aux chevaux fuivant leurs befoins, &
l ’état de leur conftitution 8c de leur fanté 5 ces ■ ©bfervatiohs que l'on évite de multiplier dans la
crainte d’être accufé d’entrer dans de trop grands ,
détails , prouvent toujours davantage la néceffité ij
fies écuyers dans chaque régiment, pour y veiller .
fur tous les objets qui tiennent à l'iuftruétion 8c ;
à la confervation du cheval. Voyelle mot M a - ■
J4ÈGE,
Ajoutons encore cependant que de tous les
grains Y avoine eft celui qui eft le plus profitable
aux chevaux , & q u e c'eft auffi celui qu’ils aiment ;
de préférence : l'expérience prouve que l'on peut les en nourrir fans le moindre danger., parce- ■ qu’elle eft pour eux une nourriture falutaire,
pourvu qu'on ne la leur donne pas pure, & qu’on
en tempère la fubftance en y ajoutant une bonne
portion de paille hachée : ce mélange qui facilite
en même-tems la maftication de Y a v o in e empêche
les chevaux de fe charger i’eftomac d'une
trop grande quantité de ce grain.
Répétons encore que c'eft un pur préjugé de
croire qu'il eft plus fain aux chevaux 'dé leur donner
Y avoine fèche que de la leur donner humide.
I l eft cependant aifé de concevoir que l'eau contribue
à la diflolution, 8c que fans elle rien ne
peut fe tourner en nourriture. Chaque grain qui
pafle fans être digéré doit être -regardé comme
perdu. Et quelle raifon auroit-on d’humeéter le
grain égrugé dont on nourrit le.bétail que l'on
engraifle, finon que de cette manière , il fe.convertit
plus aifément & plus sûrement en chilè &
en fang?
Il ne faut humeéler Yavoine qu'au tant qu’il eft
tieceflaire pour empêcher que la paille ne fe laifle
pas emporter par le fouffie. Le Chev. Kde Servan.
A U TO R IT É . De Y autorité néceffaire au gqné-
^ 1 3 °le fes caufes 8c de fes effets.
N o u s e n te n d o n s ic i p a r le m o t A u t o r i t é
c e tte in flu e n c e 3 in d é p e n d a n te d e t o u t e in f titu -
t io n , d e t o u t e ta b lif f e m e n t, d e to u t e lo i c iv ile
o u p o litiq u e , 8c d è t o u t e re la tio n p h y fiq u e , q u e
.c e rta in s h o m m e s a c q u iè r e n t fur le s p e iîfé e s , fu r
A V T
.les lefltimens 8c fur la volonté des autres hommes.
Un général habile dans l'art de la guerre,qui au-
roit reçu des mains de la puiffance fotiveraine une
armée nombreufe , bien compofée 8c bien entretenue
5 qui auroit obtenu encore le droit d’agir
d'après fes lumières, les tems 8c lés lieux 5 qui
auroit reçu enfin un pouvoir abfolu fur le pays
, qui ferviroit de théâtre à la guerre , & fur les
provinces les plus voifines de ce théâtre , pourroit
efpérer de voir fes entreprifes couronnées
par un plein fuccès 5 car il pofféderoit la plus
grande partie des chofes qui donnent la viétoire.
Vbye$ C a r t e b l a n c h e , le paragraphe II.
de l'article C o n s e i l , & le mot P o u v o i r . Il
verroit cependant fes efpérances détruites,fi à tous
ces avantages il ne réühiffoit pas une grande autorité
furies hommes dont il feroit le chef. '
Si le pouvoir fuffifoit pour .fixer la viéloire, oa
,1’auroit vue fe ra.nger' conftamment fous les drapeaux
:guid.és par des rois, ou par des généraux
d.efpotes 3 au lieu qu'on l'a vue paffer fréquemment
, toutes chofes d'ailleurs égales., fous ceux
du général qui avoit moins de pouvoir, mais plus
à‘autorité que Ton antagôiïifte.
Cela ne peut guères être différemment: le pouvoir
ordonne, commande , impofe des loix 5 Y autorité
confeille, prie, conjure, 8c l'on fait que les
hommes redoutent jufqu’à l ’air de la contrainte :
le pouvoir fetnbîe s’adreffer à des efclaves > Yautorité
à des égaux, 8c l’on fait que les hommes
fuient la fervitude autant qu'ils aiment l'égalité :
le pouvoir n'employe que la force, il n’agit, pour-
ainfi-dire , que fur le corps 5 Y autorité attaque le
coeur v& l'efp rit, elle a recours à la fédu&ion ,
& l'on fait que les hommes veulent être entraînés
8c féduits , qu'ils fe laiffent aller facilement à un
penchant infenfible , 8c qu'on ne peut guères les
raaïtrifer quejpar le coeur : Voye1 Ph ilo soph ie
H# LA guerre. Auffi l’obéiffance à l ’^ romé étant
toujours volontaire , eft univerfelle 8c conftante,
tandis que l’obéiffance au pouvoir n'eft prefque
jamais générale ni durable 3 on fe feroit un reproche,
un crime de manquer, même fecrettemènt, de
refpeéi:, jâe déférence pour les ordres tranfmis
.par Y autorité y au lieu qu'on viole les ordonnances
du pouvoir toutes les fois qu'on efpère l'impunité
: c'étoit bien là l'idée que les Romains avoient
de Y autorité , auffi la diftinguoient-ils toujours du
' pouvoir.
Le général qui voudra donc faire de grandes
chofes s'attachera avec foin à réunir, fur fa per-
fonne , l'empire que donne Yautoritê à la puiffance
que donne le pouvoir. Mais qui lui conférera
cette autorité ? C e ne font point les loix \
elles la fuppofent, mais ne la donnent point ;
elles ne peuvent même la donner : on ne fob-
1 tieat que dçs hQpimes à qui Ton. commande :
: Hz