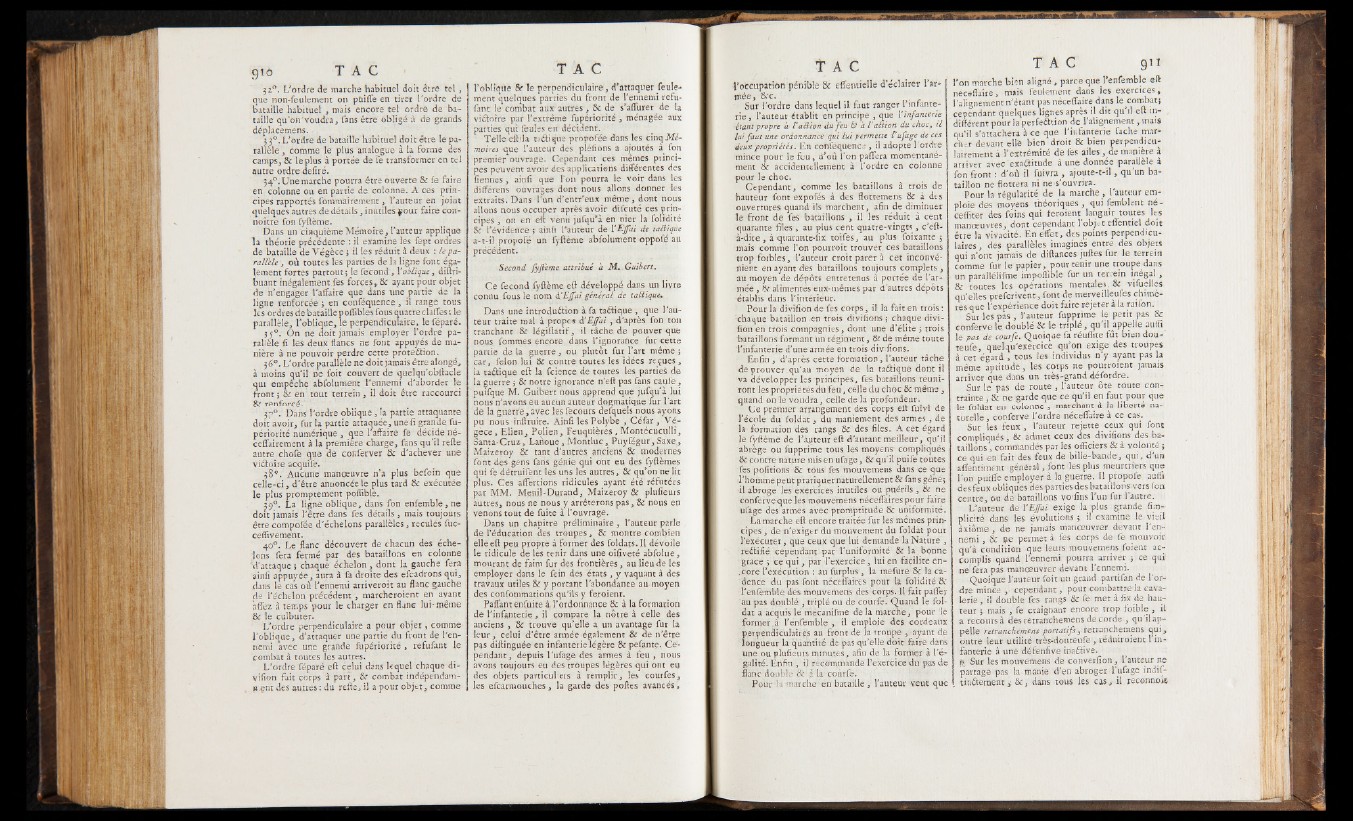
3 2°. L'ordre de marche habituel doit être t e l ,
que non-feulement on ptiiffe en tirer l'ordre de
bataille habituel , mais encore tel ordre de bataille
qu’on'voudra, fans être obligé à de grands
déplacemens.
3 30. L'ordre de bataille habituel doit être le parallèle
, comme le plus analogue à la forme des
camps, & le plus à portée de le transformer en tel
autre ordre aefiré.
'34°. Une marche pourra être ouverte & fe faire
en colonne ou en partie de colonne. A ces principes
rapportés fommairement , l'auteur en joint
quelques autres de détails , inutiles j?our faire con-
noître fon fyftème.
Dans un cinquième Mémoire, l’auteur applique
la théorie précédente : il examine les fept ordres
de bataille de Végèce > il les réduit à deux : U parallèle'
3 où toutes les parties de h ligne font également
fortes partout j le fécond, Y oblique 3 diftri-
buant inégalement.fes forces, & ayant pour objet
de n'engager l'affaire que dans une partie de la
ligne renforcée j en conféquence, il range tous
les ordres de bataille poflibles fous quatre claffes t le
parallèle, l'oblique, le perpendiculaire, le féparé.
3y°. On ne doit jamais employer l’ordre parallèle
û les deux flancs ne font appuyés de manière
à ne pouvoir perdre cette protection.
3 6°. L’ordre parallèle ne doit jamais être alongé,
à moins qu'il ne foit couvert de quelqu'obffacle
qui empêche abfolument l'ennemi d’aborder le
front j & en tout terrein, il doit être raccourci
& renforcé.
37°. Dans l’ordre oblique, la partie attaquante
doit avoir, fur la partie attaquée, une-fi grande fu-
périorité numérique , que l'affaire fe décide né-
ceflairement à la première charge, fans qu'il refte
autre chofe que de conferver & d’achever une
victoire acquifè.
38*. Aucune manoeuvre n'a plus befoin que
celle-ci, d’être annoncée le plus tard & exécutée
le plus promptement pofîible.
390. La ligne oblique, dans fon enfemble, ne
doit jamais l’être dans fes détails, mais toujours
être compofée d’ échelons parallèles, reculés fuc-
ceflivemçnt.
40°. Le flanc découvert de chacun des échelons
fera fermé par des bataillons en colonne
'd’attaque > chaque échelon, dont la gauche fera
ainfi appuyée, aura à fa droite des efcadrons qui,
dans le cas où l’ennemi arriveroit au flanc gauche
de l’échelon précédent, marçheroient en avant
kffez à temps pour le charger en flanc lui-même
& le culbuter.
L'ordre perpendiculaire a pour o b je t , comme
l ’oblique, d’attaquer une partie du front de Lem-
nemi avec une grande fupériorité , refufant le
combat à toutes les autres,
L'ordre féparé eft celui dans lequel chaque di-
vifion fait corps à part, & combat indépendam-
n.§nt des autres : du refte, il a pour objet, comme
robliqüe & le perpendiculaire, d’attaquer feulement
quelques parties du front de l’ennemi refufant
le combat aux*autres, & de s'aflfurer de la
viéloîre par l’extrême fupériorité , ménagée aux
parties qui feules en décident.
Telle effila tactique propofée dans les cinq Mé~
;noires que l’auteur des plélions a ajoutés à fon
premier ouvrage. Cependant ces mêmes principes
peuvent avoir des applications différentes des
fiennes, ainfi que l’on pourra le voir dans les
différens ouvrages donc nous allons donner les
extraits. Dans Lun d'entr’eux même, dont nous
allons nous occuper après avoir difeuté ces principes
, on en eft venu jufqu’ à en nier la folidité
8c l'évidence 5 ainfi l'auteur de ŸEjfai de lattique
a-t-il propofé un fyftème abfolument oppofé au
précédent.
Second Jyjl'eme attribué a JM. Guibert.
C e fécond fyftème eft développé dans un livre
Connu fous le nom if’Ejfai général de tactique.
Dans une introdu&ion à fa tactique , que l'auteur
traite mal à propos d’Ejfai , d’après fon ton
tranchant & légiflatif, il tâche, de pouver que
nous fommes encore dans l'ignorafice fur cette
partie de la guerre, ou plutôt fur l’art même j
car, félon lui & contre toutes les idées reçues,
la taCtique eft la fcience de toutes les parties de
la guerre i & notre ignorance n’eft pas fans caufe,
puifque M. Guibert nous apprend que jufqu’à lui
nous n'avons eu aucun auteur dogmatique fur l'art
de la guerre,avec les fecours defquèls nous ayons
pu nous înftruire. Ainfi les Polybe , Céfar , Végèce,
Elien, Polien, Feuquières, Montécuculli,
Santa-Cruz, Laîioue, Montluc, Puyfégur, Saxe.,
Maizeroy & tant d'autres anciens & modernes
font des gens fans génie qui ont eu des fyftèmes
qui fe détruifent les uns les autres, & qu'on ne lit
plus. Ces affertions ridicules ayant été réfutées
par MM. Menil-Durand, Maizeroy & plufieurs
autres, nous ne nous y arrêterons pas, & nous en
venons tout de fuite à l’ouvrage.
Dans un chapitre préliminaire, l'auteur parle
de l’éducation des troupes, & montre combien
elle eft peu propre à former des foldats.il dévoile
le ridicule de les tenir dans une oifiveté abfolue,
mourant de faim fur des frontières, au lieu de les
employer dans le fein des états , y vaquant à des
travaux utiles & y portant l'abondance au moyen
des çonfommations qu’ils y feroienr.
Paflant ênfuite à. l’ordonnance & à la formatioh
de l'infanterie, il compare la nôtre à celle des
anciens , & trouve qu'elle a un avantage fur la
leur, celui d'être armée également & de n'être
pas diftinguée en infanterie légère & pefante. Cependant,
depuis Tufage des armes à fe u , nous
avons toujours eu des troupes légères qui ont eu
des objets particulers à remplir, les courfes,
les efcarmouches, la garde des poftes avancés,
l'occupation pénible & effentielle d’éclairer l’armée,
&'c. }
Sur l ’ordre dans lequel il faut ranger l’ infanter
ie , l’auteur établit en principe , que Yinfanterie
•étant propre a VaStion du feu £>’ a iaÛion du choc, il
lui faut une ordonnance qui lui permette l'ufage de ces
deux propriétés. En conféquence , il adopte l'ordre
mince pour le feu, d'ou l’on paffera momentanément
& accidentellement à l'ordre en colonne
pour le choc.
Cependant, comme les bataillons à trois de
hauteur font expefés à des flottemens & à des
ouvertures quand ils marchent, afin de diminuer
le front de fes bataillons , il les réduit à cent
quarante files , au plus cent quatre-vingts , c'eft-
à-dire, à quarante-lïx toîfes, au plus foixante j
mais comme l’on pourrait trouver ces bataillons
trop foibles, l’auteur croit parer à cet inconvénient
en ayant des bataillons toujours complets,
au moyen de dépôts entretenus à portée de l'armée
, & alimentés eux-mêmes par d'autres dépôts
établis dans l'intérieur.
Pour la divifion de fes corps, il la fait en trois :
chaque bataillon.en trois divifions j chaque divifion
en trois compagnies, dont une d'élite 5 trois
bataillons formant un régiment, & de même toute
l’infanterie d’une armée en trois div.fions.
Enfin , d'après cette formation, l’auteur tâche
de prouver .qu’au moyen de la tactique dont il
va développer les principes, fes bataillons réuniront
les propriétés du feu, celle du choc & même ,
quand on le voudra, celle de la profondeur;
Ce premier arrangement des corps eft fuivi de
l’école du foldat, du maniement des armes, de
la formation des rangs & des files. A cet égard
le fyftème de Tuteur eft d'autant meilleur, qu’il
abrège ou fupprime tous les moyens compliqués
& contre nature mis en ufage, & qu’il puife toutes
fes polirions & tous fes mouvemeBS dans ce que
l’homme peut pratiquer naturellement & fans gêne;
il abroge les exercices inutiles ou puérils, & ne
conferveque les mouvemens néceffairespour faire
ufage des armes avec promptitude & uniformité.
La marche eft encore traitée fur les mêmes principes
, de n’exiger du mouvement du foldat pour
l'exécuter, que ceux que lui demande la Nature ,
reétifié cependant par l’ uniformité & la bonne
grâce j ;ce q u i, par l’exercice, lui en facilite en-
.core l'exécution : au furplus , la mefure 8c la cadence
du pas font néceffaires pour la folidité &r
l’enfemble des mouvemens des corps. 11 fait palier
au pas doublé , triplé ou de courfe. Quand le foldat
a acquis le mécanifme delà marche, pour le
former , à l’énfemble , il emploie des cordeaux
perpendiculaires au front de la troupe , ayant de
longueur la quantité de pas qu’elle doit faire dans
une ou plufieurs minutes, afin de la former à l ’égalité.
Enfin , il recommande l’exercice du pas de
flanc double & à la courfe.
Pour la marche en bataille , l’auteur veut que
l’ on marche bien aligné, parce que l’enfemble eft
néceffaire, mais feulement dans les exercices,
l 'alignement n’étant pas néceffaire dans le combat;
cependant quelques lignes après il dit qu’ il eft indifférent
pour la perfefttion de l’alignement, mais
qu’il s’attachera à ce que l’infanterie fâche marcher
devant elfe bien droit & bien perpendiculairement
à l’extrémité de fes ailes , de maniéré a
arriver avec exactitude à une donnée parallèle à
fon front : d’où il fuivra , ajoute-t-il, qu un bataillon
ne flottera ni ne s ’ouvrira.
Pour la régularité de la marche, l'auteur emploie
des moyens théoriques , qui femblent né-
ceffiter des foins qui leroient languir toutes les
manoeuvres, dont cependant 1 obj-t eflentiel doit
être la vivacité. En effet, des points perpendiculaires,
des parallèles imaginés entre des objets
qui n’ont jamais de diftances juftes fur le terreirt
comme fur le papier, pour tenir une troupe dans
un parallélifme impoflible fur un terrein inégal ,
& toutes les opérations mentales. & vifuelles
qu’ elles preferivent, font de merveilleufes chimè-
resque l'expérience doit faire rejeter à la raifon.
Sur les pas , l’auteur fupprime le petit pas &
conferve le doublé & le triplé, qu'il appelle auflï
le pas de courfe. Quoique fa réuflïte fût bien dou-'
teufe, quelqu'exercice qu'on exige des troupes
à cet égard , tous les individus n y ayant pas la
même aptitude, les corps ne pourroienc jamais
arriver que dans un très-grand défordre.
Sur le pas de route, l’auteur ôte toute con^
trainte, & ne garde que ce qu’il en faut pour que
le foldat en colonne , marchant à la liberté naturelle
, conferve l’ordre néceffaire à ce cas.
Sur les feu x , l’auteur rejette ceux qui font
compliqués, & admet ceux des divifions des bataillons
, commandés par les officiers & à volonté ;
ce qui en fait des feux de bille-bande, qui. d’un
affentiment général, font les plus meurtriers que
l'on puiffe employer à la guerre, il propofe. aulfi
des feux obliques des parties des bataiilons vers fon
centre, ou de bataillons vo^ns l’un fur l’autre..
L’auteur de YEffai exige la plus grande fim-
plicité dans les évolutions ; il examine le vieil
axiome, de ne jamais manoeuvrer devant l’ennemi
, & pe permet à fes corps de fe mouvoir
qu’à condition que leurs mouvemens/oient accomplis
quand l’ennemi pourra arriver ; ce qui
ne fera pas manoeuvrer devant l'ennemi.
Quoique l ’auteur foit un grand partifan de l'ordre
mince , cependant, pour combattre la cavalerie
, il double fes rangs & fe met à fix de hauteur
; mais , fe craignant encore trop foible , il
a recours à des retranchetnens de corde , qu i! appelle
retranchemens portatifs, retranchemens qui ,
outre leur utilité très-douteufe, rëduiroient l’ infanterie
à une défenfive inaétive.
fë. Sur les mouvemens de converfion, l’auteur ne
partage pas la manie d’en abroger T ufage indif-
tinâetnent, & , dans tous les cas, i) reconnok