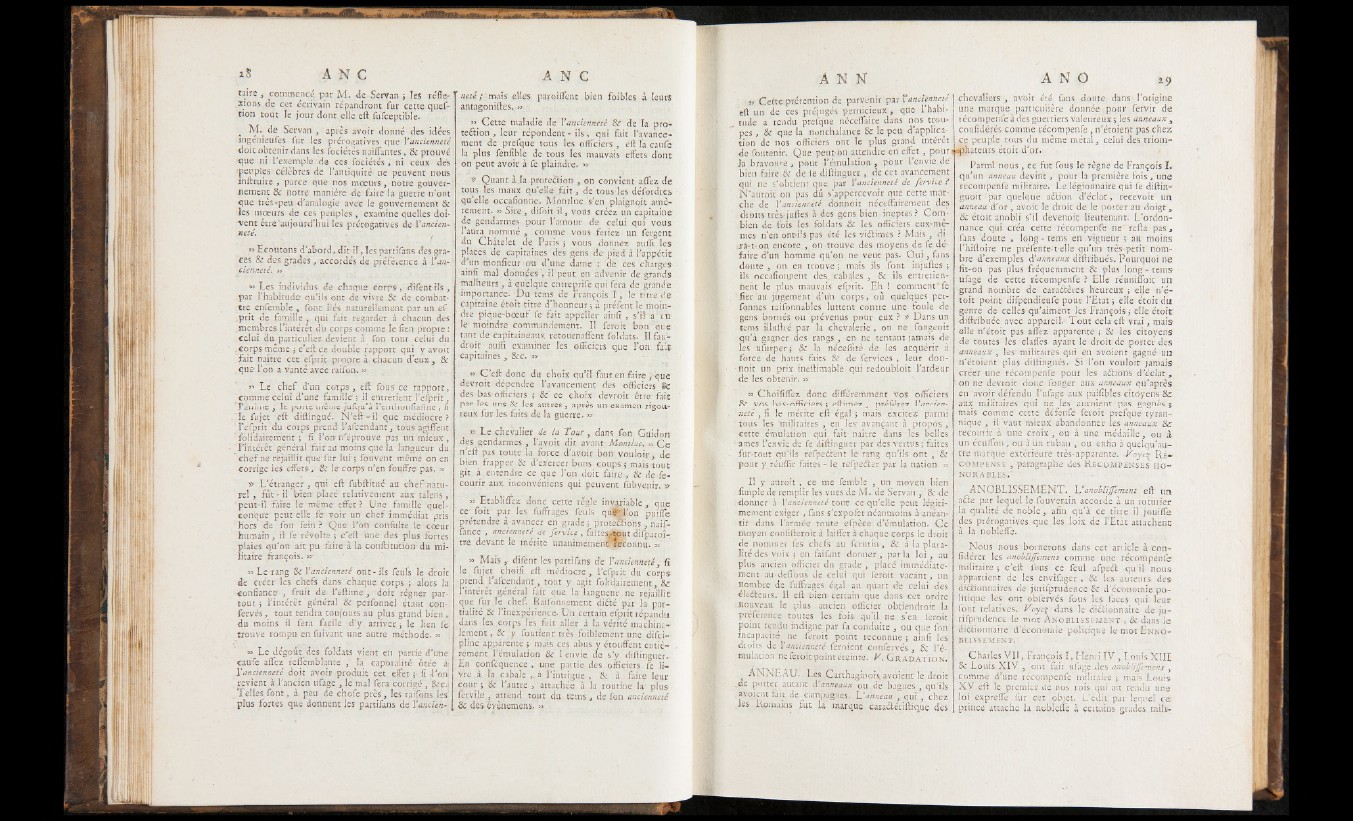
f i A N C
taire * commencé par M . de Servan 5 les réflexions
de cet écrivain répandront fur cette question
tout le jour dont elle eft fufc'eptible.
M. de Servan , après avoir donné des idées
•ingenieufes fur les prérogatives que Yancienneté
doit obtenir dans les fociétés naiffantes, & prouvé
que ni l'exemple de ces fociétés, ni ceux dés
•peuples célèbres de l'antiquité ne peuvent nous
inltruire, parce que nos moeurs, notre gouvernement
& notre manière de faire la guerre n'ont
que très-peu d)’an-alogie avec le gouvernement &
les moeurs de ces peuples, examine quelles doivent
être'aujourd’hui les prérogatives de Yancienneté.
» Ecoutons d’abord, dit-il, les partifans des grâces
& des grades , accordés de préférence à Yancienneté.
n '
M Les individus de chaque corps-, difent-rl's ,
par l’habitude qu’ils ont de vivre & de combattre
enfemble , font liés naturellement par un ef-
prit de famille, qui fait regarder à chacun des
membres 1 intérêt dit corps comme le lien propre :
celui du particulier- devient à- fon tour celui d u .
.corpsmême ; c’eft ce double rapport qui y avoit
fait naître cet efprit propre à chacun d’e u x , &
.que l’on a vanté avec raifo-n, «
« Le chef d’un corps, eft fous ce rapport,
comme celui d’ un a famille; il entretient l’efprit,
l’anime , le porte même jufqu’à l’ènthoufîafme, fi
le fujet eft diftingué.- N ’eft - i l que médiocre ?
FefpriY du corps prend l’afcendanr, tous agiffent
folidairerôent ; fi l’oir n’éprouve pas un mieux ,
l ’intérêt général fait au moins que la langueur du
chef ne rejaillit que far lui' ; fouvent même on en
corrige les effets ;- & lé-corps n’en fouffre pas. »
» L ’étranger, qui eft fubftitué au chef;naturel
, fut - il bien placé relativement aux talens ,
peut-il faire le même- effet ? Une famille quelconque'
peur elle fe voir un chef immédiat pris
Hors de foir fein ? Que l ’on confuite le coeur
humain , il fe révolte ; c’ eft une des plus fortes
. plaies q.u’on: ait pu faire à la conftitutiôn- du militaire
françois.-w-
33 Le rang & Yanchnnetê ont-ils leiils le droit
de créer les chefs dans chaque corps ; alors la
confiance , fruit de l’eftime, doit régner partout
5 l’intérêt général & perfonnel étant con- ,
fervés, tout tendra toujours au plus grand bien
du moins il fera facile d’y arriver ; le lien fe
trouve rompu en fuivant une autre méthode. >3 ■
33 Le dégoût des foldats vient en partie d’une
caufe affez reffemblante , fa caporalité otée à--
Yancienneté doit avoir produit cet effet- 5- fi -4’op
revient à .l’ancien ufage , le mal fera corrigé , &e-i
Telles font, à peu de chofe près, les raifons lés-
plus fortes que donnent les parcifans de Yancien-
A N C
r neté ; ' mais elles paroiffent bien foibles à leurs
antagoniftes. «
33 Cette maladie de Yancienneté & de la- protection
, leur répondent - i l s , qui fait l’avancement
de prefque tous les officiers , eft la caufe
la plus fenfible de tous les mauvais effets dont
on peut avoir a fe plaindre. 3»
» Quant à,fa protection , on convient affez de
tops les maux qu’elle fa it, de tous les défordres
qu’elle occafidnne» Montluc s’en plaignoit amèrement.
»3 Sire, difoit-il, vous créez un capitaine
de gendarmes pour l’amour de celui qui vous
l’aüra nommé , comme vous feriez un fergenc
du Châtelet de Paris ; vous donnez auffi les
places de capitaines des gens de pied à l’appétit
d’un monfieur ou d’une dame : de ces charges
ainfi mal données , il peut en advenir de grands
malheurs , à quelque entreprife qui fera de grande
importance. Du terris de François I , le titre de
capitaine étoit titre d’honneur ; à préfent le .moindre
pique-boeuf fe fait appeller ainfi , s’il' a' eû
le- moindre commandement. Il feroit bon que:
tant de capitaineaux. retournaffent foldats. Il fau-
droit auffi examiner les officiers que l’on fait
capitaines, &c. 3*
33 C ’eft donc du choix qu’ il faut en faire /que
devroit dépendre l’avancement des officiers
des bas-officiers ; & ' ce choix devroit être fait
par les uns & les autres , après un examen rigoureux
fur les faits de la guerre.- 33'
33 Le chevalier de la Tour, d’ans fon Guidon'
des gendarmes , l’avoit dit avant Montluc. ™ C e
n’eft pas toute la force d’avoir bon vouloir , de
bien frapper & d’exercer bons coups; mais tout
gît à.entendre ce que l’on doit faire , & de recourir
aux- inconvéniens qui peuvent fubvenir.- »
si Etabliffez donc cette règle invariable, que
ce- foit par les fuffrages feuls q u ^ l’on puiffe
prétendre à avancer en grade; protections, naif-
fance , ancienneté^ de Jervice , faites^*)ut difparoî-
tre devant le mérite unanimement reconnu. 33
33 M a i s d ï fé n t les partifans de Yancienneté, fi
le fujet choifi eft médiocre 3 l'efprit du corps-
prend Tafcendant, tout y agit (blfdairément, &
l'intérêt général fait que la- langueur ne rejaillit
que fur,le chef. Raisonnement diète par la partialité
& l'inexpérience. Un certain efprit répandu
dans les corps lés fait aller à la vérité machinalement,.
& y Soutient très foibiement une difei-
pline apparente ; mais ces abus y étouffent entièrement
l'émulation & l'envie de s'y diftinguer-
En eonféquence , une partie des officiers fe livre
.à la cabale „ à- l'intrigue , & à faire leur
cour ; & l’autre, attachée à la routine la plus
feçvile , attend tout du t’ems, de fon ancienneté
& desevènemens.
A N N
# Cette prétention de parvenir par Yancienneté
feft un de ces préjugés pernicieux,- que l’habitude
a, rendu prefque néceffaire dans nos troupes
, & que la nonchalance & le peu, d’ application
de nos officiers ont le plus grand intérêt
de fou,tenir. Que peut-on attendre en effet, pour
là bravoure , pour l’émulation , pour 1 envie dé
bien faire & de (e diftinguer , de cet avancement
qui. ne s’obtient; que par Yancienneté de fervice
N ’auroit on pas dû s’appércevoir que cette mar
che de Yancienneté dôrinoit néceffairément de
droits très-juftes à des gens bien ineptes ? Côm
bien de fois les. foldats & les officiers eux-mê
mes n’en ont-ils. pas-, été les victimes ? M a is , di
urâ-t-on encore , on trouve des moyens de fe dé
faire d’un homme qu’on ne veut pas. Qui , fan
doute , on en trouve ; mais ils font injuftes
ils occafion.nent des. cabales , & ils entretien
fient le plus mauvais efprit. Eh ! comment* fe
fier au jugement d’u'n corps, où quelques per-
fo.nnes raifonnables luttent contre une foule de
gens bornés ou prévenus pour eux ?' >> Dans un
tems ilhiftré par la chevalerie, on ne fongeoit
çgu’à gagner des rangs, en ne tentant jamais de
les ufurper; & la néceffité de les acquérir à
force de hauts faits & de fervices , leur don-
noit un prix ineftimable qui redoubloit l’ardeur
de les obtenir. #
33 Choififfez donc différemment vos officiers 8c vos bas-officiefs-; eftimez, préférez Yancienneté
, fi le mérite eft égal ; mais excitez parmi
tous les 'militaires , en les* avançant à propos,
eette émulation qui fait naître dans les belles
âmes l’envie d'e fe diftinguer par des vertus; faites
fur-tout qu’ils refpeéfent le rang qu’ils ont , &
pour y réuffir faites - le refpe<fter par la nation. 33
Il y auroit , ce me femble , un moyen bien
fimple de remplir les vues de M. de Servan de
donner à Yancienneté tout ce qu’elle peut légitimement
exiger, fans s’expofer néanmoins à anéantir
dans l’armée toute efpèee d’émulation. C e
moyen confifteroit à laiffer à chaque corps le droit
de nommer fes chefs au ferutin , & à la pluralité
des voix ; en fai finit donner, parla lo i , au
plus ancien officier du grade , placé immédiatement
au-defiôus de celui qui ferbit vacant, un
nombre de fuffrages égal au quart de celui des
électeurs. Il eft bien certain que dans cet ordre
nouveau le plus ancien officier obtiendroit la
préféience toutes les fois*, qu’il, ne s’en feroit
point rendu indigne par fa conduite , ou que fon
incapacité ne feroit point reconnue ; ainfi léserons
de Y ancienneté feroient confervés , & l’é-i
mulation ne feroit point éteinte. K G r a d a t io n .'
A N N E A U . Les Carthaginois avôient le droit
„de porter autant (.Vanneaux ou de bagues, qu’ils
avoient fait dé campagnes. L ‘anneau , qui , chez
les Romains fut lu marque cataétériftique des
A N O 1 y
chevaliers ', avoir été. fans doute- dans l’origine
une marque particulière donnée pour fervir de
récompenfe à des guerriers Valeureux ; les anneaux
confidérés comme récompenfe, n’étoient pas chez
ç,e peuple tous du même métal, celui des triom-
iwphateurs étoit d’or.
Parmi nous , ce fut fous le règne de François I.
qu’ un anneau devint, pour la première fois, une
récompenfe militaire. Le légionnaire qui fe diftin-
guoit par quelque aétion d’éclat, recevoit un
anneau d’o r , avoit le droit de le porter au doigt,
& étoit anobli s’il devenoit lieutenant. L’ordonnance
qui créa cette récompenfe rie'rëfta pas,
fans ’doute , lqng - tems en - vigueur ; au moins
l’hiftoiré ne préfeiite-t-elle qu’ un très-petit nombre
d’exemples d'anneaux diftribués. Pourquoi ne
fit-on pas plus fréquemment & plus long - tems
ufage de cette récompenfe ? Elle réuniffoit un
grand nombre de caractères heureux; elle n’é-
tok po-int difpendie-ufe pour l’Etat ; elle étoit du
genre de celles qu’aiment les François ; elle étoit
diftribuée avec appareil. Tout cela eft vrai, mais
elle n’étoit pas affez apparente ; & les citoyens
de toutes les claffes ayant le droit de porter des
anneaux , les- militaires qui en avoient gagné un
n’étoient plus diltingués.- Si l’on vouloit jamais
' créer une récompenfe pour les aCtioris d’é clat,
■ on ne devroit donc fonger aux anneaux qu’après
en avoir défendu l’ufage aux paifibles citoyens &:
aux militaires qui ne les' auroient pas gagnés j
mais comme'cette défenfe feroit prefque tyran-
. nique , il vaut mieux abandonner les anneaux 8c
recourir à une croix , ou à une médaille , ou à.
un écuffon , ou à un ruban , ou enfin à quelqu’au-
tre marque extérieure très-apparente. Voye^ Rê~
compense , paragraphe des R écompenses hon
o r a eles.'
AN O B L IS SEM EN T . L 3anoblijfement eft un
a<5te par lequel le fouverain accorde à un roturier
la qualité de noble, afin qu’ à ce titre il jouifîe
des prérogatives que les loix de l’Etat attachent
à la nobleffe.
Nous nous bornerons dans cet article à con-
fidérer les anoblîjfemens comme une récompenfe-
militaire ; c’eft fous ce féul afpeCt qu’il nous
appartient de lés envifager , & les auteurs des
dictionnaires de jùrifprudence & d’économie politique
les ont obfervés fous les faces qui leur
font relatives. Voye\ dans le dictionnaire de ju-
rifpr'udence le mot A n o b lissem en t-, & dans le
dictionnaire d’économie politique le mot En noblissement.
'
Charles V II, François I, Henri IV , Louis X III
& Louis;XIV ont fait ufage .des anoblîjfemens , comme d’iine récompenfe militaire ; mais Louis
XV eft le premier de nos rois qui ait rendu une
loi expreffe fur cet objet. L’édit, par lequel ce:
, prince arrache la nobleffe à certains grades mili