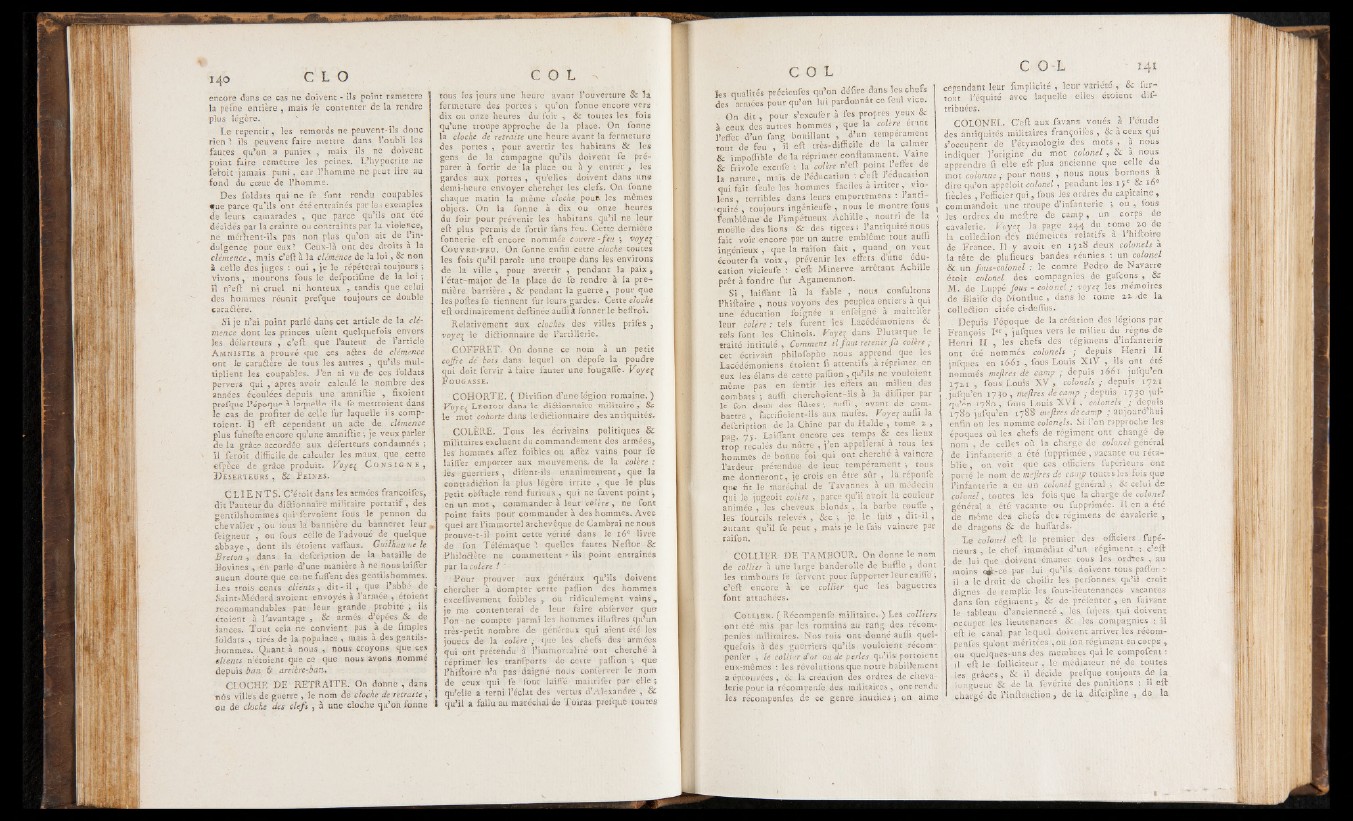
encore dans ce cas ne doivent - ils point remettre '
la peine entière , mais le contenter de la rendre
plus légère.
Le repentir, les remords ne peuvent-ils donc
rien ? ils peuvent faire mettre dans l’oubli les
fautes qu’on a punies , mais ils ne doivent
point faire remettre. les peines. L’hypocrite ne
fefoit jamais puni , car l’homme ne peut lire au
fond du coeur de l’homme.
Des foldats qui ne le font rendu coupables
que parce qu’ils ont été entraînés par les exemples
de leurs camarades , que parce qu’ils ont été
décidés,par la crainte ou contraints par la violence,
ne méritent-ils pas non plus qu’on ait de l’indulgence
pour eux? Ceux-là ont des droits a la
c l é m e n c e , mais c’eft à la c lém e n c e de la lo i, & non
à celle des juges : oui , je le répéterai toujours -,
vivons, mourons fous le defpotilme de la loi ;
il n’eft ni cruel ni honteux , tandis que celui
des hommes réunit prefque toujours ce double
çaraâère.
Si je n’ai point parlé dan$ cet article de la c lé m
e n c e dont les princes ufent quelquefois envers
les déserteurs , c’eft que l’auteur de l’article
A m n is t ie a prouvé que ces a&es de c lém e n c e
ont le caraâère de tous les autres , qu’ils multiplient
les coupables. J’en ai vu de ces foldats
pervers qui apres avoir calculé le nombre dés
années écoulées depuis une amniftie , fixaient
prefque l’époque à laquelle ils fe mettroient dans
le cas de profiter de celle fur laquelle fis comp-
toient. Il eft cependant un aâe de c lém e n c e
plus funefte encore qu’une amniftie -, je veux parler
de la grâce accordée aux déferteurs condamnes ■,
il feroit difficile de calculer les maux, que cette
efpêçe de grâce produit. Voye^ C o n s i g n e ,
D éserteurs , & P ein e s .
C L IE N T S . C’étoit dans les armées francoifes,
dit l’auteur du diâîônnaire' militaire portatif , des
gentilshommes qiifferyoient fous le pennon du
chevalier , ou fous la bannière du banneret leur
feigneur , ou fous* celle de l’advoué de quelque
abbaye , dont ils étoient vaffaux. G u i lh a um e le
B r e t o n , dans la defeription de la bataille de
Bovines ., en parle d’une manière à ne nouslaiffer
aucun doute que ce,hq.fuffent des gentilshommes.
Les trois cents c l i e n t s , dit-il , que l’abbé de
Saint-Médard .avoient envoyés à l’armée , étoient
recommandables par leur grande. probité ; ils
étoient à l’avantage , 8c armés d’épées ,8c de
lances. Tout cela ne convient pas a de fi.mples
foldats , tirés de la populace , mais à des gentilshommes.
Quant à nous , nous croyons que ces
c l i e n t s n'étaient que ce que nous avons nommé
depuis b a n & a r r iè re -b a n ..
CLOCHE DE RETRAITE. On donné , dans
nôs villes.de guerre , le nom de- c lo c h e d e r e tr a ite ,'
ou de c lo c h e d e s c l e f s , à une cloche qu’on fonne
tous les jours une heure avant l’ouverture 8c la
fermeture des portes qu’on fonne encore vers
dix ou onze heures du loir , 8c toutes les fois
qu’une troupe approche de la place. On fonne
la c lo c h e d e r e t r a i t e une heure avant la fermeture
des portes , pour avertir les habitans & les
gens de la campagne qu’ ils doivent fe préparer
à fortir de la place ou à y entrer , les
gardes aux portes , qu’elles doivent dans une
demi-heure envoyer chercher les clefs. On fonne
chaque matin la même c lo c h e poutv. les mêmes
objets. On la fonne à dix ou onze heures
du loir pour prévenir les habitans qu’il ne leur
eft plus permis de fortir fans feu. Cette dernière
fonnerie eft encore nommée c o u v r e - f e u •, voye%~
C o u vr e -f e u . On fonne enfin cette c lo c h e toutes
les fois qu’il paroît une troupe dans les environs
de la ville , pour avertir , pendant la paix,
l’état-major de la place de fe rendre à la première
barrière , 8c pendant la guerre , pour que
les polies fe tiennent fur leurs gardes. Cette c lo c h e
eft ordinairement deftinée auffi à Tonner le beffroi.
Relativement aux c lo c h e s des villes prifes ,
v o y e z le dictionnaire de l’artillerie.
COFFRET. On donne ce nom à un petit
co ffr e d e ' b o is dans lequel on dépofe la poudre
qui doit fervir à faire fauter une fougaffe. V o y e {
F ougasse.
COHORTE. ( Divifion d’une légion romaine. )
V o y e 1 Légion dans le dictionnaire militaire , 8c
le mot co h o r te dans le dictionnaire des antiquités.
COLÈRE. Tous les écrivains politiques &
militaires excluent du commandement des armées,
les hommes affez foibles ou allez vains pour fe
laiffer emporter aux mouvemens, de la c o lè r e :
lés-guerriers , difent-iîs unanimement, que la
contradiction la plus légère irrite , que le plus
petit obftacle rend furieux, qui ne favent point,
en un mot, commander à leur c o l è r e , ne font
point faits pour commander à des hommes. Avec
t quel art l’immortel archevêque de Cambrai ne nous
prouve-t-il point cette vérité dans le 16e livre
de fon Télémaque quelles fautes Neftor &
-PhiloClète ne commettent - ils point entraînés
par la c o lè r e !
Pour prouver aux généraux qu’ils doivent
chercher à dompter cette paflion des hommes
èxcelfivement foibles , ou ridiculement vains,
je me contenterai de leur faire obferver quer
l’on ne compte parmi les hommes illuftres qu’un
très-petit nombre de, généraux qui aient été les
jouets de la c o l è r e -y que les chefs des armées
qui ont prétendu à l’immortalité ont cherché à
réprimer les tranfports de cette paffion -, que
l’hiftoire n’a pas daigné nous conferver le nom
de ceux qui lé font laiffé maitrifer par elle ;
qu’elle a terni l’éclat des vertus d’Alexandre , &
I qu’il a fallu au maréchal de Toiras ptefquê toutes
les qualités précieufes qu’on délire dans les chefs
des armées pour qu’on lui pardonnât ce feul vice.
On d it , pour s’exeufer à fes propres yeux &
à ceux des autres hommes , que la c o lè r e étant
l’effet d’un fang bouillant , d’un tempérament
tout de feu , il eft très-difficile de la calmer
& impoflible de la réprimer conftamment. Vaine
& frivole exeufe : la c a l ère n’eft point l’effet de
la nature, mais de l’éducation *. c’eft 1 éducation
qui fait feule les hommes faciles a irriter, vio-
lens , terribles dans leurs emportemens : l’anti-
1 qui té , toujours ingénieufe , nous le montre fous ^
l’emblème de l’impétueux Achille, nourri de la j
moelle des lions 8c des tigres i l’antiquité nous
fait voir encore par un autre emblème tout aulli
ingénieux , que la raifon fait , quand.. on veut
écouter fa voix, prévenir les effets^ dune éducation
vicieufe : c’eft Minerve arrêtant Achille
prêt à fondre fur Agamemnon.
Si , laiffant là la fable , nous confultons
l’hiftoire , nous voyons des peuples entiers a qui
une éducation foignée a en feigne^ à maitrifer
leur, c o lè r e : tels furent les Lacederooniens 8c
tels font les Chinois* V o y e ? dans Plutarquç ,1e
traité intitulé , C om m e n t i l f a u t r e t e n ir f a c o ie j e ■
cet écrivait philofophe nous apprend que les
Lacédémoniens étoient fi attentifs 1 réprimer en
eux les élans de cette paffion, qu’ils ne vouloient
même pas en fentir les effets^ au milieu des
combats i aulfi cherchoient-ils à la diffiper par
le fon doux des flûtes ■, auffi , avant de combattre
, facrifioient-ils aux mules. V o y e [ aulfi la
defeription de la Chine par du Halde , tome 2. ,
pag. 75. Laiffant encore ces temps & ces lieux
trop reculés du nôtre , j’en appellerai à tous les
hommes de bonne foi qui ont cherche a vaincie
l’ardeur prétendue de leur tempérament ; tous
me donneront, "je crois en être sûr , la reponfe
que fit le maréchal de Tavannes a un médecin
qui le jugeoit co lè r e , parce qu’il avoir la couleur
animée , les cheveux blonds , la barbe rouffe ,
les' l’ourcils relevés , &c je le fuis , dit-il ,
autant qu’il fe peut , mais je le fais vaincre par
raifon.
COLLIER DE TAMBOUR. On donne le nom
de c o l li e r a une large banderolle de buffle , dont
les tambours fe fervent pour fupporter leur caiffe'-,
c’eft encore à ce , c o l l i e r que les baguettes
font attachées.
C o l l ie r . (Récompenfe militaire. ) Les c o l l i e r s
ont été mis par les romains au rang des récom-
penfes militaires. Nos rois ont donné auffi quelquefois
à des guerriers qu’ils vouloient récom-
penfer , l e c o l l i e r d 'or o u d e p e r le s qu’ils portoient,
eux-mêmes : les révolutions que notre habillement
a éprouvées , 8c la création des ordres de chevalerie
pour la récompenle des militaires, ont rendu
les récompeni’es de ce genre inutiles i on aime
cependant leur fimplicité , leur variété y 8c fur-
tout l’équité avec laquelle elles étoient distribuées.
COLONEL. C’eft aux favans voués à l’étude
des antiquités, militaires francoifes , 8c a ceux qui
s’occupent de l’étymologie des mots , à nous
indiquer l’origine du mot c o lo n e l , & à nous
apprendre fi elle eft plus ancienne que celle du
mot c o lo n n e y pour nous , nous nous bornons à
dire qu’on appel oit c o lo n e l , pendant les 15e & I^e
fiècles , l’officier qui, l©us les ordres du capitaine ,
commandoit une troupe d’ infanterie ou , fous
les ordres du meftre de camp, un corps de
cavalerie. V o y e { la page 244 du tome x o de
la colle dion dés mémoires relatifs a l’hiftoire
de France. Il y avoit en 1528 deux c o lo n e l s à
la tête de plufieurs bandes réunies, : un c o lo n e l 8c un f o u s - c o l o n e l : le comte Pedro de Navarre
étoit c o lo n e l des compagnies de gafeons » &
M. de Luppé f o u s - c o l0 n e l y v o y e ç les mémoires
de Blaife-da Montluc , dans le tome 22/de la
colledion citée ci-de(lus.
Depuis l’époque de la création des légions par
François Ier , jufques vers le milieu du règne-de
Henri II , les chefs des régimens d’infanterie
ont été nommés, c o lo n e ls y depuis Henri II
jnfqnes en 16Ô1 , fous Louis XIV , ils ont et©
nommés m e fir e s d e c a m p ; depuis 1661 jufqu’en
1721 , fous Louis XV , c o lo n e ls ; depuis 1721
jufqu’en 1730 , m e (lr e s d e cam p ; depuis 1730 jufqu’en
1780 , fous Louis XVI , c o lo n e ls y depuis
1780 jufqu’en 1788 m e fir e s de cam p y aujourd’hui
enfin on les nomme c o lo n e l s . Si fon rapproche les
époques où les chefs de régiment ont changé de
nom , de celles où la charge de c o lo n e l général
de l'infanterie a été fuppriméè, vacante ou rétablie
, on voit que ces officiers fupcrieiirs ont
porté le nom de m e fire s d e canrp toutes les fois que
l’infanterie a eu un c o lo n e l général ;, & celui de
c o l o n e l , toutes , les. fois que la charge de c o lo n e l
général a été vacante ou fuppriméè. Il en a été '
de même des chefs des régimens de cavalerie ,
de dragons & de huffards.
L e c o lo n e l éft le premier des officiers Supérieurs
, le chef .immédiat d’un régiment : c’eft
de lui que doivent émaner tous les ordres , au
moins eéfc-ce par lui qu’ils doivent tous paffer v
il a le droit de choifir les. perfonnes qu’il croît
dignes de remplir les fous-lieutenançes vacantes
dans fon régiment, & de préfenter , en fuivant
le tableau d’ancienneté , les, fuje.ts qui doivent
occuper les lieutenances & les compagnies : il
eft le. canal par lequel doivent arriver les réepm-
penfes qu’ont méritées ,ou lbn régiment en corps ,
ou quelques-uns des membres qui le compofent :
il eft le •Iblliciteur , le médiateur né de toutes
les grâces, 8c il décide prefque toujours de la.
longueur 8c de la fevérité des punitions : il eft
chargé de l’inftru&ion, de la dilcipîine , de la