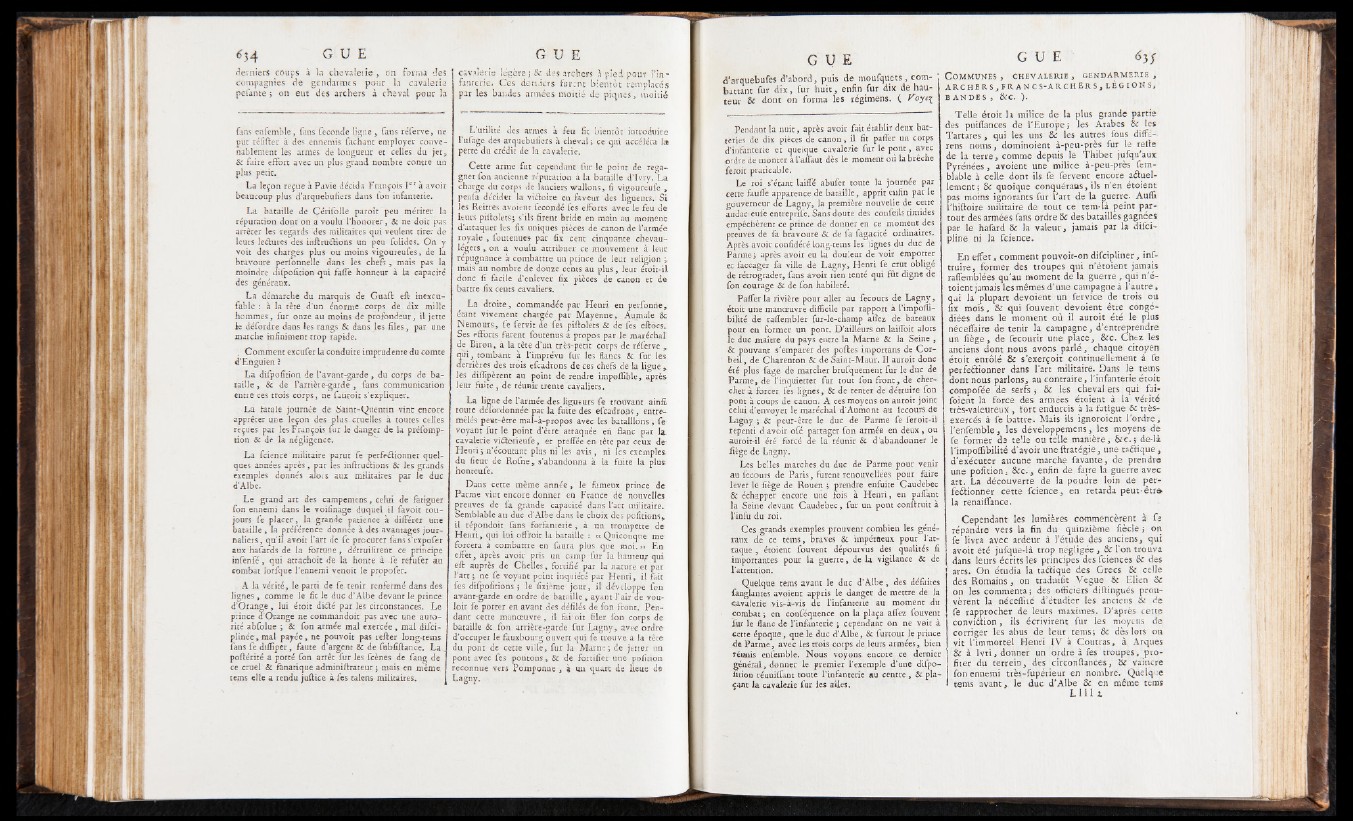
derniers coups à la chevalerie, en forma des
compagnies de gendarmes pour la cavalerie
pelante j on eut des archers à cheval pour la
fans enfemble, fans fécondé ligne , (ans réferve, ne
put réüfter à des ennemis fachant employer convenablement
les armes de longueur et celles du jet,
& faire effort avec un plus grand nombre contre un
plus petit.
La leçon reçue à Pavie décida François Ier à avoir
beaucoup plus d'arquebufiers dans fon infanterie.
La bataille de Çérifolle paroît peu mériter la
réputation dont on a voulu l‘honoter, & ne doit pas
arrêter les regards 'des militaires qui veulent tirer de
leurs lectures des inftruCtions un peu folides. On y
voit des charges plus ou moins vigoureufes, de la
bravoure perfonneile dans les chefs, mais pas la
moindre difpofition qui fafle honneur à la capacité
des généraux.
La démarche du marquis de Guaft eft mexerr-
fable : à la tête d'un énorme corps de dix mille
hommes, fur onze au moins de profondeur, il jette
le défordre dans les rangs & dans les files, par une
marche infiniment trop rapide.
Comment exeufer la conduite imprudente du comte
«TEnguien ?
La difpofition de l’avant-garde, du corps de bataille
, & de l’arrière-garde , fans communication
entre ces trois corps, ne fauroit s’expliquer.
La fatale journée de Saint-Quentin vint encore |
apprêter une leçon des plus cruelles à toutes celles i
reçues par les François fur le danger de la préemption
& de la négligence.
La feience militaire parut fe perfectionner quelques
années après, par les inftruCtions & les grands
exemples donnés alois aux militaires par le duc
d’Albe.
Le grand art des campemens, celui de fatiguer
fon ennemi dans le voifinage duquel il favoit toujours
fe placer, la grande patience à différer une
bataille, la préférence donnée à des avantages journaliers
, qu’il avoir l’art de fe procurer fans s’expofer
aux hafards de la fortune , détruifirent ce principe
infenfé , qui attachoit de la honte à fe refufer au
combat lorfque l’ennemi venoit le propofer.
A la vérité , le parti de fe tenir renfermé dans des
lignes , comme le fit le duc d’Albe devant le prince
d’Orange , lui étoit diCté par les circonstances. Le
prince d’Orange ne commandoit pas avec une autorité
abfolue ÿ 8c fon armée mal exercée, mal difei-
plinée, mal payée, ne pouvoit pas refter long-rems
fans fe diffiper, faute d’argent & de fabfiftance. La „
poftérité a porté fon arrêt fur les fcènes de fang de
ce cruel & fanatique adminiflrateur $ mais en même
teins elle a rendu juftice à fes talens militaires.
cavalerie légère ; & des archers à pied pour l’in-
fanrerie* Ces deniers furent bientôt remplacés
par les bandes armées moitié de piques, moitié
L’utilité des armes à feu fit bientôt introduire
l’ufage des arquebufiers à clieval i ce qui accéléra la
perte du crédit de la cavalerie.
Cette arme fut cependant fur le point de regagner
fon ancienne réputation à la bataille d’Ivry. La
charge du corps de lanciers wallons, fi vigoureufe ,
penfa décider la victoire en faveur des ligueurs. Si
les Reitres avoient fécondé fes efforts avec le feu de
leurs piftoletsj s’ils firent bride en main au moment
d’attaquer les fix uniques pièces de canon de l’armée
royale , foutenues par fix cent cinquante chevau-
légers,. on a voulu- attribuer ce mouvement à leur
répugnance à combattre un prince de leur religion j.
mais au nombre de douze cents au plus, leur étoit-il
donc fi facile d’enlever fix pièces de canon et de
battre fix cents cavaliers.
La droite, commandée par Henri en peifonrte,
étant vivement chargée par Mayenne, Aumale &
Nemours, fe fervit de fes piftolets & de fes eftôcs.
Ses efforts furent foutenus à propos par le maréchal'
de Biron, à la tête d’un très-petit corps de réferve „
qui , tombant à l’imprévu fur les flancs 8c fur les
derrières des trois efeadrons de ces chefs de la ligue >
les diffipèrent au point de rendre impoffible, après
leur fuite, de réunir trente cavaliers.
La ligne de l’armée des ligueurs fe trouvant ainfi
toute défordonnée par la fuite des efeadrons, entremêlés
peut-être mal-à-propos avec les bataillons , fe
voyant fur le point d’être attaquée en flanc par la.
cavalerie viCtorieufe, et prefTée en tête par ceux de*
Henri j n’écoutant plus ni les avis, ni les exemples
du fleur de Rofne, s’abandonna à ia fuite la plus:
honteufe.
Dans cette même année , le fameux prince de
Parme vint encore donner en France de nouvelles
preuves de fa grande capacité dans l’art militaire.
Semblable au duc d’Aïbe dans le choix des polirions*
il répondoit fans forfanterie, à un trompette de
Henri,, qui lui offroit la bataille : ce Quiconque me
forcera à combattre en faura plus que moi. » En
effet, après avoir pris un camp fur la hauteur qui
eft auprès de Chelles, fortifié par la nature et par
l’art ^ ne fe voyant point inquiété par Henri, il fait
fes difpofitions ; le fixième jour, il développe fon
avant-garde en ordre de bataille r ayant l’air de vouloir
fe porrer en avant des défilés de fon front: Pendant
cette manoeuvre , il fai'oit filer fon corps de
bataille & .fon arrière-garde fur Lagny, avec ordre
d’occuper le fàuxbourg ouvert qui fe trouve à la tête
du pont de cette ville, fur la Marne ; de jetter un
pont avec fes pontons, & de fortifier une pofition
reconnue vers Pomponne , à un quart de lieue de
Lagny.
d’arquebufes d’abord, puis de moufquets, combattant
fur d ix , fur huit, enfin fur dix de hauteur
8c dont on forma les régimens. ( Voyeç
Pendant la nuit, après avoir fait établir deux batteries
de dix pièces de canon , il fit pafler un corps
d’infanterie et queique cavalerie fur le pont, avec ,
ordre de monter a l’aflaut dès le moment où la brèche
feroit praticable.
Le roi s’étant laiffé abufer toute la journée par
cette faulfe apparence de bataille, apprit enfin par le
gouverneur de Lagny, la première nouvelle de cette
audacieufe entreprife. Sans doute des confeils timides
empêchèrent ce prince de donner en ce moment des
preuves de fa bravoure & de fa fagacité ordinaires.
Après avoir confidéré long-tems les lignes du duc de
Panne j après avoir eu la douleur de voir emporter
et faccager fa ville de Lagny, Henri fe crut obligé
de rétrograder, fans avoir rien tenté qui fût digne de
fon courage & de fon habileté.
Pafler la rivière pour aller au fecours de Lagny,
étoit une manoeuvre difficile par rapport à l’impofli-
bilité de rafîembler fur-le-cnamp allez de bateaux
pour en former un pont. D’ailleurs on laiffolt alors
îe duc maître du pays entre la Marne & la Seine ,
& pouvant s’emparer des poftes importans de Cor-
beil, de Charenton & de Saint-Maur. Il auroit donc
été plus fage de marcher brufquement fur le duc de
Parme, de l’inquietter fur tout fon front, de chercher
à forcer fes lignes, & de tenter de détruire fon
pont à coups de canon. A ces moyens on auroit joint
celui d’envoyer le maréchal d’Aumont au fecours de
Lagny i & peur-être le duc de Parme fe feroit-il
repenti d avoir ofé partager fon armée en deux, ou I
auroit-il été forcé de la réunir & d'abandonner le
liège de Lagny.
Les belles marches du duc de Parme pour venir
au fecours de Paris, furent renouv.eliées pour faire
lever le fiège de Rouen } prendre enfuite Caudebec
& échapper encore une fois à Henri, en paflant
la Seine devant Caudebec, fur un pont conftruit à
l’infu du roi.
Ces grands exemples prouvent combien les généraux
de ce tems, braves & impétueux pour l'attaque
, étoient fouvent dépourvus des qualités fi
importantes pour la guerre, de la vigilance & de
l’attention.
Quelque tems avant le duc d’Albe, des défaites
fanglantes avoient appris le danger de mettre de la
cavalerie vis-à-vis ae l’infanterie au moment du
combat j en conféquence on la plaça affez fouvent
fur le flanc de l’infanterie } cependant on ne voit à
cette époque, que le duc d’Albe, & furtout le prince
de Parme, avec les trois corps de leurs armées, bien
réunis enfemble. Nous voyons encore ce dernier
général, donner le premier l’exemple d’une difpo-
ficion réunifiant toute l’infanterie au centre , 8c plaçant
la cavalerie fur les ailes.
C ommunes , chevalerie , g endarmerie ,
A R C H E R S , F R A N C S - A R CH E R S , L E G I O N S ,
B A N DES j &C. ).
Telle étoit k milice de la plus grande partie
des puiffances de l’Europe ; les Arabes 8c les
Tartares, qui les uns 8c les autres fous diffs-
rens noms, dominoient à-peu-près fur le relie
de la terre, comme depuis le Thibet jufqu’aux
Pyrénées, avoient une milice à-peu-près fem-
blable à celle dont ils fe fervent encore actuellement
; 8c quoique conquéraos, ils n’en étoient
pas moins ignorants fur l’ art de la guerre. Auffi
l’hiftoire militaire de tout ce tem-là peint partout
des armées fans ordre & des batailles gagnées
par le hafard & la valeur, jamais par la difei-
pline ni la fcience.
En effet, comment pouvoit-on difcipliner, inf-
truire, former des troupes qui n’étoient jamais
raffemblées qu’ au moment de la guerre , qui n’étoient
jamais les mêmes d’ une campagne à l ’autre,
qui la plupart dévoient un fervice de trois ou
fix mois, 8c qui fouvent dévoient être congédiées
dans le moment où il auroit été le plus
néceffaire de tenir la campagne, d’entreprendre
un fiège, de fecourir une place, & c . Chez les
anciens dont nous avons parlé, chaque citoyen
étoit enrôlé & s ’exerçoit continuellement à fe
perfectionner dans l’arc militaire. Dans le tems
dont nous parlons, au contraire, l’infanterie étoit
compofée de serfs j 8c les cheval ers qui fai-
foient la force des armées étoient à la vérité
très-valeureux, fort endurcis à la fatigue 8c très-
exercés à fe battre. Mais ils ignoroient l ’ordre i
l’enfemble, les développemens, les moyens de
fe former de telle ou telle manière, & c . j de-là
l ’impoffibilité d’avoir uneftratégie, une taCtique,
d’exécuter aucune marche favante, de prendre
une pofition, & c . , enfin de faire la guerre avec
art. La découverte de la poudre loin de perfectionner
cette fcience, en retarda peut-être^
la renaiffance.
Cependant les lumières commencèrent à fa
répandre vers la fin du quinzième fiècle i on
fe livra avec ardeur à l’étude des anciens, qui
avoit été jufque-là trop négligée, & l’on trouva
dans leurs écrits les principes des fciences 8c des
arcs. On écudia la taCtique des Grecs & celle
des Romains, on traduifit Vegue & Elien &
on les commenta} des officiers diftingués prouvèrent
la néceflué d’étudier les anciens & de
fe rapprocher de leurs maximes. D’après cette
convia ion, ils écrivirent fur les moyens de
corriger les abus de leur tems} & dès lors on
vit l’immortel Henri IV à Coutras, à Arques
& à Ivr i, donner un ordre à fes troupes, profiter
du terrein, des circonftances, 8c vaincre
fon ennemi très-fupérieur en nombre. Quelque
tems avant,, le duc d’Albe & en même tems
L U I i