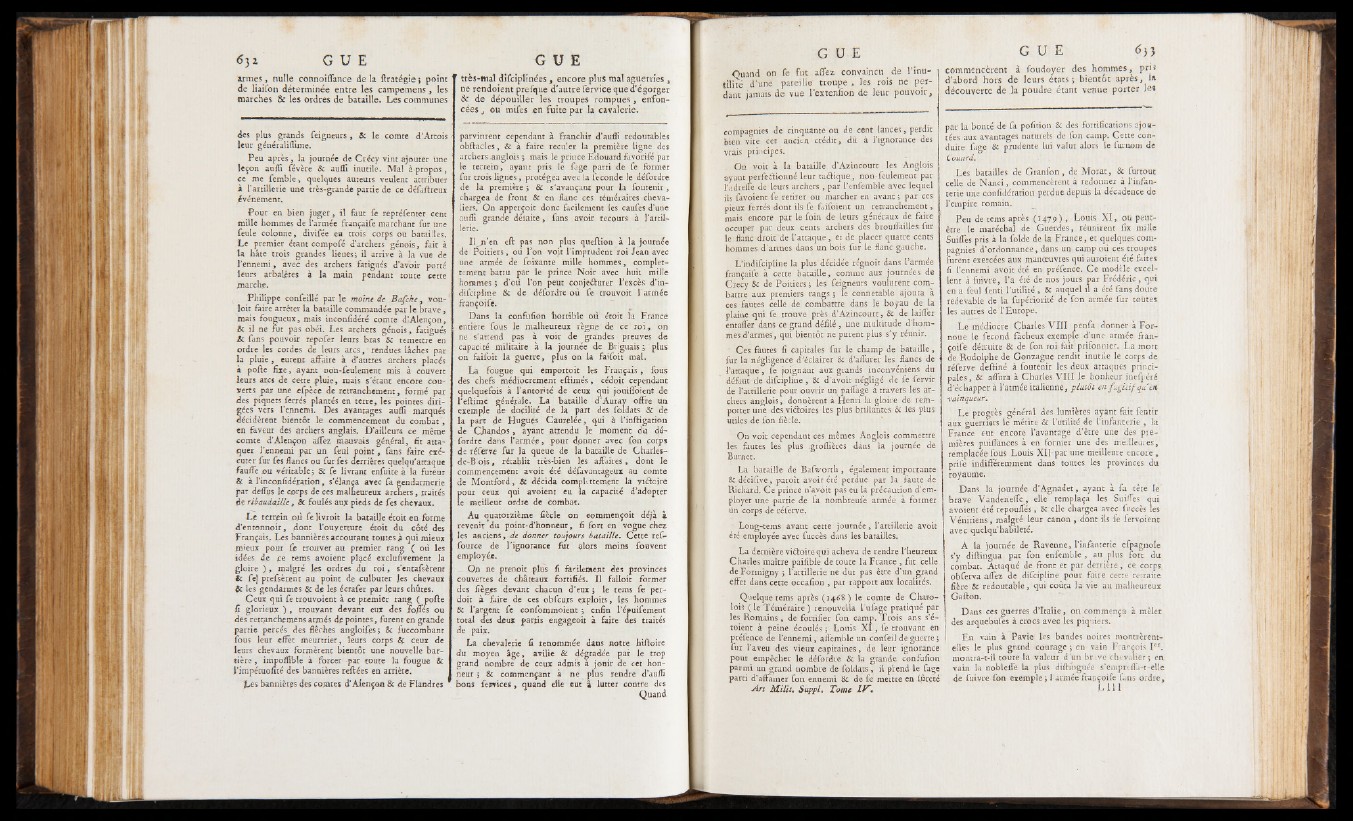
G UE
armes, nulle connoiffance delà ftratégie; point
de liaifon déterminée entre les campemens , les
marches & les ordres de bataille. Les communes
des plus grands feigneurs, & le comte d'Artois
leur généraliflime.
Peu après, la journée de Crécy vint ajouter une
leçon anffi févère & aufli inutile. Mal à-propos,
ce me femble, quelques auteurs veulent attribuer
à l’artillerie une très-grande partie de ce dëfaftreux
.événement.
Pour en bien juger, il faut fe repréfenter cent
mille hommes de l’armée françaife marchant fur une
feule colonne, divifée ea trois corps ou batailles.
Le premier étant compofé d’archers génois, fait à
la hâte trois grandes lieues, il arrive à la vue de
l’ennemi, avec des archers fatigués d’avoir porté
leurs arbalètes à la main pendant toute cette
marche.
Philippe confeillé par le morne de Bafche* vou-
loit faire arrêter la bataille commandée par le brave,
biais fougueux, mais inconfidéré comte dlAlençon,
& il ne rut pas obéi. Les archers génois, fatigués
£c fans pouvoir repofer leurs bras & remettre en
ordre les cordes de leurs arcs ,• rendues lâches par
la pluie , eurent affaire à d'autres archers placés
à pofte fixe, ayant non-feulement mis à couvert
leurs arcs 4e cette pluie, mais s’étant encore couverts
par une efpèce de retranchement, formé par
des piquets ferrés plantés en terre, les pointes dirigées
vers l’ennemi. Des avantages aufli marqués
décidèrent bientôt le commencement du combat,
en faveur des archers anglais. D’ailîeur« ce même
comte d’Alençon affez mauvais général, fit attaquer
l’ennemi par un feu! point, fans faire exécuter
fur fes flancs ou fur fes derrières quel qu'attaque
fauffe ou véritable 5 & fe livrant enfui te à la futeur
H à l’inconfidér.a.tion, s’élança avec fa gendarmerie
par deflbs le corps de ces malheureux archers, traités
de ribaudajlle , Sc foulés aux pieds de fes chevaux.
Le terre in où fe livroit la bataille étoit en forme
d'entonnoir, dont l’ouyerture étoit du côté des
Français, Les bannières accourant toutes à qui mieux
m»eux pour fe trouver au premier rang ( où les
idées de ce tems avoient placé exclufîvement la
gloire ) , malgré les ordres du ro i, s’entafsèrent \
& fe] prefsèrent au point de culbuter les chevaux j
& les gendarmes & de les écrafer par leurs chûtes.
Ceux qui fe trouvoient à ce premier rang ( pofte i
fi glorieux ) , trouyant devant eux des fojfés ou
des retranchemens armés de pointes, furent en grande
partie percés des flèches angloiièsj & fuccombant
fous leur effet meurtrier, leurs corps Sç. ceux de
leurs chevaux formèrent bientôt une nouvelle barrière
, impoffible à forcer par toute la fougue &
l’impétuolité des bannières reftées en arrière.
Les bannières des comtes d’Alençon & 4e Flandres
G U E
très-mal difeiplinées, encore plus mal aguerries,
ne rendoient prefque d'autre fervice que d’égorger
& de dépouiller les troupes rompues, enfoncées
j ou mifes en fuite par la cavalerie.
parvinrent cependant à franchir d’aufli redoutables
obftacles, & à faire reculer la première ligne des
archers .anglôis $ mais le prince Edouard favorifé par
le ter rein, ayant pris le fage parti de fe former
fur trois lignes, protégea avec la leconde le défordre
de la première; & s’avançant pour la foutenir,
chargea de front & en flanc ces téméraires chevaliers.
On apperçoit donc facilement les caufes d’une
aufli grande délaite , fans avoir recours à l’artillerie.
Il^ji’en eft pas non plus queftion à la journée
de Poitiers, où l’on vojt l'imprudent roi Jean avec
une armée de foixante mille hommes, complètement
battu par le prince Noir avec huit mille
hommes 5 d’ou l’on peut conjecturer l’excès d’in-
difeipiine 8c de défordre où fe trouvoit l'armée
françoife.
Dans la confufion horrible où étoit la France
entière fous le malheureux règne de ce roi., on
ne s’attend pas à voir de grandes preuves de
capacité militaire à la journée de Briguais ; plus
on faifoit la guerre, plus on la faifoit mal.
La fougue qui emportoit les Français, fous
des chefs médiocrement eftimés, cédoit cependant
quelquefois à l’ antorté de ceux qui jouiffoient de
l’eftime générale. La bataille d’Auray offre un
exemple de docilité de la part des foldats & de
la part de Hugues Caurelée, qui à l’inftigatiou
de Ghandos, ayant attendu le moment du défordre
dans l’armé.e, pour d.onner avec fon .corps
de réferve fur la queue d.e la bataille de Charles-
de-B ois, rétablit très-bien les affaires, dont le
commencement avoir été désavantageux au comte
de Montford, 8c décida compkttement la yufteire
pour ceux qui avoient eu la capacité d’adopter
le meilleur ordre de combat.
Au quatorzième fiècle on eommençoit déjà à
revenir du point-d’hpnneur, fi fort en vogue chez
les anciens, de donner toujours bataille. Cette ref-
fource de l ’ignorance fut alors moins fou vent
employée.
_ Ou ne prgnoit plus fi facilement des provinces
couvertes de châteaux fortifiés. Il falloit former
des fièges devant chacun d’eux ; le tems fe per-
doit à faire de ces obfcurs exploits, les hommes
& l'argent fe confommoient ; enfin l’épuifement
total des deux partis engageoit à faire des traités
de paix.
La chevalerie fi renommée dans notre hiftoire
du moyen âge, avilie & dégradée pair le trop
grand nombre de ceux admis a jouir de cet honneur
; & commençant à ne plus rendre d’auffi
bons fesviceS, quand elle eut à lutter contre des
Quand
G U E
Quand on fe fut affez convaincu de l’inutilité
d’une pareille troupe, les rois ne perdant
jamais de vue l ’extenfïon de leur pouvoir,
G U E 633
compagnies de cinquante ou de cent lances, perdit
bien vite cet ancien crédit, dû à l'ignorance des
vrais principes.
On voie à la bataille d’Azincourt les Anglois
ayant perfeétionné leur tactique., non-feulement par
l’adreffe de leurs archers , par l’enfemble avec lequel
ils favoient fe retirer ou marcher en avant; par ces
pieux ferrés dont ils fe Lifoient un retranchement,
mais encore par le foin de leurs généraux de faire
occuper par deux cents archers des brouffailles fur
le flanc droit de l’attaque, et de placer quatre cents
hommes d'armes dans un bois fur le flanc gauche.
L’indifcipline la plus'décidée régnoit dans l’armée
françaife à cette bataille, comme aux journées de
Crecy & de Poiriers ; les feigneurs voulurent combattre
aux premiers rangs 5 le connétable ajouta à
ces fautes cellé de. combattre dans le boyau de la
plaine qui fe trouve près d’Azincourt, & de laiffer
entalfer dans ce grand défilé , une multitude d’hommes
d’armes, qui bientôt ne purent plus s’y réunir.
' Ces fautes fi capitales fur le champ de bataille,
fur la négligence d’éclairer & d’aflùrer les flancs de
l’attaque, le joignant aux grands inconvéniens du
défaut de difeipline, & d’avoir négligé de fe fervir
de l’artillerie pour ouvrir un paflage à travers les archers
anglois, donnèrent à Henri la gloire de remporter
une des victoires les plus brillantes & les plus
utiles de fon fiècle.
On voit cependant ces mêmes Anglois commettre
les fautes les plus .groflières dans la journée de 1
Burnet.
La bataille de Bafworth , également importante
& décifîve j paroît avoir été perdue par la faute de
Richard. Ce prince n’avôit pas èu la précaution d’employer
une partie de fa nombreufe armée à former
lin corps de réferve.
Long-tems avant cette journée, l’artillerie avoir
été employée avec fuccès dans les batailles.
La dernière victoire qui acheva de rendre l’heureux
Charles maître paifîble de toute la France, fut celle
de Formigny 5 l’artillerie ne dut pas être d’un grand
effet dans cette occafion , par rapport aux localités.
Quelque tems après (1468) le comte de Charo-
loià (le Téméraire) renouvella l'ufage pratiqué par
les Romains, de fortifier fon camp. Trois ans s’é-
toient à peine écoulés; Louis X I , fe trouvant en
ptélence de l’ennemi, alfemble un confeil de guerre;
fur l’aveu des vieux capitaines, de leur ignorance
pour empêcher le défordre & la grande confufion
parmi un grand nombre de foldats, il prend le fage
parti d’affamer fon ennemi & de fe mettre en lûreté
Art Milit. Suppl. Tome IV"•
commencèrent à foudoyer des hommes, pris
d’abord hors de leurs états ; bientôt après, la-
découverte de la poudre étant venue porter le«
par la bonté de fa pofition & des fortifications ajoutées
aux avantages naturels de fon camp. Cette conduite
fage & prudente lui valut alors le furnom de
Couard.
Les batailles de Granfon, de Morat, & furtout
celle de Nanci, commencèrent à redonner à l'infanterie
une confidéuation perdue depuis la décadence de
l’empire romain.
Peu de tems après (1479) , Louis X I , ou peut-
être le maréchal de Guerdes, réunirent fix mille
Suiflès pris à la folde de la France, et quelques compagnies
d’ordonnance, dans un. camp où ces troupes
furent exercées aux manoeuvres qui auroient été faites
fi l’ennemi avoir été en préfence. Ce modèle excellent
à fuivre, l’a été de nos jours par Frédéric, qui
en a feul fenti futilité , & auquel il a été fans doute
redevable de la fupériorité de fon armée fur toutes
les autres de l’Europe.
Le médiocre Charles VIII penfa donner à For-
noue le fécond fâcheux exemple d’une armée françoife
détruite & de fon roi fait prifonnier. La mort
de Rodolphe de Gonzague rendit inutile le corps de
réferve deftiné à foutenir les deux attaques principales
, & affura à Charles VIII le bonheur inefpéré
d’échapper à l’atmée italienne, plutôt en f u g i t i f qu en
vainqueur.
Le progrès général des lumières ayant fait fentir
aux guerriers le mérite 8c l’utilité de l’infanterie , la
France eut encore l’avantage d’être une des premières
puiflances à en former une des meilleures,
remplacée fous Louis Xll-par une meilleure encore ,
pcile indifféremment dans toutes les provinces du
royaume.
Dans la journée d’Agnadet, ayant à fa tête .le’
brave Vandenefle, elle remplaça les Suiffes qui
avoient été repoufles, & elle chargea avec fuccès les
Vénitiens, malgré leur canon , dont ils fe fervoient
avec quelqu’habileté.
A la journée de Ravenne, l’infanterie efpagnole
s’y diftingua par fon enfemble, au plus fort du
combat. Attaqué de front et par derrière, ce corps
obferva affez de difeipline pour faire cette retraite
fière & redoutable, qui coûta la vie au malheureux
Gafton.
Dans ces guerres d’Italie, on commença à mêler
des arquebüfes à crocs avec les piquiers.
En vain à Pavie les bandés noires montrèrent-
elles le plus grand courage ; en vain François Ier.
montra-t-il toute la valeur d’un brave chevalier; en
vain la noblelfe la plus diftinguée s’emprt-flà-t-elle
de fuivre fon exemple; l'armée françoife (ans ordre,
L U I