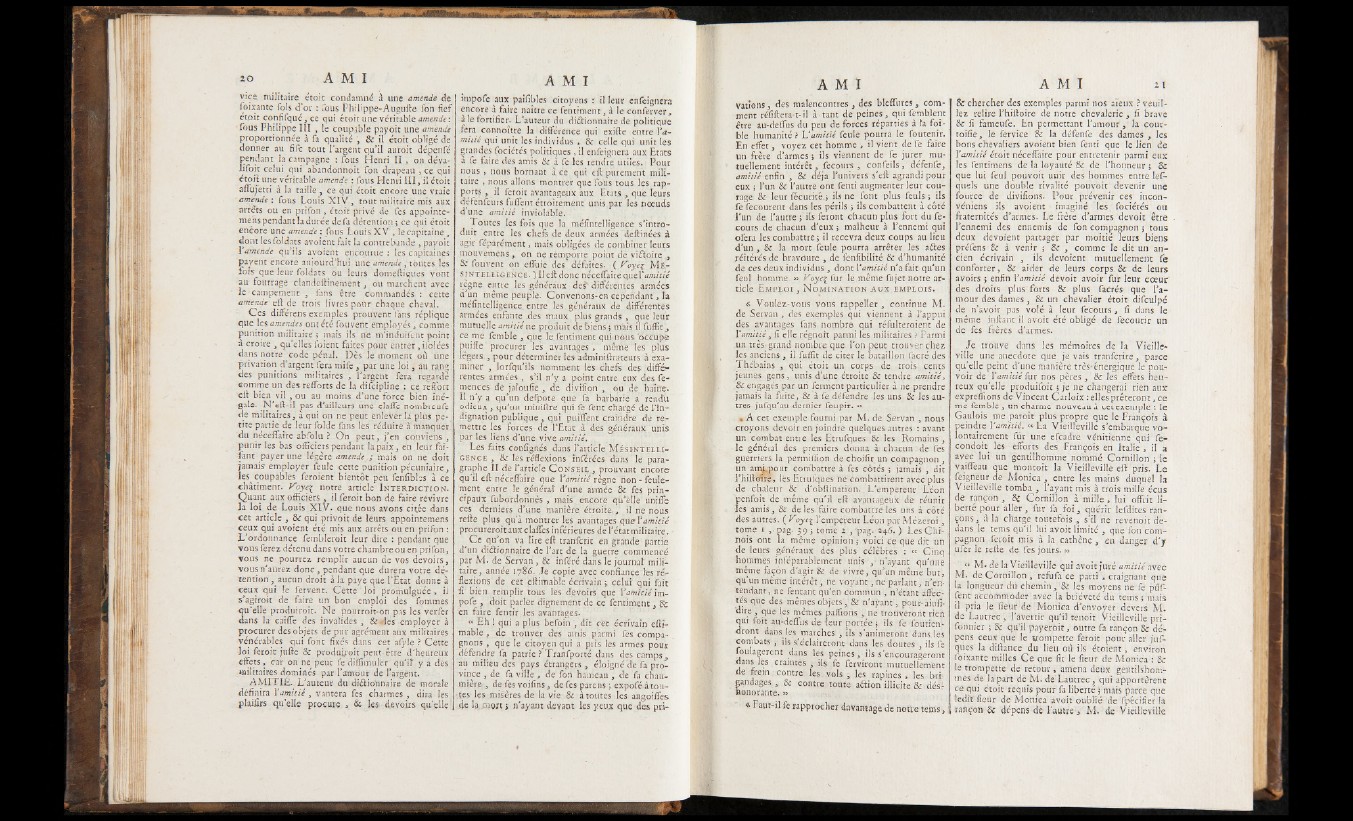
2 0 A M I
viçe militaire étoit condamné à line amende de
foixante fols d’or : fous Philippe-Augufte fon fief
étoit confifqué, ce qui étoit une véritable amende'.
fous Philippe III , le coupable payoit une amende
proportionnée à fa qualité j & il étoit obligé de
donner au file tout l ’argent qu’il auroit dépenfé j
pendant la campagne : fous Henri II , on déval
a i t celui qui abandonnoit fon drapeau , ce qui
étoit une véritable amende. : fous Henri III, il étoit
anÿjetti à la taille, ce qui étoit encore une vraie
amende : fous Louis X I V , tout militaire mis aux,
arrêts ou en prifon, étoit privé de fes appointe-
meiis pendant la durée de fa détention ; ce qui étoit
encore une amende : fous Louis X V , le capitaine
dont les foldats avoient fait la contrebande, payoit
\ amende qu’ils avoient encourue: les capitaines
payent encore aujourd’hui une amende , toutes les
fois que leur foldats ou leurs domeftiques vont
au fourrage clandeftinement, ou marchent avec
le campement , fans être commandés : cette
amende eft de trois livres pour chaque cheval.
C e s différens exemples prouvent fans réplique
que les amendes ont été fouvent employés, comme
punition militaire ; mais ils né m’induifent point
a croire , qu’elles foient faites pour entrer ,ifolées
dans notre code pénal. Dès le moment où une
privation d’argent fera mife , par une lo i , au rang,
des punitions militaires , l’argent fera regardé
comme un des reflorts de la difeipline : ce rèffort
ell bien v i l , ou au moins d’une force bien inégale.
N ’eft-il pas d’ailleurs une claffe nombreufe
de militaires, à qui on ne peut enlever la plus petite
partie de leur folde fans les réduire à manquer,
du néceflaire abfolu ? On peut, j’ en conviens ,.
punir les bas officiers pendant là paix, en.leur faisant
payer une légère amende j mais on ne doit
jamais employer feule cette punition pécuniaire ,
les coupables feroient bientôt peu fenfibbs à ce
châtiment. Voyeç notre article In t er d ic t io n .
Quant aux officiers , il feroit bon de faire revivre
la loi de Louis X IV . que nous avons citée dans
cet article , & qui privoit de leurs appointemens
ceux qui avoient été mis aux arrêts ou en prifon :
D’ordonnance fernbleroit leur dire : pendant que
vous ferez détenu dans votre chambre ou en prifon,
vous ne pourrez remplir aucun de vos devoirs,
vous n’aurez donc, pendant que durera votre détention
, aucun droit à la paye que l’Etat donne à
ceux qui le fervent. Cette ' loi promulguée , ii
s ’agiroit de faire un bon emploi des fommes
qu’elle produiroit. N e pourroit-on pas les verfer
dans la caiffe des invalides , &*lés -employer à
procurer des objets de pur agrément aux militaires
vénérables qui font fixés dans cet afyle ? Cette
loi feroit jufte & produiroit peut-être d’heureux
effets, car on ne peut fe diffimul'er qu’ if y â des
.militaires dominés par l’amour de l’argent.
AM IT IÉ. L’auteur du dictionnaire de morale
définira Xamitié, vantera fes charmes , dira les
plaifirs qu’elle procure * & les devoirs q u e lle ;
A M I
împofe aux paifibles citoyens : il leur enfeignera
encore a faire naître ce fentiment, à le conferver,
a le fortifier. L’auteur du dictionnaire de politique
connoître la différence qui exifte entre Xa-
miiie qui unit les individus , & celle qui unit les
grandes fociétés politiques , il enfeignera aux Etats
a fe faire des amis & â fe les rendre utiles. Pour
nous , nous bornant à ce qui eft purement militaire
, nous allons montrer que fous tous les rapport?
, il feroit avantageux aux Etats , que leurs
defenfeurs fufient étroitement unis par les noeuds
d’une amitié inviolable.
Toutes les fois que la méfîntelligen.çe s’introduit
entre les chefs de deux armées deftinées à
agir féparément, mais obligées de combiner leurs
mouvemens, on ne remporte point dé viéfoîre ,
& fouvent on efluie des défaites. ( f^oyeç M ésintelligence.
) Il eft donc néceflaire que X amitié
règne entre les généraux def1 différentes armées
d un même peuple. Convenons-èn cependant, fa
méfintelligence. èntre les généraux de différentes
armées enfante .des maux plus grands , que leur
mutuelle amitié ne produit de biens ; m'ais il fuffit,
ce me femble , que le fentiment qui-no us occupe
puifle procurer Je's avantages V même les plus
légers , pour déterminer les adminiftrateurs à examiner
, Jorfqu’ils nomment les chefs des différentes
armées , s’il n’y a - point entre eux des fe-
mences de jaîoufie , de divifion , ou .de haine-.
Il n’y a qu’un defpote que fa barbarie a rendu
odieux , qu’un rniniftre qui fe fent chargé de l’indignation
publique, qui puiffent çraiodre de remettre
les forces de l’Etat à des généraux unis
par les liens d’une vive amitié\
Les faits confîgnés dans l’article Més ïnte lli-
gence , & les réflexions inférées dans le paragraphe
II de l’ aFticIe C onseil,,, prouvant encore
qu il eft néceflairé que Yàmitië règne non - feulement
entre le général d’une année & fes principaux
fubordonnés , mais encore qu’èîje uniflè
ces derniers d’ une manière étroite, fi ne nous
refte plus qu’à montrer les avantages que Xamitié
procureroitaux clafles inférieures de l’état militaire.
•* C e qu’on va lire eft tranferit en grande partie
d’un dictionnaire de l’art de la guerre commencé
par M. de Servari , &: inféré dans le journal' militaire,
année 1786. Je copie avec confiance les réflexions
de cet eftimable écrivain ; celui' qui fait
fi bien remplir tous les devoirs que Xafnitiè im-
pofe , doit parler dignement de ce fentiment, &
en faire fentir les avantages.
« Eh ! qui a plus befoin , dît cet écrivain eftimable
, de trouver des amis parmi fes compagnons
, que le citoyen qui a pris les armes poux
défendre fa patrie ? Tranfporté dans des camps,
au milieu des pays étrangers, éloigné 'de fa province
, de fa ville , de fon hameau , de fa chaumière,
de fes voifins, de fes parens ; expoféàtou-
• tes les misères de la vie & à toutes les angoiffes
4e la.JBQXt; n’ ayant devant les yeux que des pri-
A M I A M I ü
vatîons, des malencontres , des blefîures, comment
réfiftera-t-il à tant de peines, qui femblent
être au-deflus du peu de forces réparties à la foi-
bie humanité ? L’amitié feule pourra le foutenir.
En effet, voyez cet homme , il vient de fe faire
un frère d’armes j ils viennent de fe jurer mutuellement
intérêt, fecours, confeils, défenfe,
amitié -enfin , & déjà l’univers s’eft agrandi pour
eux ; l’un & l’autre ont fenti augmenter leur courage
&- leur fécurité.; ils ne font plus feuls; ils
fe fecourent dans les périls y ils combattent à côté
l ’un de l’ autre ; ils feront chacun plus fort du fecours
de chacun d’eux y malheur à l’ennemi qui
ofera les combattre 5 il recevra deux coups au lieu
d’u n , & la mort feule pourra arrêter les aétes
réitérés dé bravdure , de fenfibilité & d’humanité
de ces deux individus, dont Xamitié n’a fait qu’un
feul homme. »» Voye-^ fur le même fujet notre article
Emplo i , N om in a t io n a u x em plois.
« Voulez-vous vous rappeller, continue M.
de Seivan , des exemples qui viennent à l’appui
des avantages fans nombre- qui réfulteroient de
Xamitié, fi elle régnoit parmi les militaires ? Parmi
un très-grand nombre que l’on peut trouver chez
les anciens , il fuffit de citer le bataillon facré des
Thébains , qui étoit un corps de trois cents
jeunes gens, unis d’une étroite & tendre amitié,
& engagés par un ferment particulier à ne prendre
jamais la fuite, & à fe défendre les uns & les autres
jufqu’ au dernier foupir. »
* A cet exemple fourni par M. de Servan , nous
croyons devoir en joindre quelques autres : avant
un combat entre les Etrufques & les Romains ,
le général des premiers donna à: chacun de fes
guerriers la permiflion de choifîr un compagnon ,
un amÿaour combattre à fes côtés ; jamais , dit
l ’hiftcnré, les Etrufques ne combattirent avec plus
de chaleur d’cbftination. L’empereur Léon
penfoit de même qu’il eft avantageux dé réunir
les amis, & de les faire combattre les uns à côté
des autres. ( Voye^ l’empereur Léon par M ézeroi,
tome 1 >• pag. 39 5 tome z , fpag. 24(3. ) Les C h inois
ont la même opinion 5 voici ce que dit un
de leurs généraux des plus célèbres : « Cinq
hommes irréparablement unis n’ayant qu’une
même façon d'agir & de vivre, qu’ un même but,
qu’un même intérêt, ne voyant;, ne parlant, n’entendant,
ne fentant qu’en commun , n’étant affectés
que des mêmes objets, & n’ayant, poùr-ainfi-
’dire, que les mêmes paflions , ne trouveront rien
qui foit au-deffus de -leur portée $ ils fe foutiem
dront dans les marches , ils s’animeront dans, les
combats ,■ ils s’éclaireront dans les doutes , ils fe
foulagerent dans les peines, ils s’encourageront
dans lès craintes , ils fe ferviront mutuellement
rie frein contre les. vols , les rapines, les brigandages
, & contre toute aétion illicite & dési
honorante. »
* Pâut-il fe rapprocher davantage de notre teins.
& chercher des exemples parmi nos aïeux ? veuillez
relire l’hiftoire de notre chevalerie, fi brave
& fi fameufe. En permettant l’amour, la cour-
toifie, le fervice & la défenfe des dames , les
bons chevaliers avoient bien fenti que le lien de
Xamitié étoit néceflaire pour entretenir parmi eux
les fentimens de la loyauté & de l’honneur y &
que lui feul pouvoit unir des hommes entre lesquels
une double rivalité pouvoit devenir une
fouirce de divifions. Pour prévenir ces incon-
véniens ils avoient imaginé les, fociétés ou
fraternités d’armes. Le frère d’armes devoit être
l’ennemi des ennemis de fon compagnon y tous
deux dévoient partager par moitié leurs biens
préfens & à venir y & , comme le dit un ancien
écrivain , ils dévoient mutuellement fe
conforter, & aider de leurs corps. &: de leurs
avoirs y enfin Xamitié devoit avoir fur leur coeur
des droits plus forts & plus facrés que l’amour
des dames, & un chevalier étoit difculpé
de n’avoir pas volé à leur fecours, fi dans le
même inftant il avoit été obligé de fecourir un
de fes frères d’armes.
Je trouve dans les mémoires de la Vieille-
ville une anecdote que je vais tranferire, parce
qu’elle peint d’une manière très-énergique le pouvoir
de Xamitié fur nos pères , & les effets heureux
qu’elle produifoit y je ne changerai rien aux
expreflions de Vincent Carloix relies prêteront, ce
me femble, un charme nouveau à cet exemple : le
Gaulois me paroît plus propre que le François à
peindre Y amitié. « Ra Vieilleville s’embarque volontairement
Air une efeadre vénitienne qui fe-
condoit les efforts des François en Italie, il a
avec lui un gentilhomme nommé Cornillon y le
vaifîeau que montoit la Vieilleville eft pris. Le
feigneur de M on ica , entre les mains duquel Ici
Vieilleville tomba , l’ayant mis à trois mille écus
de rançon, Ô£ Cornillon à mille, lui offrit liberté
pour aller , fur fa fo i , quérir lefdites rançons
, à la charge toutefois , s’il ne revenoit dedans
le tems. qu’ il lui avoit limité , que fon compagnon.
feroit mis à la cathène , en danger d’/
ufer le refte de fes jours. ?»
cc M. de la Vieilleville qui avoit juré amitié avec
M. de Cornillon, refufa ce parti, craignant quô
la longueur du chemin, & les moyens ne fe puf-
fent accommoder avec la brièveté du tems; mais
il pria le fleur de Monica d’envoyer devers M.
de Lautrèc, l’avertir qu’il tenoit Vieilleville pri-
fonnier ; & qu’il payeroit, outre fa rançon & dépens
ceux que le trompette feroit pour aller juf-
ques la diftance du lieu où ils étoient, environ
foixante milles C e que fit le fieur de Monica : &
le trompette de retour, amena deux gentilshommes
de la part de M. de Lautrec, qui apportèrent
ce qui étoit requis pour fa liberté ; mais parce que
ledit fieur de Monica avoit oublié de fpécifier la
rançon & dépens de l ’autre , M. de Vieilleville