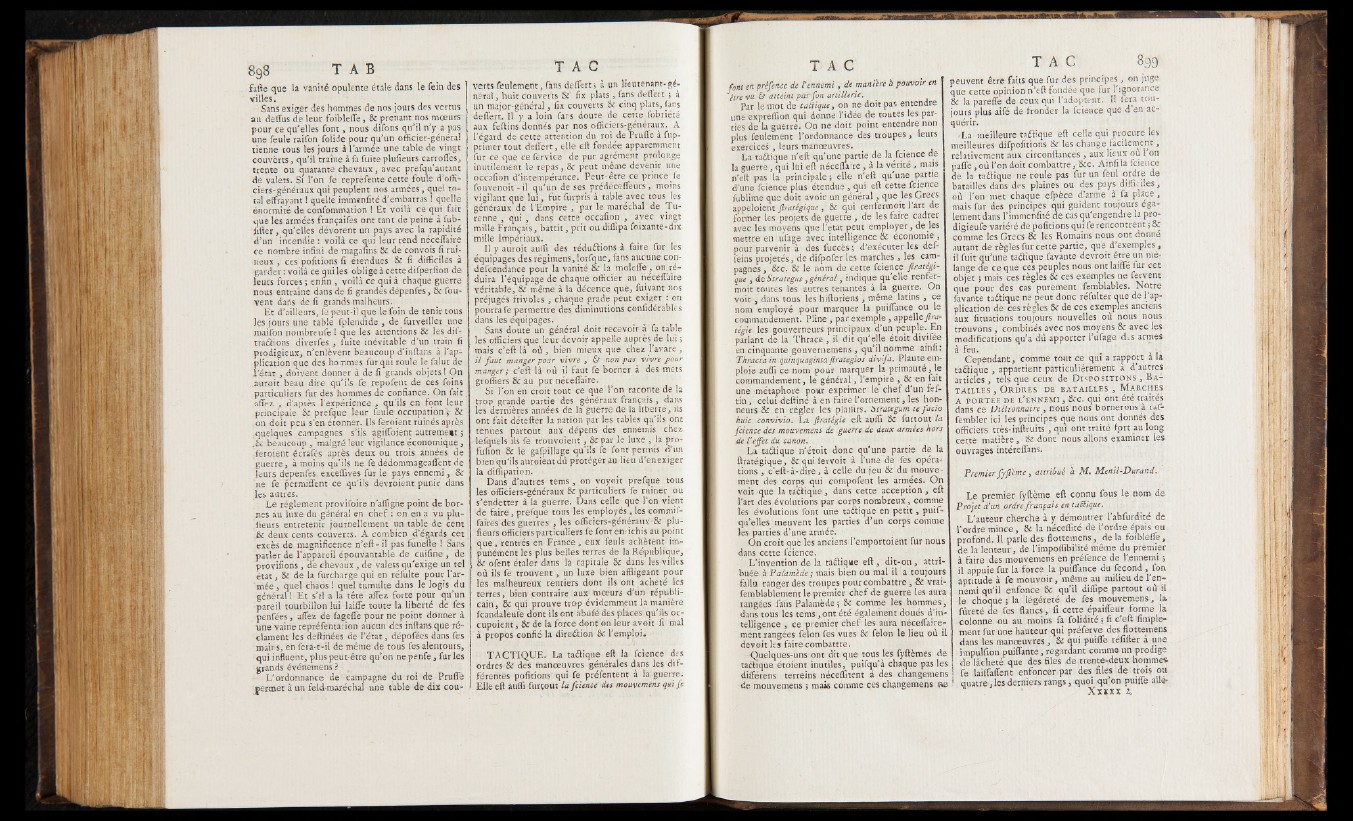
faite que la vanité opulente étale dans le fein des
villes.
Sans exiger des hommes de nos jours des vertus
au deffus de leur foibleffe, & prenant nos moeurs
pour ce qu’elles font , nous difons qu’ il n’y a pas
une feule raifon folide pour qu’ un officier-général
tienne tous les jours à l’armée une table de vingt
couverts , qu’il traîne à fa fuite plufieurs carroffes,
trente ou quarante chevaux, avec prefqu’autant
de valets. Si l’on fe repréfente cette Foule d’officiers
généraux qui peuplent nos armées, quel total
effrayant ! quelle immenfité d’embarras ! quelle
énormité de confommation ! Et voilà ce qui fait
que les armées françaifes ont tant de peine à fub-
fifter, qu’ elles dévorent un pays avec la rapidité
d’ un incendie : voilà ce qui leur rend néceffaire
ce nombre infini de magafins & de convois fi ruineux
, ces pofitions fi étendues & fi difficiles à
garder : voilà ce qui les oblige à cette difperfion de
leurs forces j enfin, voilà ce qui à chaque guerre
nous entraîne dans de fi grandes dépenfes, & fou-
vent dans de fi grands malheurs.
Et d’ailleurs, fe peut-il que le foin de tenir tous
les jours une table fplendide , de furveiller .une
maifon nombreufe ! que les attentions & les dif-
traétions diverfes , fuite inévitable d'un train fi
prodigieux, n’enlèvent beaucoup d’ inftans à l’ap-
piication que des hommes fur qui roule le falut de
l ’é ta t , doivent donner à de fi grands objets! On
auroit beau dire qu’ils fe repofent de ces foins
particuliers fur des hommes de confiance. On fait.
a l l e z , d’après l ’expérience , qu’ils en font leur
principale & prefque leur feule occupation V &
on doit peu s'en étonner. Ils feroient ruinés aprè^s
quelques campagnes s’ ils agiffoient autrement j
beaucoup, malgré leur vigilance économique,
feroient écrafés après deux ou trois années de
guerre, à moins qu’ ils ne fe dédommageaffent de
leurs dépenfes exceffives fur le pays ennemi, &
ne fe permiffent ce qu’ ils devroient punir dans
les autres.
Le réglement provifoire n'affigne point de bornes
au luxe du général en chef : on en a vu plu-
fieurs entretenir journellement un table de cent
& deux cents couverts. A combien d’égards cet
excès de magnificence n’ eft - il pas funefte I Sans
parler de l’appareil épouvantable de cuifine , de
provifions, de chevaux, de valets qu'exige un tel
état, & de la furcharge qui en réfulte pour l’armée,
quel chaos! quel tumulte dans le logis du
général ! Et s’il a la tête a f f e z forte pour qu’un
pareil tourbillon lui laiffe toute la liberté de fes
penfées, affez de fageffe pour ne point donner à
une vaine repréfentation aucun des inftansque réclament
les deftinées de l’état, dépofées dans fes
mairs, en fera-t-il de même de tous fes alentours,
qui influent, plus peut-être qu’on ne penfe, fur les
grands événemens ? J
- L’ordonnance de campagne du roi de Pruffe
permet à un feld-maréchal une table de dix couverts
feulement, fans deffert, à un lieutenant-général,
huit couverts & fix plats , fans deffert ; à
un major-général, fix couverts & cinq plats, fans
deflèrt. Il y a loin fars doute de cette fobriété
aux feftins donnés par nos officiers-généraux. A
l’égard de cette attention du roi de Pruffe à fup-
. primer tout deffert, elle eft fondée apparemment
fur ce que ce fer vice' de pur agrément prolonge
inutilement le repas, & peut même devenir une
occafion d’ intempérance. Peut-être ce prince fe
fouvenoit-il qu’un de ses prédéceffeurs, moins
vigilant que lu i, fut furpris à table avec tous les
généraux de l ’Empire , par le maréchal de Tu-
renne , qui , dans cette occafion , avec vingt
mille Français, battit, prit ou diffipa foixante-dix
mille Impériaux.
Il y auroit auffi des rédu&ions à faire fur les
équipages des régimens, lorfque, fans aucune con-
defcendance pour la vanité & la moleffe , on. réduira
l’équipage de chaque officier au necefiaire
véritable, & même a la décence que, (ifivant nos
préjugés frivoles , chaque grade peut exiger r on
pourra fe permettre des diminutions confidérables
- dans les équipages. ^ ' v .
Sans doute un général doit recevoir- à fa table
les officiers qu.e leur devoir appelle auprès de lui ;
mais c’eft là o ù , bien mieux que chez l’avare,
il faut manger pour •vivre , & non pas vivre pour
manger; c’eft là où il faut fe borner à des mets
greffiers & au pur néceffaire.
Si l’on en croit tout ce que l’on raconte de la
trop grande partie des généraux français, dans
les dernières années de la guerre de la liberté, ils
ont fait détefter la nation par les tables qu’ils ont
tenues partout aux dépens des ennemis chez
-4efquels ils fe trouvoient, & par le luxe ,• la pro-
fufion & le gafpillage qu’ ils fe font permis d’un
bien qu’ils auroientdu protéger au lieu d’ en exiger
la dimpation.
Dans diautres tems, on voyoit prefque tous
les officiers-généraux & particuliers fe ruiner ou
s’endetter à la guerre. Dans celle que l’on vient
de faire, prefque tous les employés, les commif-
faires des guerres , les officiers-généraux & plufieurs
officiers particuliers fe font emichis au point
que, rentrés en France, eux feuls achètent impunément
les plus belles terres de la République,
& ofent étaler dans la capitale & dans les villes
I où ils fe trouvent, un luxe bien affligeant pour
les malheureux rentiers dont ils ont acheté lés
terres, bien contraire aux: moeurs d’un républicain
, & qui prouve trop évidemment la manière
fcandaleul'e dont ils ont àbüfé des places qu’ ils oc-
cupoient, & de la force dont on leur avoir fi mal
à propos confié la direction & l’emploi*
TA CT IQ U E . La ta&iqüe eft la fcience des
ordres & des manoeuvres générales dans les différentes
pofitions qui fe préfentent à la guerre.
Elle eft àuffi furtout la fcience' des mouvemens qui fe
font en préfence de P ennemi, de maniéré h. pouvoir en
être vu. & atteint p&ftfon artillerie.
Par le mot de taftique, on ne doit pas entendre
une expreffion qui donne l’ idée de toutes les parties
de la guerre. On ne doit point entendre non
plus feulement l’ordonnance des troupes, leurs
exercices , leurs manoeuvres.
La ta&ique n’eft qu’unepartie de la fcience de
la guerre, qui lui eft néceffa r e , à la v érité, mais
n’eft pas la principale j elle n’eft qu’une partie
d’une fcience plus étendue, qui eft cette fcience
fublime que doit avoir un général, que les Grecs
appeloient firatégique , & qui renfermoit l’art de
former les projets de guerre , de les faire cadrer
avec les moyens que l’état peut employer, de les
mettre en ufage avec intelligence & économie ,
pour parvenir à des fuccès ; d’exécuter les def-
feins projetés, de difpofer les marchés, les campagnes
, & c . & le nom de cette fcience ftratêgi-
que , de Strategus, général, indique qu elle renfermoit
toutes les autres tenantes à la guerre. On
voit , dans tous les hiftoriens , même latins , cë
nom employé pour marquer la puiffance ou le
commandement. Pline, par exemple, appellefira-
tégie les gouverneurs principaux d’ un peuple. En
parlant de la Thrace, il dit qu’elle etoit divifée
en cinquante gouvernemens , qu’ il nomme ainfi:
Tkracia in quinquaginta firategios divifa. Plaute emploie
auffi ce nom pour marquer la primauté, le
commandement, le général, l’empire, & en fait
une métaphore pour exprimer le chef d’un fef-
tin, celui deftiné à en faire l’ornement, les honneurs
& en régler les plaifirs. Strategum te facio
huic convivio. La ftratégie eft auffi & furtout la
fcience des mouvemens de guerre de deux armees hors
de l'effet du canon.
La ta&ique n’ étoit donc qu’une partie de la
ftratégique, & q uile rvoit à l’une de fes opéra-
tions , c’eft-à-dire, à celle du jeu & du mouvement
des- corps qui compofent les armées. On
voit que la tàttique , dans cette acception, eft
l’art des évolutions par corps nombreux, comme
les évolutions font une tactique en petit, puisqu'elles
_ meuvent les parties d’ un corps comme
les parties d’ une armée.
On croit que les anciens l’emportoient fur nous
dans cette fcience.
L’invention de la ta&ique e ft , dit-on, attribuée
à Palamédej mais bien ou mal il a toujours
fallu ranger des troupes pour combattre, & vrai-
femblablement le premier chef de guerre les aura
langées finis Palamèdej & comme les hommes,
dans tous les tems ,ont été également doués d’intelligence
, ce premier chef les aura néceffaire-
peuvent être faits que fur des principes , on juge
que cette opinion n’eft fondée que fur 1 ignorance
& la pareffe de ceux qui l’adoptent. Il fera toujours
ment rangées félon fes vues & félon le lieu où il
de voit les faire combattre.
Quelques-uns ont dit que tous les fyftèmes de
ta&ique étoient inutiles, puifqu’ à chaque pas les
différèns terreins néceffitent à des changemens
de mouvemens ; mais comme ces changemens ne
plus aifé de fronder la fcience que d’en acquérir.
/La meilleure taétfque eft celle qui procuré les
meilleures difpofitions & les change facilement,
relativement aux circonftances, aux lieux où l’on
paffe, où l’on doit combattre ,- & c . Ainfi la fcience
de la taélique ne roule pas fur un feul ordre de
batailles dans des plaines ou des pays difficiles,
où l'on met chaque efpèce d’arme à fa place,
mais fur des principes qui guident toujours également
dans l’immenfité ae cas qu’engendre la pro-
digieufe variété de pofitions qui fe rencontrentj &
comme les Grecs & les Romains nous ont donné
autant de règles fur cette partie, que d’exemples ,
il fuit qu’une taélique favante devroit être un mélange
de ce que ces peuples nous ont laiïfé lur cet
objet ï mais ces règles & ces exemples ne fervent
que pour des cas purement femblables. Notre
favante tactique ne peut donc réfulter que de l'application
de ces règles & de ces exemples anciens
aux fituations toujours nouvelles où nous nous
trouvons, combinés avec nos moyens & avec les
modifications qu’a dû apporter l’ufage d^s armes
à feu. . H M 9 Cependant, comme tout ce qui a rapport a la
ta&ique , appartient particuliérement à d’autres
articles, tels que ceux de Dis po s it io n s , Ba ta
illes , Ordres de ba ta ill es , Marches
a porté e de l’ ennemi, & c. qui ont été traités
dans ce Ditlionnaire, nous nous bornerons à raf-
fembler ici les principes que nous ont donnés des
officiers très-inftruits , qui ont traité fort au long
cette matière, & dont nous allons examiner les
ouvrages intéreffans.
Premier fyfieme , attribué a M, Menil-Durand.
Le premier fyftème eft connu fous le nom de
Projet d'un ordre français en tattique.
L’auteur cherche à y démontrer l’abfurdité de
l’ordre mince, & la néceffité de l’ ordre épais ou
profond. Il parle des flottemens, de la foibleffe,
de la lenteur, de l’impoffibilité même du premier
à faire des mouvemens en préfence de l’ennemi $
il appuie fur la force la puiffance du fécond , fon
aptitude à fe mouvoir, même au milieu de l’ennemi
qu’ il enfonce & qu’ il diffipe partout où il
le choque j la légéreté de fes mouvemens, la.
fureté de fes flancs , fi cette épaiffeur forme la
colonne ou au moins fa folidité; fi c’eft Amplement
fur une hauteur qui préferve des flottemens
dans les manoeuvres, & qui puiffe réfifter à une
impulfion puiffante, regardant comme un prodige
de lâcheté que des files de trente-deux hommes
fe laiffaffent enfoncer par des files de trois ou
quatre, les derniers rangs, quoi qu’on puiffe alléd
« Y v v v y 1