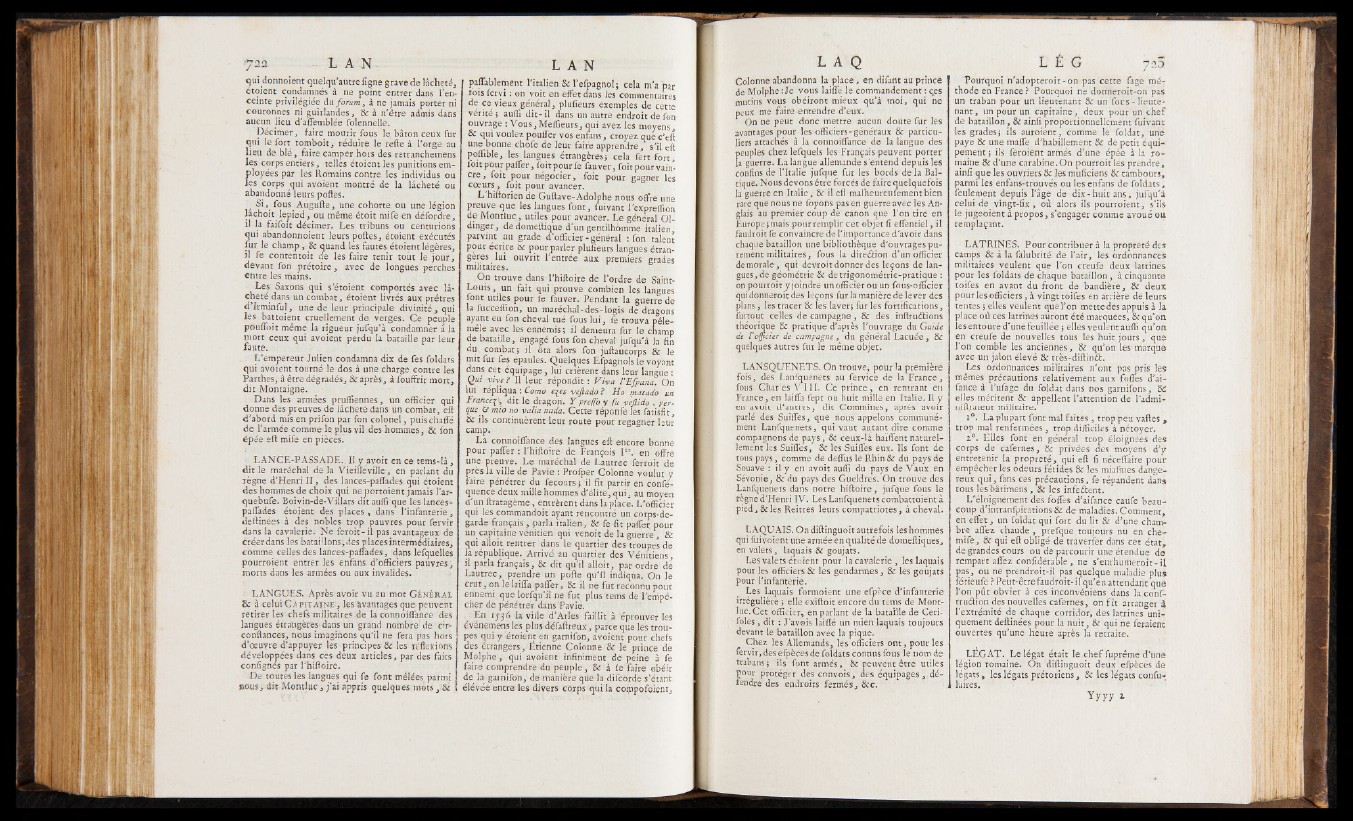
qui donnoient quelqu’autre ligne grave de lâcheté,
étoient condamnés à ne point entrer dans l’enceinte
privilégiée du forum, à ne jamais porter ni
couronnes ni guirlandes, & à n’êcre admis dans
aucun iieu d’affemblée folennelle.
Décimer, faire mourir fous le bâton ceux fur
qui le fort tomboit, réduire, le refte à l’orge au
lieu de blé, faire camper hors des retranchemens
les corps entiers, telles étoient les punitions employées
par les Romains contre les individus ou
les corps qui avoient montré de la lâcheté ou
abandonné leurs portes.
a Si, fous.Augufte, une cohorte ou une légion
lachoit lepied, ou même étoit mife en défordre,
il la faifoit décimer. Les tribuns ou centurions
qui abandonnoîent leurs portes, étoient exécutés
lur le champ, & quand les fautes étoient légères,
il fe contehtoit de les faire tenir tout le jour,
devant fon prétoire, avec de longues perches
entre les mains.
Les Saxons qui s’étoient comportés avec lâcheté
dans un combat, étoient livrés aux prêtres
d’Irminful, une de leur principale divinité , qui
les battoient cruellement de verges. Ce peuple
pouffoit même la rigueur jufqu’à condamner à la
;nort ceux qui avoient perdu la bataille par leur
faute.
L’empereur Julien condamna dix de fes foldats
qui avoient tourné le dos à une charge contre les
Parthes, à être dégradés, & après, à fouffrir mort,
dit Montaigne.
Dans les armées prufliennes, un officier qui
donne des preuves de lâcheté dans un combat, eft ;
d’abord mis en prifon par fon colonel, puis charte i
de l’armée comme le^lus vil des hommes, & fon
épée eft mife en pièces. : -
LANCE-PASSADE. Il y avoir en ce tems-Ià,
dit le maréchal delà Vieilleville, en parlant du
règne d’Henri I I , des lances-paflades qui étoient
des hommes de choix qui ne portoient jamais J’ar-
quebufe. Boivin-de-Villars ditauffi que les lances-
paffades étoient des places, dans l’infanterie,
deftinées à des nobles trop pauvres pour fervir
dans la cavalerie. Ne feroit-il pas avantageux de
créer dans les bataillons} des places intermédiaires,
comme celles des lances-paflades, dans lefquelles.
pourroient entrer les enfans d’officiers pauvres,
morts dans les armées ou aux invalides.
LANGUES. Après avoir vu au mot G é n é r a l
& à celui C a p i t a i n e , les 'avantages que peuvent
retirer les chefs militaires de la connoiflance des
langues étrangères*dans un grand nombre" de c»r^
confiances, nous imaginons qu'il ne fera pas hors
d’oeuvre d’appuyer les principes & les réflexions
développées dans ces deux articles, par des faits
confîgnes par l’hiftoire.
De toutes les langues qui fe font mêlées parmi
cous, dit Montluc, j’ai appris quelques mots,ïg|
paffablement l’italien & l’efpagnol; cela m’a par
fois fervi : on voit en effet dans les commentaires
de ce vieux général, plufieurs exemples de cette
vérité} aufli dit-il dans un autre endroit de fon
ouvrage : Vous,Meilleurs, qui avez les moyens,
& qui voulez pouffer vos enfans, croyez que c’eft
une bonne chofe de leur faire apprendre, s’il eft
poffible, les langues étrangères} cela fert fort,
foit pour pafler, foitpourfe fauver, foit pour vaincre,
foit pour négocier, foit pour gagner les
coeurs, foit pour avancer.
L hiftorien de Guftave-Adolphe nous offre une
preuve que les langues font, fuivant l ’expreffion
de Montluc, utiles pour avancer. Le général 01-
dinger, dedomeftique d’un gentilhomme italien,
parvint au grade d’officier - général :fon talent
pour écrire bc pour parler plufieurs langues étrangères
lui ouvrit l’entrée aux premiers grades
militaires.
On trouve dans l’hiftoire de l’ordre de Saint-
Louis, un fait qui prouve combien les langues
font utiles pour fe fauver. Pendant la guerre de
la fucceflion, un maréchal-des-logis de dragons
ayant eu fon cheval tué fous lui, fe trouva pêle-
mêle avec les ennemis ; il demeura fur le champ
de bataille, engagé fous fon cheval jufqu’à la fin
du combat} il ôta alors fon juftaucorps & le
mit fur fes épaules. Quelques Espagnols le voyant
dans cet équipage, lui crièrent dans leur langue :
Qui vive ? Il leur répondit : Viva VEfpana. On
lui répliqua : Como e^es vejlado ï Ho matado un
Frahcef^ dit le dragon. Ypreffo y fu vêfiido , per-
que & mio no valia nada. Cette réponfe les fatisfit,
& ils continuèrent leur route pour regagner leur
camp.
La connoiflance des langues eft encore bonne
pour pafler : l’hiftoire de François Ier. en offre
une preuve. Le maréchal de Lautrec ferroit de
près la ville de Pavie : Profper Colonne voulut y
faire pénétrer du fecours $ il fît partir en confé-
quence deux mille hommes d’élite, qui, au moyen
d’un ftratagème, entrèrent dans la place. L’officier
qui les commandoit ayant rencontré un corps-de-
garde français, parla italien, & fe fit paffei; pour
un capitaine vénitien qui venoit de la guerre, &
qui alloit rentrer dans le quartier des troupes de
la république. Arrivé au quartier des Vénitiens,
il parla français, & dit qu’il alloit, par ordre de
Lautrec, prendre un porte qu’il indiqua. On le
crut, on lelaiffa paffer, & il ne fut reconnu pour
ennemi que lorfqu’il ne fut plus tems deTerripê-
cher de pénétrer dans Pavie.
En 1536 la ville d’Arles faillit à éprouver les
événemens les plus défaftreux, parce que les troupes
qui y étoient en garni fon, avoient pour chefs
des étrangers, Étienne Colonne & le prince de
Molphe, qui avoient infiniment de peine à fe
faire comprendre du peuple, & à le faire obéir
de la gainifon, de manière que la difcôrde s’étant
élévée entre les divers corps qui la copipofoient.
C o lo n n e a b a n d o n n a la p l a c e , e n d if a n t a u p rin c e
d e M o lp h e :J e v o u s la iffe le c o m m a n d e m e n t : q es
m u tin s v o u s o b é i r o n t m ie u x q u ’à t n o i , q u i n e
p e u x m e fa ire e n te n d r e d ’e u x .
On ne peut donc mettre aucun doute fur les
avantages pour les-officiers-généraux & particuliers
attachés à la connoiflance de la langue des
peuples chez lefquels les Français peuvent porter
la guerre. La langue allemande s’entend depuis les
confins de l’Italie jufque fur les bords delà Baltique.
Nous devonsêtre forcés de faire quelquefois
la guerre en Italie, & il efl maiheureufementbien
rare que nous ne foyons pas en guerre avec les Anglais
au premier coup de canon que l’on tire en
Europe} mais pour remplir cet objet fi effentiel, il
faudroit fe convaincre de l’importance d’avoir dans
chaque bataillon une bibliothèque d'ouvrages purement
militaires, fous la direction d’un officier
de morale, qui devroit donner des leçons de langues,
de géométrie & de trigonométrie-pratique :
on pourroit y joindre un officier ou un fous-officier
qui donneroit des leçons fur la manière de lever des
plans, les tracer & les laver} fur les fortifications,
furtout celles de campagne, & des inftruétions
théorique & pratique d’après l’ouvrage du Guide
de l'officier de campagne, du général Lacuée, &
quelques autres fur le même objet.
LANSQUENETS. On trouve, pour la première
fois, des Lanfquenets au fervice de la France,
fous Char'es V II I. Ce prince, en rentrant en
France, en laiffa fept ou huit mille en Italie. Il y
en avoit d’auttes, dit Commines, après avoir
parlé des Suifles, que nous appelons communément
Lanfquenets, qui vaut autant dire comme
compagnons de pays, & ceux-là haïffent naturellement
les Suifles, & les Suiffes eux. Ils font de
tous pays, comme de deflus le Rhin & du pays de
Souave : il y en avoit auffi du pays de Vaux en
Sévonie, & du pays des Gueldres. On trouve des
Lanfquenets dans notre hiftoire, jufque fous le
règne d’Henri IV. Les Lanfquenets combattoient à
pied, & les Reitres leurs compatriotes, à cheval.
L AQU AIS. On diftinguoit autrefois les hommes
qui fuivoient une armée en qualité de doineftiques,
en valets, laquais & goujats.
Les valets étoient pour la cavalerie, les laquais
pour les officiers & les gendarmes, & les goujats
pour l’infanterie.
Les laquais formoient une efpèce d’infanterie
irrégulière} elle exiftoit encore du tems de Montluc.
Cet officier, en parlant de la bataille de Ceri-
foles, dit : J ’avois laiffé un mien laquais toujours
devant le bataillon avec la pique.
Chez les Allemands, les officiers ont, pour les
fervir, des efpèces de foldats connus fous le nom de
trabans} ils font armés, & peuvent être utiles
pour protéger des convois, aes équipages, défendre
des endroits fermés, &c.
Pourquoi n’adopteroit - on pas cette fage méthode
en France? Pourquoi ne donneroit-on pas
un traban pour un lieutenant & un fous - lieutenant,
un pour un capitaine, deux pour un chef
de bataillon, & ainfi proportionnellement fuivant
les grades} ils auroient, comme le foldat, une
paye & une maffe d’habillement & de petit équipement}
ils feroient armés d’une épée à la romaine
& d’une carabine.On pourroit les prendre,
ainfi que les ouvriers & les muficiens & tambours,
parmi les enfans-trouvés ou les enfans de foldats,
feulement depuis l’âge de dix-huit ans, jufqu’à
celui de vingt-fix, où alors ils pourroient, s’ils
le jugeoient à propos, s’engager comme avoué ou
remplaçant.
LATRINES. Pour contribuer à la propreté des
camps & à la falubrité de l’air, les ordonnances
militaires veulent que l’on creufe deux latrines
pour les foldats de chaque bataillon, à cinquante
toiles en avant du front de bandière, & deux
pour les officiers, à vingt toifes en arrière de leurs
tentes} elles veulent que l’on mette des appuis à la
place où ces latrines auront été marquées, & qu’on
les entoure d’une feuillée} elles veulent auffi qu’on
en creufe de nouvelles tous les huit jours, que
l’on comble les anciennes, & qu’on les marque
avec un jalon élevé & très-diftinft.
Les ordonnances militaires n’ont pas pris les
mêmes précautions relativement aux folles d’ai-
fance à l’ufage du foldat dans nos garnifons, &
elles méritent & appellent l’attention de l’admi-
niftrateur militaire.
i°. La plupart font mal faites, trop peu vaftes ,
trop mal renfermées, trop difficiles à nétoyer.
20. Elles font en général trop éloignées des
corps de cafernes, & privées des moyens d’y
entretenir la propreté, qui eft fi néceffaire pour
empêcher les odeurs fétides & les miafmes dangereux
qui, fans ces précautions, fe répandent dan*
tous les bâtimens, & les infeélent.
L’éloignement des foffes d’aifance caufe beaucoup
d’intranfpirations & de maladies. Comment,
en effet, un foldat qui fort du lit & d’yne chambre
affez chaude, prefque toujours nu en che-
mife, & qui eft obligé de traverfer dans cet état,
de grandes cours ou de parcourir une étendue de
rempart affez confidérable, ne s’enrhumeroit-il
pas, ou ne prendroit-il pas quelque maladie plus
férieufe ? Peut-être faudroit-il qu’en attendant que
l’on pût obvier à ces inconvéniens dans la conf-
truéhon des nouvelles cafernes, on fît arranger à
l’extrémité de chaque corridor, des latrines uniquement
deftinées pour la nuit, & qui ne feraient
ouvertes qu’une heure après la retraite.
LÉGAT. Le légat était le chef fuprême d’une
légion romaine. On diftinguoit deux efpèces de
légats, les légats prétoriens, & les légats confu-
laires.
Yyyy 2