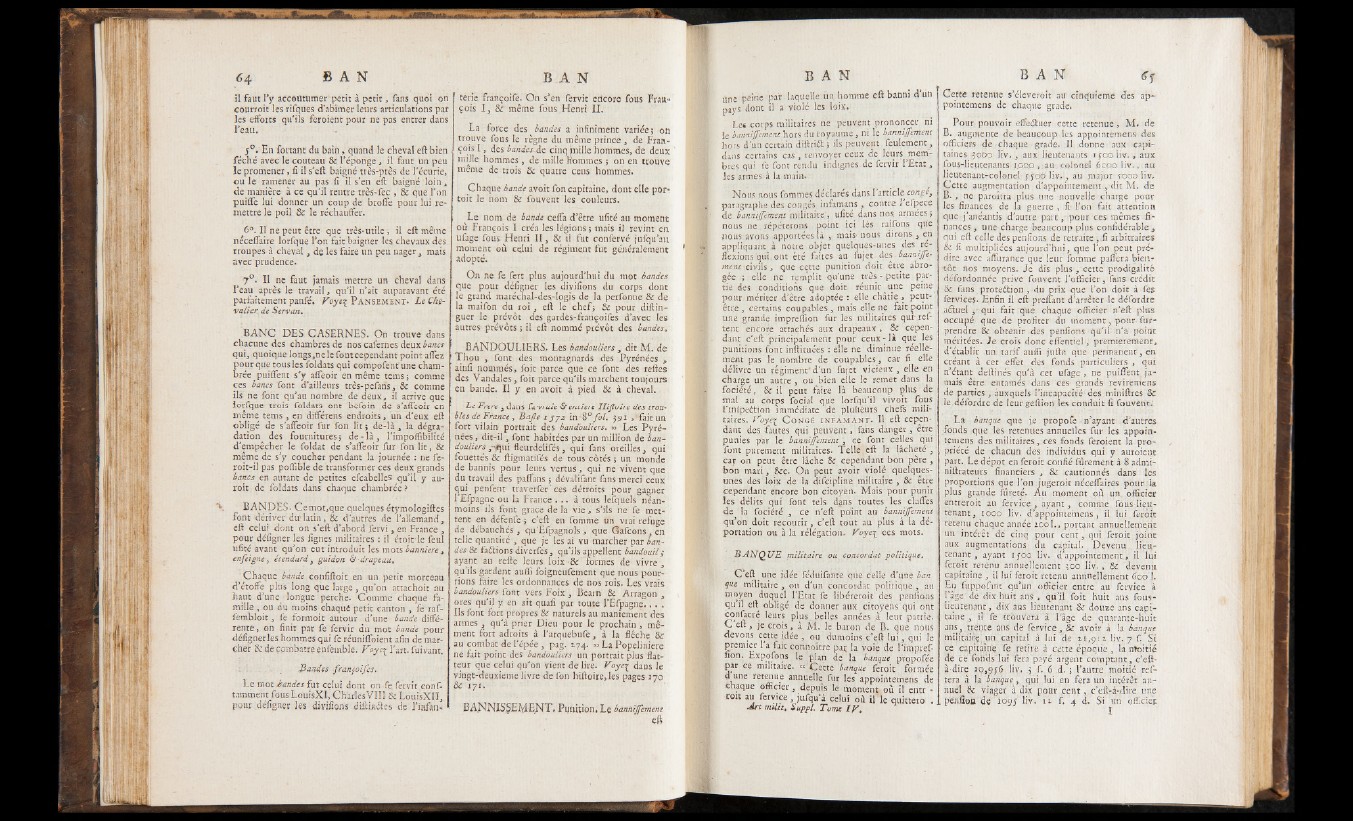
6 4 B A N
il faut Ty accoutumer petit à petit, fans quoi on
courroit les rifques d’abîmer leurs articulations par
les efforts qu’ils feroient pour ne pas entrer dans
l ’eau.
5 ° . En fortant du bain, quand le cheval eft bien
féché avec le couteau & l’éponge , il faut un peu
le promener, fi il s’eft baigné très-près de l’écurie,
ou le ramener au pas -fi il s’en eft baigné loin ,
de manière à ce qu'il rentre très-Tec , & que l’on
puiffe lui donner un coup de broffe pour lui remettre
le poil 3c le réchauffer.
6°. Il ne peut être que très-utile, il eft même
nêceffaire lorfque l’on fait baigner les chevaux des
troupes à cheval , de les faire un peu nager , mais
avec prudence»
7 ° . Il ne faut Jamais mettre un cheval dans
l’éau après le travail , qu’il n’ait auparavant été
parfaitement panfé. Voye^ P an sem en t* Le Cke-
valler de Servan.
B A N C DES CASERN ES . On trouve dans
chacune des chambres de nos cafernes deux bancs
qui, quoique longs,ne le font cependant point affez
pour que tous les foldats qui compofentune chambrée
puiffent s’y affeoir en même tems ; comme
ces bancs font d’ailleurs très-pefaris, & comme
ils ne font qu’ au nombre de deux, il arrive que
lorfque trois foldats ont befoin de s’affeoir en
même tems, en différens endroits, un d’eux eft
obligé de s’affeoir fur fon lit ; dè-là , la dégradation
des fournitures ; de - l à , l’impoffibilîté
d’empêcher le foldat de s’affeoir fur fon l i t , &
même de s’y coucher pendant la journée : ne fe-
roit-il pas poflible de transformer ces deux grands
bancs en autant de petites efcabelles qu’il y au-
roit de foldats dans chaque chambrée ?
% BANDE S- C e mot,que quelques étymologiftes
font dériver du'latin, & d’autres de l’ allemand,
eft celui dont on s’ eft d’abord fervi, en France ,
pour défigner les lignes militaires : il étoit-le feul
ufïté avant qu’on eut introduit les mots bannière ,
enfeigne, étendard , guidon & drapeau.
Chaque bande confîftoit en un petit morceau
d’étoffe plus long que large, qu’on attachoit au
haut d’une longue perche. Comme chaque famille
, ou du moins chaque petit canton , fë raf-
fembloit, fe formoit autour d’ une bande différente,
on finit par fe fervir du mot bande pour
défigner les hommes qui fe réuniffoient afin de marcher
8c de çpipbatre enfemble. Voye^ l’art, fuivant.
Bandes franpoifes.
Le mot bandes fut celui dont on fe. fervit conf-
tamment fous LouisXI, CharlesVIIÎ & LouisXII,
pour défîgner les divifions di-ftiji&es de l’infan-
B A N
terie françoife. On s’ en fervit etîcore fous François
I , 8c même fous^Henri II.
La force des bandes a infiniment variée; on
trouvé fous le règne du même prince, de François
I , des bandes.&ç. cinq (mille hommes, de deux
mille hommes , de mille hommes ; on en trouve
meme de trois 8c quatre cens hommes.
Chaque bande avoit fon capitaine, dont elle porr
toit le nom 8c fouvent les couleurs.
Le nom de bande ceffa d’être ufîté au moment
où François I créa les légions ; mais il revint en
ufage fous Henri I I , 8c il fut confervé jufqu’au
moment où celui de régiment fut généralement
adopté.
On ne fe fert plus aujourd’hui du mot bandes
que pour défigner les diyifions du corps dont
le grand maréçhal-des-logis de la perfonne 8c de
la maifon du r o i , eft le chef; & pour diftin-
guer le prévôt des gardés-françoifes d’avec les
autres prévôts ; il eft nommé prévôt des bandes.
B ANDOU LIERS. Les bandouliers, dit M . de
Thou , font des montagnards des Pyrénées ,
ainfi nommés, foit parce que ce font des reliés
des Vandales, foit parce qu’ils marchent toujours
en bande. Il y en avoit à pied 8c à cheval.
Le Frere , dans fa vraie & entière Hifloire des troubles
de France , Baße iy y z in-8° fol. 591 , fait un
fort vilain portrait des bandbulièrs. m Les Pyrénées,
d it-il, font habitées par un million de ban-
douliers yiqui fleurdelifés, qui fans oreilles, qui
fouettés 8c ftigmatifés de tous côtés ; un monde
de bannis pour leurs vertus, qui ne vivent que
du travail des paffans ; dévalifant fans merci ceux
qui penfent traverfer’ ces détroits pour gagner
l’Efp'agne ou la France . . . à tous lefquels néanmoins
ils font grâce de la v ie , s’ils ne fe mettent
en défenfe 5 c’eft en fomme un vrai refuge
de^débauchés , qu’Efpagnols , que Gafcons,en
telie quantité , que je les ai vu marcher par bandes
8c factions diverfes, qu’ils appellent bandouil;
ayant au refte leurs loix *& formes de v iv r e ,
qu’ils gardent aufli foigneufement que nous pourrions
faire les ordonnances de nos rois. Les vrais
bandouliers font vers Foix , Béarn 8c Arragon ,
ores qu’ il y en ait quafi par toute J’Efpagne.. . .
Ils font fort propres 8c naturels au maniement des
armes , qu’ à prier Dieu pour le prochain, mê-
ment fort adroits à l’arquebufe, à la flèche 8c
au combat de l’épée , pag. 174. « La Popeliniere
ne fait point des bandouliers un portrait plus flatteur
que celui qu’ on vient de lire. Voye% dans le
vingt-deuxieme livre de fon hiftoire,les pages 170
8c jy r .
BANNISSEMENT» Punition. Le bannijfement
eft
B A N
une peine par laquelle un homme eft banni d un
pays dont i f a violé les loix.
Le« corps militaires ne peuvent prononcer ni
ie bannijfetnent hors du royaume, ni le bannijfement
hors d’un certain diftri& i ils peuvent feulement ,
dans certains c a s , renvoyer ceux de leurs membres
qui fe font rendu indignes de fervir l’E ta t,
les armes à la main*
Nous nous fommes déclarés dans 1 article congé,
paragraphe des congés, infamans , contre 1 efpece
de bannijfement militaire', ufité dans nos, armées ;
nous n e .. répéterons point ici lés raifons que
nous avons apportées là , mais* nous dirons , en
appliquant, à notre objet quelques-unes des reflexions
qui. ont été faites au fujet des - banni.Jfe- ;
ment civils, que cette punition doit être abrogée
; elle ne remplit qu’une très- petite partie
des conditions que doit réunir une peine ^
pour mériter d’être adoptée : elle châtie , peut-
être , certains coupables, mais elle ne fait point
une grande impreflion fur les militaires qubref-
tent encore attachés aux drapeaux , 8c cependant
c’ eft principalement pour Ceux-là que les
punitions font inftituées : elle ne diminue réellement
pas le nombre de coupables, car fi elle
délivre un régiment*d’un fujet v icieux , elle en
charge un autre , ou bien elle le remet dans la
fociété, 8c il peut faire là beaucoup plus de
mal au corps focial que lorfqu’il vivoit fous
l’infpeétiori immédiate de plufieurs chefs militaires.
Foyei C ongé in f am a n t . Il eft cependant
des fautes qui peuvent, fans danger, être
punies par le bannijfement ', ce font celles qui
font purement militaires. Telle eft la lâcheté,
cay on peut être lâche 8c cependant bon p ère,
bon mari, 8cc. On peut avoir violé quelques-
unes des loix de la difcipline militaire, 8c être
cependant encore bon citoyén. Mais pour punir
les délits qui font tels djns toutes les claffes
de la fociété , ce n’eft point au bannijfement
qu’on doit recourir, c’eft tout au plus à la déportation
ou à la rélégation. Voye^ c-es mots.
B A N Q U E militaire ou concordat politique.
C ’eft une idée féduifante que celle d’une ban
Hue militaire, ou d’un concordat politique,, au
moyen duquel^ l’Etat fe libéreroit des penfions
qu il eft obligé de donner aux citoyens qui ont
confacré leurs plus, belles années à leur patrie.
C e ft, je crois, à M . le baron de B. que nous
devons cette idée , ou dumoins c’ eft lu i, qui le
premier 1 a fait çonnoître paç la voie de l ’impref-
fion. Expofons le plan de la banque prqpofée
par ce militaire. « Çette banque (ero.it formée
d une retenue annuelle fur les appoirttemens de
chaque officier, depuis le moment où il entr -
roit au fervice, jufqu’à celui où il’ le quittero .
Art milit, Suppl. Tome I F .
BAN <?ƒ
Cette retenue s’éleveroit au cinquième des ap-
pointemens de chaque grade.
Pour pouvoir effectuer cette retenue, M. de
B. augmente de beaucoup les appoiatemens des
officiers de'chaque grade. Il donne aux capitaines
3000 l i v . , aux lieutenants 150© l iv ., aux
fous-lieutenants 1.000, au colonel 6o.oo liv ., au
lieutenant-colonel yyoo- %>;, au major yooo liv.
Cette augmentation d’appointement., dit M. de
B ., ne paroîtra.plus une nouvelle charge pour
les finances de la guerre , fi l’on fait attention
que j’anéantis d’autre part, pour ces mêmes finances
, une- charge beaucoup plus confidérable *
qui eft celle des penfions de retraite ,.fi arbitraires
& fi multipliées aujourd’hui, que l’on.peut prédire
avec affurance que leur fomme paftera bientô
t nos moyens. Je dis p lu s , cette prodigalité
défordonnée prive fouvent l’officier, fans crédit
& fans, protection, du prix que l’on doit à fes
fervices. Enfin il eft preffant d’arrêter le défordre
aétuel qui fait que chaque officier n’eft plus
occupé que de profiter du moment, pour fur-
prendre & obtenir des penfions qu’ il ;n’a point
méritées. Je crois donc effentiel, premièrement,
d’établir .un. tarif aufli jufte que permanent, en
créant à cet effet des fonds particuliers , qui
n’étant deftinés qu’à cet ufage , ne puiffent jamais
être entamés dans ces grands reviremens
de parties, auxquels l’incapacité des miniftres 3c
le.défordre de leurgeftion les conduit fi fouvent.
La banque que j.e propofe n’ayant d’autres
fonds que les retenues annuelles fur les appoin-
temens des militaires, ces fonds feroient la.propriété
de chacun des individus qui y auroient
part. Le dépôt en feroit confié fûrement à 8 admi-
niftrateurs financiers , 3c cautionnés dans les
proportions que l'on iugeroit néceffaires pour La
plus grande fureté. Au moment où un. officier
entreroit au fèrvice , ayant , comme fous lieutenant,
ibop liv. d’appointemens , il lui feroit
retenu chaque année 2001., portant annuellement
un intérêt de cinq pour cent, qui feroit joint
aux augmentations', du capital. Devenu lieutenant
, ayant iydô liv. Ù’appointement, il lui
fèroit retenu annuellement 300 l i v . , 3c devenu
capitaine , il lui feroit retenu annuellement 600 I.
En fuppofint qu’un officier entre au fervice à
l’âge de dix huit ans , qu’il foit huit ans fous-
lieutenant, dix ans lieutenant & douze ans capitaine
, il fe trouvera à l’âge de quarante-huit
ans, trente ans de fervice, & avoir à la banque
militaire; un capital à lui de 21,9 i.i liv. 7 f. Si
ce capitaine fe retire à cette époque, la moitié
de ce fonvds"lui fera "payé argent comptant, c’ eft-
à-di.re liv. f. 6 d. ; l’autre moitié rëftera
à la banque y qui lui en fera un intérêt annuel
3c viager à dix poar c en t , c’eft-à-tlire une
pe'nfioa de 10 9 / liv. i | f. 4 d. Si un officiel: