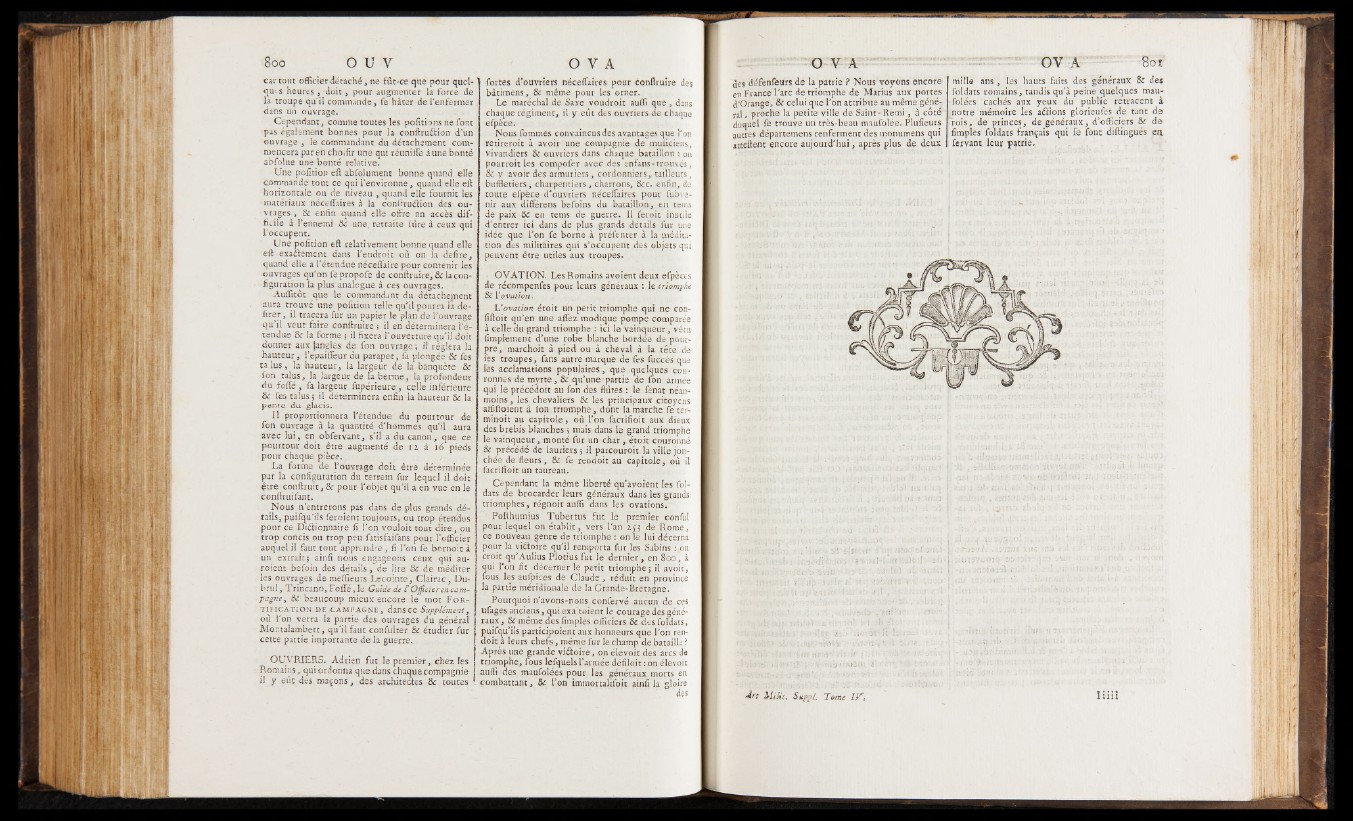
800 O U V
car tout officier détaché j ne fût-ce que pour quelques
heu res , 'doit, pour augmenter la force de
la troupe qu'il commande, fe hâter de renfermer
dans un ouvrage.
Cependant, comme toutes les pofitions ne font
pas également bonnes pour là conftru&ion d'un
ouvrage , le commandant du détachement commencera
par en choifir une qui réunifie aune bonté
abfolue une bonté relative.
Une pofition eft abfolument bonne quand elle
commande tout cè qui l’environne, quand elle eft
horizontale ou de niveau , quand elle fournit les
matériaux néceffaires à la conftru&ion des ouvrages
, & enfin quand elle offre nn accès difficile
à l’ennemi & une. retraite fure à ceux qui
l’occupent.
Une pofition eft relativement bonne quand elle
eft exa&ement dans l’endroit où on la defire,
quand elle a l’étendue nécefiaire pour contenir les
ouvrages qu’on fepropofe de conftruire, & la configuration
la plus analogue à ces ouvrages.
Auffitôt que le commandant du détachement
aura trouvé une pofition telle qu’il pourra la de-
firer, il tracera fur un papier le plan de l’ouvrage
qu’il veut faire conftruire ; il en déterminera l’étendue
& la forme 5 il fixera l’ouverture qu’il doit
donner aux (angles de fon ouvrage; il réglera la
hauteur, l’épaifleur du parapet, fa plongée & fes
talus, la hauteur, la largeur de la banquète &
fon talus, la largeur de la berme, la profondeur
du folié-, fa largeur fupérieure, celle inférieure
& fes talus ; il déterminera enfin la hauteur & la
pente du glacis.
Il proportionnera l’étendue du pourtour de
fon ouvrage à la quantité d’hommes qu’il aura
avec lui, en obfervant, s’il a du canon, que ce
pourtour doit être augmenté de 12 à 1 6 pieds
pour chaque pièce.
La forme de l’ouvrage doit être déterminée
par la configuration du terrein fur lequel il doit ;
çtre conftruit, & pour l’objet qu’il a en vue en le
conftruifant.
Nous n’entrerons pas dans de plus grands détails,
puifqu’ils feroient toujours, ou trop étendus
pour ce Dictionnaire fi l’on vouloit tout dire, ou
trop concis ou trop peu fatisfaifans pour l’officier
auquel il faut tout apprendre, fi l’on fe bornoit à
un extrairj ainfi nous engageons ceux qui au-
roient befoin des détails, de lire & de méditer
les ouvrages de mefiieurs Lecointe, Clairac, Du-
brul, Trincano, Foffé, le G u id e d e F O f f ic ie r en cam p
a g n e , & beaucoup mieux encore le mot Fortification
DE CAMPAGNE, dans ce S u p p lém e n t ,
où l’on verra la partie des ouvrages du général
Montalambert, qu’il faut confulter & étudier fur
cette partie importante de la guerre.
OUVRIERS. Adrien fut le premier, chez les
Romains, quiordonna que dans chaque compagnie
il y eût des maçons, des architectes & toutes
O V A
fortes d’ouvriers néceffaires pour conftruire des
bâtimens, & même pour les orner.
Le maréchal de Saxe voudroit auffi que, dans
chaque régiment, il y eût des ouvriers de chaque
efpèce.
Nous fommes convaincus des avantages que l'on
retireroit à avoir une compagnie de muficiens,
vivandiers & ouvriers dans chaque bataillon : on
pourroit les compofer avec des enfans-trouvés,
& y avoir des armuriers, cordonniers, tailleurs,
buffletiers, charpentiers, charrons, &c.. enfin, de
■ toute efpèce d’ouvriers néceffaires pour fu;bve-
nir aux différens befoins du bataillon, en teins
de paix & en tems de guerre. Il feroic inutile
d’entrer ici dans de plus grands détails fur une
idée que l’on fe borne à préfenter à la méditation
des militaires qui s’occupent des objets qui
peuvent être utiles aux troupes.
OVATION. Les Romains avoient deux efpèces
de récompenfes pour leurs généraux : le tr iomphe
& Y o v a t i o n .
\ J o v a t io n étoit un petit triomphe qui ne con-
fiftoit qu’en une aflez modique pompe comparée
à celle du grand triomphe : ici le vainqueur, vêtu
Amplement d’une robe blancjie bordee de pourpre,
marchoit à pied ou à cheval à la têre de
fes troupes, fans autre marque de fes fuccès que
lès acclamations populaires, que quelques couronnes
de myrte, & qu’une partie de fon armée
qui le précédoit au fon des flûtes : le fénat néanmoins
, les chevaliers & les principaux citoyens
affiftoient à fon triomphe, dont la marche fe ter-
minoit au capttole, où l’on facrifioit aux dieux
des brebis blanches ; mais dans le grand triomphe
le vainqueur, monté fur un char, étoit couronné
& précédé de lauriers ; il parcouroit la ville jonchée
de fleurs, 8c fe rendoit au capitole, où il
facrifioit un taureau.
Cependant la même liberté qu’avoient les foldats
de brocarder leurs généraux dans les grands
triomphes, régnoit auffi dans les ovations.
Pofthumius Tubertus fut le premier conful
pour lequel on établit, vers l’an 2j$ de Rome,
ce nouveau genre de triomphe : on le lui décerna
pour la vi£oire qu’il remporta fur les Sabins i^on
proit qu’Aulius Plotius fut le dernier, en 800, à
qui l’on fit décerner le petit triomphe; il avoir,
fous les aufpices de Claude,, réduit en province
la partie méridionale de la Grande-Bretagne.
Pourquoi n’avons-nous confervé aucun de ces
ufages anciens, quiexa’toient le courage des généraux
, & même des Amples officiers 8e des foldats,
puifqu’ils participoient aux honneurs que l ’on rendoit
à leurs chefs , même fur le champ de bataille ?
Après une grande victoire, on élevoit des arcs de
triomphe, fous lefquels l’armée défiloit : on élevoit
auffi des maufolées pour les généraux morts en
combattant, & l’on immortalifoic ainfi la gloire
O V À
des défenfeurs de la patrie ? Nous voyons encore
en France l'arc de triomphe de Marius aux portes
d’Orange, 8e celui que l’on attribue au même général
j proche la petite ville de Saint-Remi, à c ô t é ’
duquel fe trouve un très-beau maufolée. Plufîeurs
autres départemens renferment des monumens qui
attellent encore aujourd’hui, après plus de deux
OV A Soi
mille ans, les hauts faits des généraux & de*
foldats romains, tandis qu’à peine quelques maufolées
cachés aux yeux, du public retracent à
notre mémoire les allions glorieufes de tant de
rois, de princes, de généraux, d’officiers 8e de
fimples foldats français qui fe font diftingués en
feryant leur patrie.
Mi lit, Suppl, Tome IVt ï i i i l