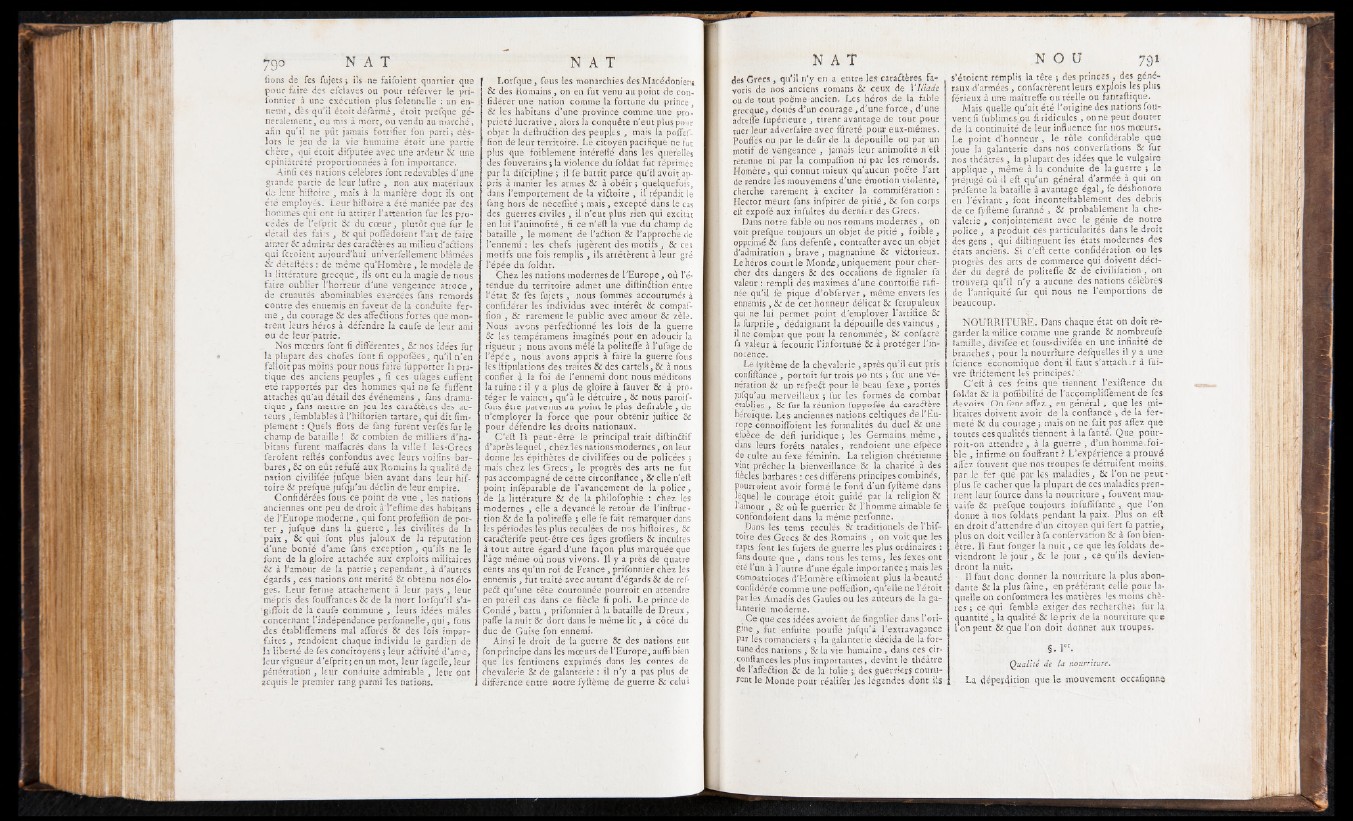
79<5 N A T
(ions de fes fujets ; ils -ne faifoient quartier que
pour faire des efciaves ou pour réferver le pri-
fonnier à une exécution plus folennelle : un en- ;
nemi, dès qu'il étoit défarmé, étoit prefque généralement,
ou mis à mort, ou vendu au marché ,
afin qu'il ne pût jamais fortifier ion parti > dès-
lors le jeu de la vie humaine étoit une partie
chère, qui étoit difputée avec une ardeur & une
opiniâtreté proportionnées à fon importance.
Ainfî ces nations célèbres font redevables d'une
grande partie de leur lufire , non aux matériaux
de leur hittoire , mais à la manière dont ils ont
été employés. Leur hiftoire a été maniée par des
hommes qui ont lu attirer l'attention fur les procédés
de l’efprit & du coe u r , plutôt que fur le
détail des faits , & qui poffédoient l'ait de faire
aimer & admirer des caractères au milieu d'aétions
qui feroient aujourd'hui univerfellement blâmées
& déteftécs : de même qu’Ho mère, le modèle de
la littérature grecque, ils ont eu la magie de nous
faire oublier l'horreur d'une vengeance atroce,
de cruautés abominables exercées fans remords
contre des ennemis en faveur de la conduite ferme
, du courage & des affections fortes que montrent
leurs héros à défendre la caufe de leur ami
ou de leur'patrie.
_ Nos moeurs font fi différentes, & nos idées fur
la plupart des chofes font fi oppofées, qu’il n'en
falloir pas moins pour nous faire fupporter h pratique
des anciens peuples, fi ces ufages euffent
été rapportés par des hommes -qui ne fe fulfent
attachés qu’au détail des événemens , fans dramatique
, fans mettre en jeu les caractères des acteurs
,femblables ài'hiftorien tartare, qui dit fim-
plement : Quels flots de fang furent verfés fur le
champ de bataille ! & combien de milliers d'ha-
bitans furent maffacrés dans la ville ! les-Grecs
feroient reftés confondus avec leurs voifîns barbares
, & on eût refufé aux Romains la qualité de
nation civilifée jufque bien avant dans leur hiftoire
& prefque jufqu'au déclin de leur empire.
Confidérées fous ce point de vue , les nations
anciennes ont peu de droit àTeftime des habitans
de l'Europe moderne, qui font profeflion de porter
, jufque dans la guerre,.les civilités de la
paix , & qui font plus jaloux de la réputation
d’une bonté d’ame fans exception, qu'ils ne le
font de la gloire attachée aux exploits militaires
& à l'amour de la patrie; cependant, à d’autres
égards, ces nations ont mérité & obtenu nos éloges.
Leur ferme attachement à leur pays , leur
mépris des fouffrances & de la mort lorfqu'il s’a-
giffoit de la caufe commune , leurs idées mâles
concernant l'indépendance perfonnelle, qui, fous
des établiffemens mal affurés & dès lois imparfaites
, rendoient chaque individu le gardien de
la liberté de fes concitoyens ; leur activité d'ame,
leur vigueur d'efprit;en un mot, leur fagelfe, leur
pénétration , leur conduite admirable , leur ont
acquis le premier rang parmi les nations. 1
N A T
Lorfque, fous les monarchies des Macédoniens
& des Romains, on en fut venu au point de çon-
fidérer une nation comme la fortune du prince,
& les.habitans d'üne province comme,une propriété
lucrative, alors la conquête n'eut plus pour
objet la deftruétion des peuples , mais la poffef-
fion de leur territoire. Le citoyen pacifique ne fut
plus que foiblement intérellé dans les querelles
des fouverains ; la violence du foldat fut réprimée
par la difcipline ; il fe battit parce qu'il avoit appris
à manier les armes & à obéir ; quelquefois,
dans l'emportement de la victoire , il répandit le
fang hors de néceflité ; mais, excepté dans le cas
des guerres civiles, il n’eut plus rien qui excitât
en lui l'anivnofité, fi ce n'eft la vue du champ de
bataille , le moment de l'aétion & l’approche de
l’ennemi : les chefs jugèrent des motifs , & ces
motifs une fois remplis , ils arrêtèrent à leur gre
l’épée du foldat.
Chez les nations modernes de l'Europe, où l’étendue
du territoire admet une diftinction entre
l'état & fes fujets , nous fommes accoutumés à
çonfidérer les individus avec intérêt & compaf-
fion , & rarement le public avec amour & zèle.
Nous avons perfectionné les lois de la guerre
& les tempéramens imaginés pour en adoucir la
rigueur ; nous avons mêlé la politeffe à l'ufage de
l’épée , nous avons appris à faire la guerre fous
les ftipulations des traités & des cartels, & à nous
confier à la foi de l’ennemi donc nous méditons
la ruine : il y a plus de gloire à fauver & à pro-
téger le vaincu, qu'à le détruire, & nous paroif-
fons ptre parvenus au point le plus defirable, de
n'empfoyer la force que pour obtenir juftice &
| pour défendre les droits nationaux.
| Ç'eft là peut-être le principal trait diftinétif
d’après lequel, chez les nations modernes, on leur
donne les épithètes de civilifées ou de policées ;
mais chez les Grecs-, le progrès des arts ne fut
pas accompagné de cette circonftance, & elle n'eft
point inféparable de l’avancement de la police,
de la littérature & de la philofophie : chez les
modernes , elle a devancé le retour de l'inftruc-
tion & de la politeffe ; elle fe fait remarquer dans
les périodes les plus reculées de nos hiftoires, &
caraétérife peut-être ces âges groffiers & incultes
à tout autre égard d'une façon plus marquée que
l’âge même où nous vivons. Il y a près de quatre
cents ans qu’un roi de France, prifonnier chez les
ennemis , fut traité avec autant d'égards & de ref-
peCt qu'une tête couronnée pourroit en attendre
en pareil cas dans ce fiècle fi poli. Le prince de
Condé, battu , prifonnier à la bataille de Dreux,
paffe la nuit & dort dans le même l i t , à côté du
duc de Guise fon ennemi.
Ainsi le droit de la guerre & des nations eut
fon principe dans les moeurs de l’Europe, aufli bien
que les fentimens exprimés dans les contes de
chevalerie & de galanterie : il n'y a pas plus de
différence entre notre fyftème de guerre & celui
N A T
des Grecs, qu‘il n’y en a entre les- cara&ères fa- ,
voris de nos anciens romans & ceux de VIliade j
ou de tout poème ancien. Les héros de la fable ■
grecque, doués d’un courage,d’une force, d'une
adreffe fupérieure , tirent avantage de tout pour
tuer leur adverfaire avec fûreté pou!r eux-mêmes.
Pouffes ou par le defir de la dépouille ou par un
motif de vengeance , jamais leur animofité n’eft
retenue ni par la compaffion ni par les remords.
Homère, qui connut mieux qu'aucun poète l'art
de rendre les mouyemens d’une émotion violente,
cherche rarement à exciter la commifération :
Hector meurt fans infpirer de pitié, & fon corps
eft expofé aux infultes du dernier des Grecs.
Dans notre fable ou nos romans modernes , on
voit prefque toujours un objet de pitié , foible ,
opprimé -& fans défenfe, contrafter avec un. objet
d’admiration , bravé, magnanime & vi&orieux.
Le héros court le Monde, uniquement pour chercher
des dangers & des occafions de fignaler fa
valeur : rempli des maximes d'une courtoifie rafi-
née qu'il fe pique d’obferver, même envers fes
ennemis , & de cet honneur délicat & fcrupuleux
qui ne lui permet point d ’employer l’artifice &
la furprife , dédaignant la dépouille des vaincus ,
il ne combat que pour la renommée, & confacre '
fa valeur à fecourir l’infortuné & à protéger l'innocence.
Le (yltème de la chevalerie , après qu'il eut pris
confiftance , portoit fur trois po nts ; fur une vénération
& un refpeét pour le beau fe x e , portés
jufqu'au merveilleux fur les formes de combat
établies , & fur la réunion fuppofée du caractère
héroïque. Les anciennes nations celtiques de l'Europe
connoiffoient les formalités du duel & une
êfpèce de défi juridique ; les Germains même,
dans leurs forêts natales, rendoient une efpèce
de culte au fexe féminin. La religion chrétienne
vint prêcher la bienveillance & la charité à des
fi.ècles barbares : ces différens principes combinés,
pourroient avoir formé le fond d'urt fyftème dans
lequel le courage étoit guidé par la religion &
l’amour , & où ïe guerrier & l’homme aimable fe
confondoient dans la même perfonne. ,
Dans les tems reculés & traditjonels de l ’hif-
toire des Grecs & des Romains , on voit que les
rapts font les fujets de guerre les plus ordinaires :
fans doute que , dans tous les tems, les lexes ont
été l’un à l’autre d'une égale importance ; mais les
compatriotes d’Homère eftimoient plus la beauté
considérée comme une poffeflïon, qu'elle ne l’étoit
par les Amadis des Gaules ou les auteurs de la galanterie
moderne.
Ce que ces idées avoient de fingulier dans l'origine
, fut enfuite pouffé jufqu'à l’extravagance
par les romanciers ; la galanterie décida de la fortune
des nations , & la vie humaine, dans ces cir-
.confiances les plus importantes, devint le théâtre
de l'affeétion & de la folie $, des guerriers coururent
le Monde pour réalifer les légendes dont ils
N O U 791
s’étoient remplis la tête ; des princes , des généraux
d’armées, confacrèrent leurs explois les plus
-férieux à urne maîtreffe ou réelle ou fanraftique.
Mais quelle qu'ait été l’origine des nations fou-
vent fi fublimcs„qu fi ridicules , on ne peut douter
de la continuité de leur influence fur nos moeurs.
Le point d’honneur , le rôle confidérable que
joue la galanterie dans nos converfations & fur
nos théâtres , la plupart des idées que le vulgaire
applique , même à la conduite de la guerre ; le
préjugé où il eft qu'un général d’armée à qui on
préfente la bataille à avantage égal, fe déshonore
en l 'évitant, font incontestablement des débris
de ce fyftème furanné , & probablement la chevalerie
, conjointement avec le génie de notre
police , a produit ces particularités dans le droit
des gens , qui diftinguent les états modernes des
états anciens. Si c’eft cette confidération ou les
progrès des arts de commerce qui doivent décider
du degré de politeffe & de civilifation , on
trouvera qu'il n’y a aucune des nations célèbres
de l'antiquité fur qui nous ne l ’emportions de
beaucoup.
NOURRITURE. Dans chaque état on doit regarder
la milice comme une grande & nombreufe
famille, divifée et fousrdivifée en une infinité de
branches , pour la nourriture defquelles il y a une
fcience économique dont i l faut s'attacha à Cuivre
ftriétement les principes.".-
C'eft à ces feins que tiennent l’exiftence du
foldat & la poffibilité de l’accompliffement de fes
devoirs. On fenc affez , en général , que les militaires
doivent avoir de la confiance j de la fermeté
& du courage ; mais on ne.fait pas affez que
toutes ces qualités tiennent à la fanté. Que pour-
roit-on attendre, à la guerre , d'un homme Toi-
ble , infirme ou fouffrant ?. L’expérience a prouvé
affez fouvent que nos troupes fe détruifent moins,
par le fer que par les maladies, & l’on ne peut-
plus fe cacher que la plupart de ces maladies prennent
leur fource dans la nourriture, fouvent mau-
vaife & prefque toujours infuffifante, que l’on
donne à nos foldats pendant la paix. Plus on eft
en droit d’attendre d’un citoyen qui fert fa patrie,
plus on doit veiller àffa confervation & à fon bien-
être. Il faut fonger la nuit, ce que les foldats deviendront
le jou r, & le jour , ce qu'ils deviendront
la nuit.
• Il faut donc donner la nourriture la plus abondante
& la plus faine, en préférant celle pour laquelle
on confommera les matières 'es moins chères
; ce qui femble exiger des recherche» fur la
quantité, la qualité & le prix de la nourriture que
Ion peut & que l'on doit donner aux troupes.
§. Ier.
Qualité de la nourriture.
■ La déperdition que le mouvement occafionnô