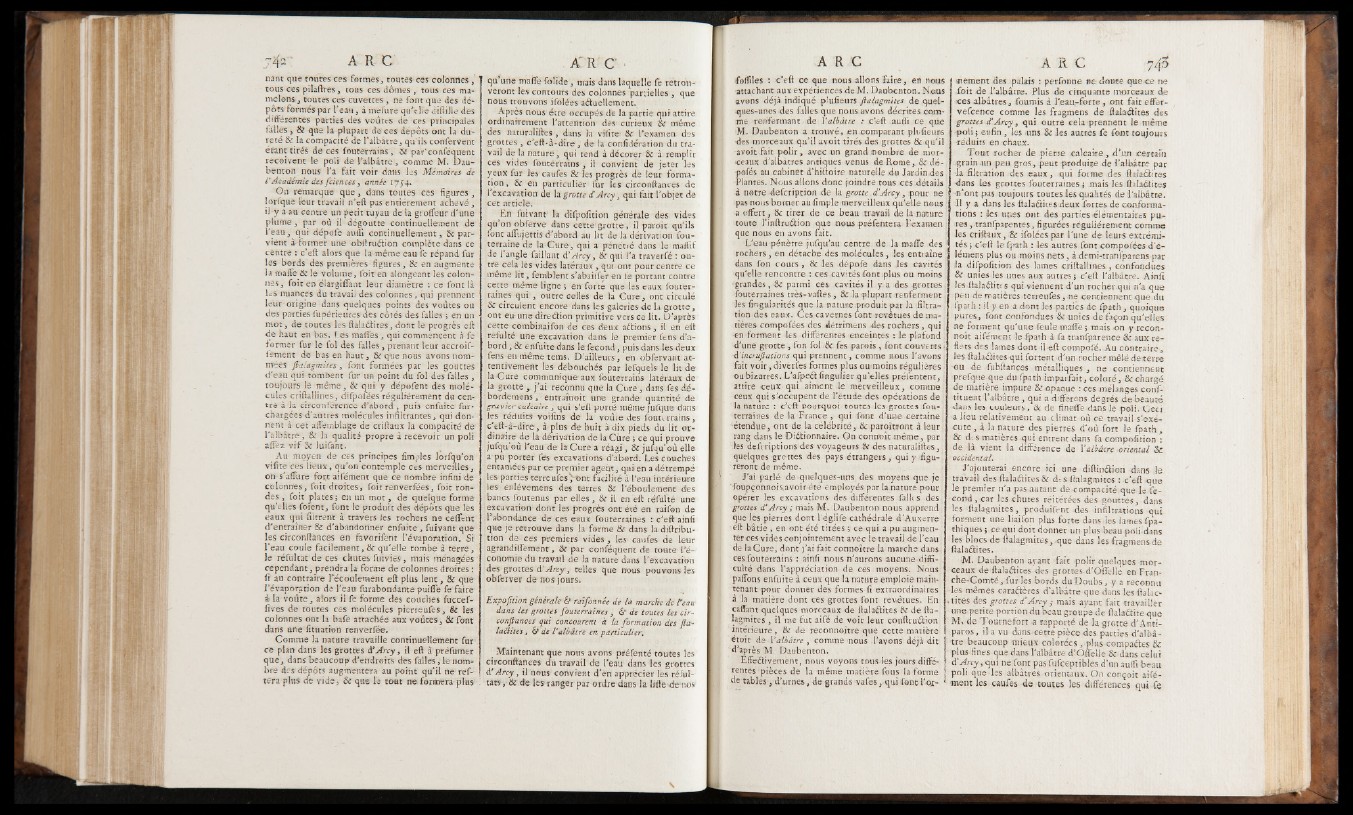
.74= ' A R C
nant que toutes ces formes , toutes ces colonnes , •
tous ces pilaftres , tous ces dômes, tous ces mamelons,
toutes ces cuvettes , ne font que des dépôts
formés par F eau, à vnefure qu'elle d-iftilfe des
différentes parties des voûtes de ces principales
fa-lles 3 & que la plupart de ces dépôts ont la dureté
& la compacité de l'albâtre, qu'ils confervent
étant tirés de ces (oufemias, 6s par'conféquent
reçoivent le poli de l'albâtre, comme M. Dau-
benton nous l’a fait voir dans les Mémoires de
1‘Académie des fciences 3 année 17J4.
On remarque que, dans toutes ces figures ,
lorfque leur travail n'eft pas entièrement achevé,
il y a au centre un petit tuyau de la groffeur d'une
plume, par où il dégoutte continuellement de
l'eau, qui dépofe aufii continuellement, & parvient
»former une obftruêtiôn complète dans ce
centre : c'eft alors que la même eau fe répand fur
les bords des premières figures, & en augmente
la ma fie & le volume, l'oit en alongeant les colonnes,
foie en éiargiffant leur diamètre : ce font là
les nuances du travail des colonnes, qui prennent
leur origine dans quelques points des voûtes ou
des parties fupérieures des côtés des folles j en an
mot, de toutes les ftalaêtites, dont le progrès eft
de haut en bas. Les mafies , qui commencent à fe
former fur lè fol des falles, prenant leur accroif-
isment de bas en haut, & que nous avons nommées
fiaUgrnitës, font formées par les gouttes
d'eau qui tombent fur un point du fol des falles ,
toujours le même, & qui y dépofent des molécules
criftallines, difpofées régulièrement du centre
à la circonférence d’abord , puis enfuite: fur-
chargées d'autres molécules infiltrantes , qui donnent
à cet affemblage de criftatix la compacité de
l'albâtre, & la qualité propre à recevoir un poli
affez v if & luifont.
Au mçyen de ces principes Amples lorfqu'on
vifite ces lieux, qu'on contemple ces merveilles,
oh s'afiure for,t aifément que ce nombre infini de
colonnes, foit droites, foit renverfées, foit rondes
, foit plates , en un mot, de quelque forme
quelles foient, font le produit des dépôts que lês
eaux qui filtrent à traversées rochers ne ceflènt
d'entraîner & d'abandonner enfuite, fuivant que
les circonfiànces en favorifent l'évaporation. Si
l’eau coule facilement, & qu'elle tombe à terre,
le réfultat de ces chutes fuivies, mais ménagées '
cependant, prendra la forme de colonnes droites :
fi au contraire l'écouîeraent eft plus lent, & que
l’évaporation de l’eau furabondante puifle fe'faire
à la voûte, alors il fe forme des couches fuccef-
fives de toutes ces molécules pierreufes, & les
colonnes ont la bafe attachée aux voûtes, & font
dans une fituatiofl renverfée.
Comme la nature travaille continuellement fur
ce plan dans les grottes d*Arcy, il eft à préfumer
que, dans beaucoup d'endroits des falles, le nom*
bre des’dépôts augmentera au point qu'il ne ref-
tera plus de vide, & que le tout ne formera plus ’
A R C' •
qu une mafîe folide, mais dans laquelle le retrouveront
les contours des colonnes partielles , que
nous trouvons ifolées actuellement.
Après nous être occupés de la partie qui attire
ordinairement l'attention des curieux 6s même
des naturaliftes , dans la viiite 6c l'examen des
grottes, c'eft-à-dire, de la considération du travail
de la nature, qui rend à décorer & à remplir
ces vides foutérrains , il convient de jeter les
yeux fur les caufes 6c les progrès de leur formation
, 6c en particulier fur les çirconftances de
1 excavation de la grotte d Arcy, qui fait l'objet de
cet article.
En fuivant- la difpofition générale des vides
qu on obferve dans cette-grotte, il paroat qu'ils
font aflujertis d'abord au ht de la dérivation fou-
terraine de la Cure, qui a pénéné dans le maffif
de l’angle Taillant d'Arcy 3 6c qui l’ a traverfé : outre
cela les vides latéraux, qui ont pour centre ce
même l i t , femblent s'abaiifer en fe portant contre
cette même ligne 5 en forte que les eaux fouxer-
raines qui , outre celles de la Cure, ont circulé
& circulent encore dans les galeries de la grotte,
ont eu-une direéfion primitive vers ce lit. D'après
cette combinaifon de ces deux actions, il en eft
réfulté une excavation dans le premier fens d'abord
, & enfuite dans le fécond, puis dansées deux
fens en même tems. D ’ailleurs , en obfervant attentivement
les débouchés par lefquels le lit de
la Cure communique aux foutérrains latéraux de
la grotte , j'ai reconnu que la C ure , dans fes dé-
bordemens, entraîuoit une grande quantité de
gravier calcaire , qui s’eft porté même jufquè dans
les réduits voifîns de la voûte des foute rrains,
à plus de huit à dix pieds du lit ordinaire
de la dérivation de la C urej ce qui prouve
jufqu’où l'eau de la Cure a réagi, & julqu’où elle
a pu porter fes excavations d'abord. Les couches
entamées par ce premier agent, qui en a détrempé
les partiesxerreufes^Ont facilité à l’eau intérieure
les enlévemens des terres & l ’ébouiement des
bancs foutenus par elles, & il en eft réfültsé une
excavation dont les progrès ont été en raifon de
l'abondance de ces eaux fouterraines : c'eft ainfi
que je retrouve dans la forme 6c dans la diftribu*
tion de ces premiers vides, caufes de leur
agrandilfement, & par conféquent de toute l’économie
du travail de la nature dans l’excavation
des grottes d‘Arey 3 telles que nous pouvons les
obferver de nos jours.
Expofition generale & raifànnee de là marche de C eau
dans les grottes fouterraines 3 & de toutes les cir-
conjlanees? qui concourent a la formation des fia-
ladites j & de l ’albâtre en particulier.
Maintenant que irons avons préfenté toutes les
circonstances du travail de l'eau dans lès grottes
d 'Arcy, il nous convient d'en apprécier les résulta
t s ,6c.ée les* ranger par ordre dans la lifte demos
A R C
ifolfdes : 'C*eft ce que nous allons Faire, en nous
attachant aux expériences .de M. Daubenton. Nous
avons déjà indiqué p'ufieurs ftalagmites de quelques
unes des falles que nous avons décrites comme
renfermant de Y albâtre : c ’eft auflî ce que
M. Daubenton a trouvé-, en comparant pli-fieuns
•des morceaux qu’il avoir tirés des grottes & qu’il
avoit fait polir, avec un grand nombre de morceaux
d’albâtres antiques venus de Rome,. & d:é-
pofés au cabinet d'hiftoire naturelle «du Jardindes
Plantes. Nous allons donc joindre tous ces détails
à notre defeription de la grotte d'Arcy, -.pour ne ^
pas nous borner au fîmple merveilleux.qu’ielle nous ;
a offert, 6c tirer de ce beau travail de la.nature ’
toute Finftr-uétion que nous pré fente r a F ex amen I
que nous en avons fait.
L'eau pénètre jufqu’au centre de la malle des ^
rochers, en détache des molécules, les entraîne;
dans fon cours, 6c les dépofe dans les cavités ;
qu'elle rencontre : ces cavités font plus ou moins .
grandes, 6c parmi ces cavités il y a des grottes
fouterraines très-vaftes , &.la plupart renferment
•les Angularités que la nature produit par la filtra- s
tion des eaux. Ces,cavernes font revêtues de ma- ;
tières compofées des détrimens des rochers, qui :
en forment les différentes enceintes : le plafond\
d’une grotte , fon fol 6c fes parois , font couverts l
à’inaufiacions qui prennent, comme nous l'avons
fait voir, divèrfes formes plus oumoins régulières
ou bizarres. L'afpeél: fingulier.quelles préfentent,
attire ceux qui aiment le merveilleux, comme
ceux qui s'occupent de l’étude des opérations de
la nature : c'eft pourquoi toutes les grottes fou-
terrâines de la France, qui font d’une certaine
étendue, ont de la célébrité, & paroïtront à leur
rang dans le Dictionnaire. On connaît même, par
les deferiptions des voyageurs 6c des naturaliftes,,
quelques grottes des pays étrangers, qui y -figureront
de même.
J’ai parlé de quelques-uns des moyens que je
foupçonnois.avoir été employés par la nature pour
opérer les excavations des différentes folks des
grottes d* Arcy ; mais M. Daubenton nous apprend
que les pierres dont l’églife cathédrale d’Auxerre
eft bâtie , en ont été tirées ; ce qui a pu augmenter
ces vides conjointement avec le travail de l’eau
de la Cure, dont j’ai fait connoître la marche dans
ces foutérrains : ainfi nous n'aurons aucune difficulté
dans l'appréciation de ces moyens. Nous
paflons enfuite à ceux que la nature emploie main-- ;
tenant pour donner des formes-fi extraordinaires
à la matière dont ces grottes font revêtues. En .
caffant quelques morceaux de ftalaClites fo de ftalagmites
, il me fut aifé de voir leur conftruCtion
intérieure, & de reconnoître que cette matière
étoit de Y albâtre , comme nous l’avons déjà dit
d'après M. Daubenton.
Effectivement, nous voyons tousses jours différentes
pièces de la même matière fous la forme
de tables, d'urnes, de grands vafes, qui font l’or- <
A R C 74^
mement des palais : perforine ne doute que ce ne
foit de l'albâtre. Plus de cinquante morceaux de
ces albâtres, fournis à l'eau-forte, ont fait effer-
vefcence comme les fragmens de ftalaCtites des
groztes d*Arcy, qui outre cela prennent le même
poli 5 enfin, les uns & les autres fe font toujours
•réduits en chaux.
Tout rocher de pierre .calcaire, d ’un certain
grain .un peu gros, peut produire de l’albâtre par
•la filtration des eaux, qui forme des ftajaéfcites
•dans fes grottes fouterraines i .mais les fhlaélites
’ -n'ont pas toujours toutes les qualités de l'albâtre.
Il y a dans les üalaétkes deux fortes de conforma-
i rions : fes unes ont des parties élémentaires pu-
; res, tranlparentes, figurées régulièrement comme
les criftaux, & ifolées par l'une de leurs extrémi-
•tés j c'eft le fpath : les autres font compofées d ’é-
lémens plus ou moins nets, àdemi-tranfparens par
;la difpofition des lames criftallines, confondues
& unies les unes aux autres j c’ eft l'albatre. Ainfi
les ffolaêlite s qui viennent d'un rocher qui n'a que
peu de matières terreules, ne contiennent que du
fparh : il y en a dont les parties de fpath, quoique
pures, font confondues & unies de façon qu'elles
ne forment qu'une feule maflej mais-on y recon-
noït aifément fe fpath à fa tranfparence & aux reflets
des lames dont ü e f t compofé. Au contraire,
les ftalaêlices qui fortent d'un rocher mêlé de terre
ou de fubftances métalliques , ne contiennent
prefque que du fpath imparfait, coloré, & chargé
de matière impure & opaque : ces mélanges conf-
tkuent l'albâtre, qui a différons degrés de beauté
dans les copieurs, & de fineffe dans le poli. Ceci
a lieu relativement au climat où ce travail s’exécute,
à la nature des pierres d'ou fort le fpath,
& d^ s matières qui entrent dans fo compofition :
de là vient la différence de Y albâtre oriental &
occidental.
J’ajouterai encore ici une diftinâion dans le
travail desihla£tites& des iialagmites : c’eft que
le premier n'a pasautant de-compacité que le fécond
, car les chutes réitérées des gouttes , dans
les -Iialagmites 5 produifent -des infiltrations qui
forment une liaifon plus forte dans des lames f^a-
thiques; ce qui doit donner unplus heau poii dans
• les blocs de ftalagmites, que dans les fragmens de
ftalaélites.
M. Daubenton ayant fait polir quelques morceaux
de ftalaéfites des grottes-d’Offeilè en Franche
Comté , fur ies bords du Doubs, y a reconnu
■ les mêmes caraélères d’albâtre que dans les fia lac-
. t-ites des grottes d’Arcy ,- mais ayant fait travailler
une petite portion du beau groupe de ftalaâite que
M, de Tournefort a rapporté de la grotte d’Anti-
paras, il a vu dans cette pièce des parties d'albâtre
beaucoup mieux colorées, plus compares &
plus fines que dans l’albâtre d’Offelle & dans celui
d'Arcy, qui ne font pas fufceptibles d’un aufii beau
poli que-les albâtres orientaux. On conçoit aifé-
•ment les caufes de toutes les différences qui fe