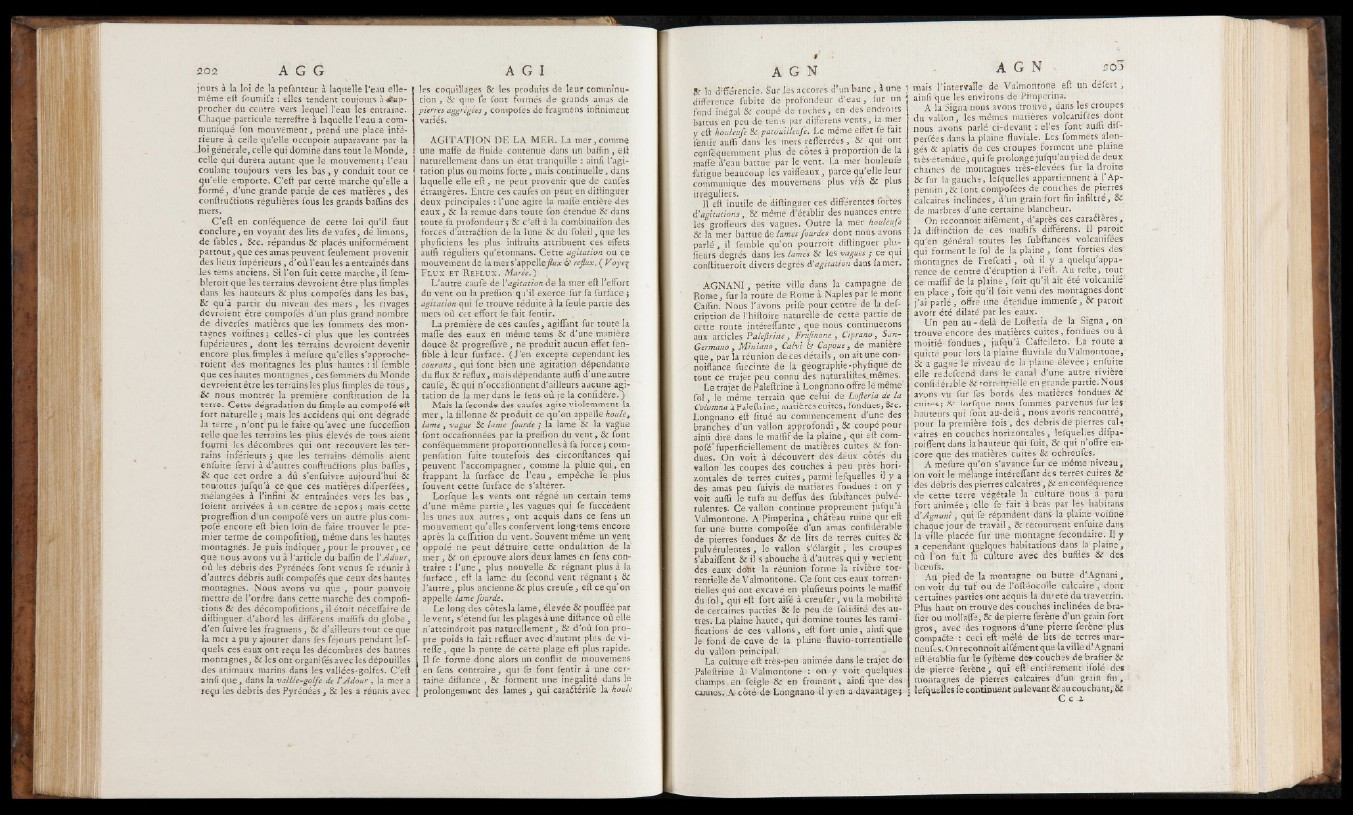
jours à la loi de la pefanteur à laquelle l'eau elle-
même eft foumifs : elles tendent toujours à Rapprocher
du centre vers lequel l’eau les entraîne. ;
Chaque particule terreftre a laquelle l'eau a com- !
mimique fon mouvement, prend une place inférieure
à celle qu’elle occupoit auparavant par la
Joi générale, celle qui domine dans tout le Monde,
celle qui durera autant que le mouvement} l'eau
coulant toujours vers les bas , y conduit tout ce
qu'elle emporte. C ’eft par cette marche qu'elle a
formé, d'une grande partie de ces matières, des
conftruétions régulières fous les grands baffins des
mers.
C ’ eft en conféquence de cette loi qu'il faut
conclure, en voyant des lits de vafes, de limons,
de fables, & c . répandus-& placés uniformément
partout, que ces amas peuvent feulement provenir
des lieux fupérieurs, d'où l'eau les a entraînés dans
les tems anciens. Si l'on fuit cette marche, il fem-
bleroit que les terrains devroient être plus fimples
dans les hauteurs & plus compofés dans les bas,
& qu a partir du niveau des mers , les rivages
devroient être compofés d’un plus grand nombre
de diverfes matières que les fommets des montagnes
voifines} celles-ci plus que les contrées
fupérieures, dont les terrains devroient devenir
encore plus.-fimpJes à mefure qu'elles s'approche-
roient des montagnes les plus hautes : il femble
que ces hautes montagnes, ces Commets du Monde
devroient être les terrains les plus fimples de tous,
& nous montrer la première conftituiion de la
terre. Cette dégradation du fimple au compofé eft
fort naturelle} mais les accidens qui ont dégradé
la terre, n'ont pu le faire qu’avec une fucceflion
telle que les terrains les plus élevés de tous aient
fourni les décombres qui ont recouvert les terrains
inférieurs 5 que les terrains démolis • aient
enfuite fervi à d'autres conftruétions plus baffes,
& que cet ordre a dû s'enfuivre aujourd'hui 8c
toujours jufqû’à ce que ces matières difperfées,
mélangées à l'infini & entraînées vers les bas ,
foient arrivées à un centre de leposj mais cette
progreffion d un compofé vers un autre plus compofé
encore eft bien loin de faire trouver le premier
terme de compofitioq, même dans les hautes
montagnés. Je puis indiquer, pour Je prouver, ce
que nous ayons vu à l’article du baffin de Y Ado ur,
où les débris des Pyrénées font venus fe réunir à
d’autres débris auflî compofés que ceux des hautes
montagnes. Nous avons vu que , pour pouvoir
mettre de l’ordre dans cette marche des compofi-
tions-& des décompofitions, il étoit néceffaire de
diftinguer d'abord les différens maflifs du globe,
d’en fuivre les fragmens, & d’ ailleurs tout ce que
la mer a pu y ajourer dans fes féjours pendant lef-
quels ces eaux ont reçu les décombres des hautes
montagnes, &' les ont organifés avec les dépouilles
des animaux marins dans les vallées-golfes. C ’ eft
ainfi que, dans la vallée-golfe de VAdour, la mer a
reçu les débris des Pyrénées, & les a réunis avec
les coquillages & les produits de leur comminu-
tion , & que fe font formés de grands amas de
pierres aggrégées, compofés de fragmens infiniment
variés.
AGITATION DE LA MER. La mer,comme
une maffe de fluide contenue dans un baffin, eft
naturellement dans un état tranquille : ainfi l’agitation
plus ou moins forte, mais continuelle, dans
laquelle elle eft, ne peut provenir que de caufes
étrangères. Entre ces caufes on peut en diftinguer
deux principales : l’ une agite la maffe entière des
eaux, & la remue dans toute fon étendue & dans
toute fa profondeur 5 & c’eft à la combinaifon des
forces d’attraélion de la lune & du foleil,que les
phyficiens les plus inftruits attribuent ces effets
auffi réguliers qu’étonnans. Cette agitation ou çe
mouvement de la mer s'appelle^?«# & reflux. ( Voye%
F l u x et Reflux. Marée.) ,
L'autre caufe de Y agitation de la mer eft l'effort
du vent ou la preffion qu’il exerce fur fa furface ;
agitation qui fe trouve réduite à la feule partie des
mers où cet effort fe fait fentir.
La première de ces caufes, agiffant fur toute la
maffe des eaux en même tems & d’ une manière
douce 8c progreflive, ne produit aucun effet fen-
fible à leur furface. (J'en excepte cependant les
courans, qui font bien une agitation dépendante
du flux & reflux, mais dépendante auffi d’uneautre
caufe, &qui n’occafionnent d’ ailleurs aucune agitation
de la mer dans le fens où je la confidère.)
Mais la fécondé des caufes agite violemment la
mer, la fillonne & produit ce qu’on appelle houle,
lame, vague & lame fourde ; la lame 8c la vague
font occafionnées par la preffion du vent, & font
conféquemment proportionnelles à fa force} com-
penfation faite toutefois des circonftances qui
peuvent l’accompagner, comme la pluie qui, en
frappant la furface de l’eau, empêche le plus
fouvent cette furface de s’altérer.
Lorfque les vents ont régné un certain tems
d’une même partie, les vagues qui fe fuccèdent
Iss unes aux autres, ont acquis dans ce fens un
mouvement qu’elles confervent long-tems encore
après la ctffation du vent. Souvent même un vpnt
oppofé ne peut détruire cette ondulation de la
mer, & on éprouve alors deux lames en fens contraire
: l’une, plus nouvelle & régnant plus à la
furface, eft la lame du fécond vent régnant 5 &
l ’autre, plus ancienne &plus creufe, eft ce qu’on
appelle lame fourde.
Le long des côtes la lame, élevée & pouffée par
le vent, s’étend fur les plages à une diftance où elle
n’atteindroit pas naturellement, & d'où fon propre
poids ia fait refluer avec d’autant plus de vi-
teffe, que la pente de cette plage eft plus rapide.
Il fe forme donc alors un conflit de mouvemens
en fens contraire, qui fe font fentir à une certaine
diftance, & forment une inégalité dans le
prolongement des lames , qui caraétérife la houle
8i la différencie. Sur les accores d'un banc, à une ]
différence fubite de profondeur d’ eau, fur un 1
fond inégal 8c coupé de roches, en des endroits
battus en peu de tems par différens vents, la mer
y eft houleufe 8c,patouilleufe. Le même effet fe fait
lèniir auffi dans les mers refferrées, 8c qui ont
conféquemment plus de côtes à proportion de la
maffe d’eau battue par le vent. La mer houleufe
fatigue beaucoup les vaiffeaux, parce qu'elle leur
communique des mouvemens plus vifs & plus
irréguliers. - ’
Il eft inutile de diftinguer ces differentes fortes
à’agitations, & même d’établir des nuances entre
les groffeurs des vagues. Outre la mer houleufe j
& la mer battue de lames fourdes dont nous avons
parlé, .il femble qu'on pourroit diftinguer plu-
fieurs degrés dans les lamés 8c les v a g u e s ce qui
conftitueroit divers degrés d'agitation dans la mer.
A G N AN I, petite ville dans la campagne de
Rome, fur la route de Rome à Naples par le mont j
Caffin. Nous l’ avons prife pour centre de la def-
cription de l’hiftoire naturelle de cette partie de
cette route intéreffante, que nous continuerons
aux articles Paleftrine, Fruftnone , Ciprano, San-
Germano, Miniano, Calvi 6* Capoue, de maniéré
que, par la réunion de ces détails, on ait une con-
noiflance fuccinte de la géographie-phyfique de
tout ce trajet peu connu des.n^turaliftes„mernes.
Le trajet de Paleftrine à Longnano offre le même-
fo l , le même terrain que celui de Lofteria de la
Colomna à Paleftrine, matières cuites, fondues, &c.
Longnano eft fitué au commencement d’une des
branches d’un vallon approfondi, & coupé pour
ainfi dire dans le maffifde la plaine, qui eft compofé'
fuperficiellement de matières cuites^& fondues.
On voit à découvert des deux cotes du
vallon les coupes des couches à peu près horizontales
de terres cuites, parmi lefquelles il y a
des amas peu fuivis. de matières fondues : on y
voit auffi le tufa au deffus des fubftances pulvérulentes.
Ge vallon continue proprement jufqu’à
Valmontone. A Pimperina , château ruiné qui eft j
fur une butte compofée d’un amas confidérable
de pierres fondues 8c de lits de terres cuites &
pulvérulentes, le vallon s’élargit, les croupes |
s’abaiffent & il s’abouche à d’autres qui y verlent
des eaux défit la réunion forme la rivière' torrentielle
de Valmontone. Ce font ces eaux torren- ,
tielles qui ont excavé en plufieurs points le maffif l
du fol, qui eft fort aifé à creufer, vu la mobilité
de certaines parties 8c le peu de folidité des autres.
La plaine haute, qui domine toutes les ramifications
de ces vallons, eft fort unie, ainfi que
le-fond de cuve de la plaine fluvio-torrentielle
du vallon principal.
La culture eft très-peu animée dans le trajet de
Paleftrine à; Valmontone - : on> y voit quelques
champs , en feigle 8c en froment $ ainfi que des
cannes. À- côté de- Longnano -il<y- en a davantagej •
mais l’ intervalle de Valmontone eft un d é fe r t,
ainfi que les environs de Pimperina.
A la Signa nous avons trouvé, dans les croupes
! du vallon, les mêmes matières volcanifées dont
! nous avons parlé ci-devant : el-es font auffi dil-
perfées dans la plaine fluviale. Les fommets alon-
i gés & aplatis de ces croupes forment une plaine
| tiès-étendue, qui fe prolonge jufqu’au pied de deux
chaînes de montagnes très-élevées fur la droite
\ & fur la gauche, lefquelles appartiennent à l’Ap-
\ pennin , 8c font compofées de couches de pierres
calcaires inclinées, d’un grain fort fin infiltre, 8c
j de marbres d’ une certaine blancheur.
On reconnoît aifément, d’après ces cara&ères,
, la diftin&ion de ces maffifs différens. Il paroît
\ qu’en général toutes les fubftances volcanifées
qui forment le fol de la plaine, font forties des
montagnes dé Frefcàti, où fl y a quelqu appa-
: rence de centre d’éruption à l’ett. Au refte, tout
ce maffif de la plaine, foit qu’ il ait été volcanifé1
en place , foit qu’il foit venu des montagnes dont
j’ai parlé, offre une étendue immenfe, & paroît
avoir été dilaté par les eaux.
Un peu au-delà de Lofteria de la Signa, on
trouve encore des matières cuites, fondues ou à
moitié fondues, jufqu'à Cafteileto. La route a
quitté pour lors la plaine fluviale du Valmontone,-
& a gagné le niveau de la plaine élevée j enfuite
elle redefeend dans le canal d’une autre rivière
confidérable 8c torrentielle en grande partie. Nous
avons vu fur fes bords des matières fondues 8c
cuites} 8c lorfque nous fommès parvenus fur les
hauteurs qui font au-delà, nous avorîs rencontré,
pour la première fois, des débris dë pierres cal«
raires en couches horizontales, lefquelles difpa-
roiffentdans la hauteur qui fuit, & qui n’offre encore
que des matières cuites & ochreufes.
A mefure qu’on s’avance fur ce même niveau,
on voit le mélange intéreffant des terres cuites &
des débris des pierres calcaires , |& en conféquence
de cette terre végétale la culture nous a paru
! fort animée} elle fe fait à bras par lés habitans
d’Agnani 3 qui fe répandent dans la plaine voifine
chaque jour de travail, & retournent enfuiredans
la ville placée fur une montagne fecondaire. Il y
a cependant quelques habitations dans la plaine ,
où l’on fait la culture avec dès' buffles 8c des
boeufs.
Au pied de la montagne ou butte d'Agnani,
on voit du tuf ou dé l’oftéocolle calcaire ^ dont
certaines parties ont acquis la dureté du travertin.
Plus haut on trouve des couches inclinées de-bra-
fier ou mollaffe, & de pierre ferène d’un grain fort
gros, avec des rognons d'une- pierre ferène plus
compacte : ceci eft mêlé de lits de terres mar-
neufes. On reconnoît aifément que ia ville d’ Agnani
eft établie fur le fyftème dê» couches-de brafîer &
de pierre ferène, qui eft‘entièrement'ifolé des
montagnes de pierres calcaires d'un grain fin,
lefquelles fe continuent au levant & au couchant, 8c