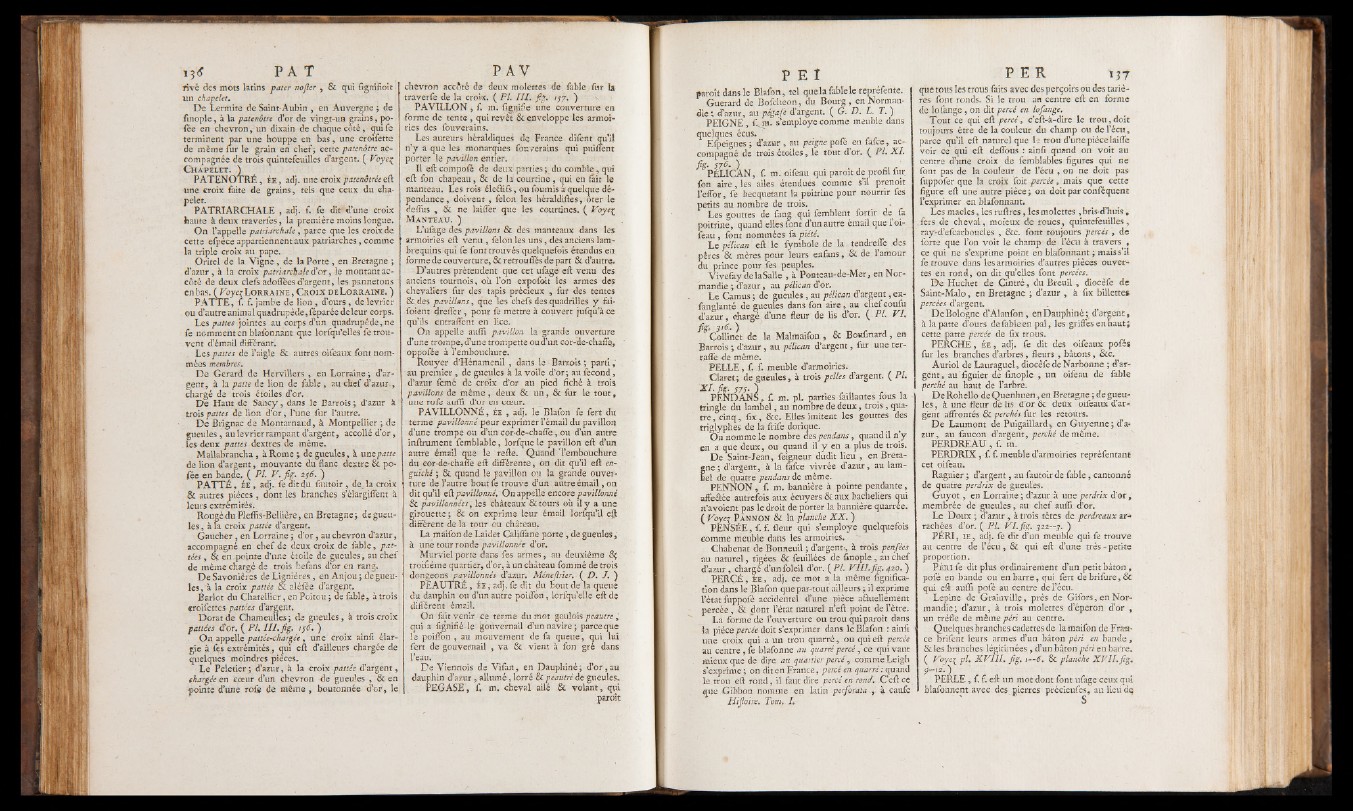
13* P A T
rivé des mots latins pater nofier , & qui fignifioit
un chapelet.
De Lermite de Saint-Aubin , en Auvergne ; de
finople, à la patenôtre d’or de vingt-un grains, po-
fée en chevron, un dixain de chaque coté, qui fe
terminent par une houppe en bas, une croifette
de même mr le grain en chef ; cette patenôtre accompagnée
de trois quintefeuilles d’argent., ( Voyeç Chapelet. )
PATENOTRÉ, ÉE, ad), une croix patenôtrée eft
une croix faite de grains, tels que ceux du chapelet.
PATRIARCHALE , adj. f. fe dir'd’üne croix
haute à deux traverfes, la première moins longue.
On l’appelle patriorchale, parce que les, croix de
cette efpèce appartiennent aux patriarches, comme
la triple croix au pape.
Oritel de la Vigne , de la Porte , en Bretagne ;
d’azur , à la croix patnarchale d’o r , le montant accoté
de deux clefs adoffées d’argent, les pannetons
en bas. ( Voye^ Lorraine , Croix de Lorraine. )
P A T T E , f. f. jambe de lion , d’ours , de levrier
ou d’autre animal quadrupède, féparée de leur corps.
Les pattes jointes au corps d’un quadrupède, ne
fe nomment en blafonnant que lorfqu’elles retrouvent
d’émail différent.
Les pattes de l’aigle & autres oifeaux font nommées
membres.
De Gérard de Hervillers , en Lorraine ; d’argent,
à la patte de lion de fable, au chef d’azur ,
chargé de trois étoiles d’or.
De Haut de Sançy, dans le Barrois ; d’azur à
trois pattes de lion d’or , l’une fur l’autre.
De Brignac de Montarnaud, à Montpellier ; de
gueules, au levrier rampant d’argent, accollé d’o r ,
les deux pattes dextres de même.
Mallabrancha , à Rome ; de gueules, à une patte
de lion d’argent, mouvante du flanc dextrç & po-
fée en bande, ( PL V. fig. a$6. )
P A T T É , ÉE, ad), feaitdu fautoir, de. la croix
& autres pièces , dont les branches s’élargiffent à
leurs extrémités*
RougéduPleflis-Belliére, en Bretagne; de gueules
, à la croix pattée d’argent.
Gaucher, en Lorraine ; d’o r , au chevron d’azur,
accompagné en chef de deux croix de fable, pat-
tées , oç en pointe d’une étoile de gueules, au chef
de même chargé de trois befans d’or en rang*
DeSavonières de Lignières, en Anjou ; de gueules,
à la croix pattée & aléfée d’argent,
Barlot du Chatellier, en Poitou ; de fablé, à trois,
froifettes pattees d’argent.
Dorât de Chameulles; de gueules, à trois croix
pattees d’or. ( PL III. fig. ifâ. )
On appelle pattée-chargée, une Croix ainfi élargie
à fes extrémités, qui eft d’ailleurs chargée de
quelques moindres pièces.
Le Peletier ; d’azur, à la croix pattée d’argent,
chargée en coeur d’un chevron de gueules , & en
pointe d’une rofe de même , boutonnée d’or , le
P AV
chevron accôté de deux molettes de fable, fur ta
traverfe de la croix. ( Pl. HL fig. ifÿ. ) '
PA V IL LO N , f* m. lignifie une couverture en
forme de tente , qui revêt & enveloppe les armoiries
des fouverains.
Les auteurs héraldiques de France difent qu’il
n’y a que les monarques fouverains qui puiffent
porter le pavillon entier.
Il eft compofé de deux parties ; du comble, qui
eft fon chapeau, & de la courtine, qui en fait le
manteau. Les rois éleélifs, ou fournis à quelque dépendance,
doivent , félon les héraldiftes, oter le
deftiis , & ne laiffer que les courtines. ( Voye^
Manteau. )
L’ufage des pavillons & des manteaux dans les
armoiries eft venu , félon les uns, des anciens lambrequins
qui fe font trouvés quelquefois étendus en
forme de couverture, & retrou ffés de part & d’autre.
D’autres prétendent que cet ufage eft venu des
anciens tournois, où l’on expofoit les armes des
chevaliers fur des tapis précieux , fur des tentes
&des p a v illon s , que les chefs des quadrilles y fki-
foient dreffer, pour fe mettre à couvert jufqu’à ce
qu’ils entraffent en lice.
On appelle aufïi pavillon la grande ouverture
d’une trompe, d’une trompette ou d’un cor-de-chaffe,
oppofée à l’embouchure.
Koùyer d’Hénamenil, dans le - Barrois ; parti ,-
au premier , de gueules à la voile d’or; au fécond,
d’azur femé de croix d’or au pied fiché à trois
pavillons de même, deux & un, & fur le tout,
une rofe aufïi d’or en coeur.
PAVILLONNÉ, ée , ad), le Blafon fe fert du
terme pavillonné pour exprimer l’émail du pavillon
d’une trompe ou d’un cor-de-chaffe, ou d’un autre
infiniment femblable, lorfque le pavillon eft d’un
autre émail que le refte. Quand Tembouchure
du eor-de-chafTe eft différente, on dit qu’il eft en-
guiché ; & quand le pavillon ou la grande ouverture
de l’autre bout fe trouve d’un autre émail, on
dit qu’il eft pavillonné. On appelle encore pavillonné
& pavillonnées, les châteaux & tours où il y a une
girouette; & on exprime leur émail lorsqu’il eft
différent de la tour ou château.
La mâifon de Laidet Califfane porte, de gueules
à une tour ronde pavillonnér d’or.
Murviel porte dans fes armes, au deuxième 8ç
troifième quartier, d’or, à un château fommé de trois
dongeons pavillonnés d’azur. Méneflrier. ( D. J. }
PEAUTRÉ, ÉE ,■ adj, fe dit du bout de la queue
du dauphin ou d’un autre poiffon, lorfqu’elle eft de
différent émail. :
On fait venir ce terme du mot gaulois peautre ,
qui a fignifié le gouvernail d’un navire; parce que
le poiffon , au mouvement de fa queue, qui lui
fert de gouvernail , va & vient à fon gre dans
l’eau.
De Viennois de Vifan, en Dauphiné ; d’o r , au
dauphin d’azur , allumé, lorré & peautré de gueules.
PEGASE, f. m. cheval ailé & volant, qui
.paroît
P E l
paraît dans le Blafon, tel que la fable le repréfente.
Guetard de Bofcheon, du Bourg, en Normandie;
d’azur, au d’argent. ( G. D. L. T1. )
PEIGNË, f. m. s’employe comme meuble dans
quelques écus.
Éfpeignes ; d’azur , ail peigne pofé en fafee, accompagné
de trois étoiles, le tout dor. ( P l . XI.
fig . 5 76 . )
PÉLICAN, f. m. oifeau qui paroît de profil fur
fon aire, les ailes étendues comme s’il prenoit
l’eflor, fe becquetant la poitrine pour nourrir fes
petits au nombre de trois. - |
Les gouttes de fang qui femblent fortir de^ fa
poitrine, quand elles font d’un autre email que 1 oifeau
, font nommées fa piété.
Le pélican eft le fymbole de la tendreffe des
pères & mères pour leurs enfans, & de l’amour
du prince pour fes peuples.
Vivefay delaSalle , à Ponteau-de-Mer, en Normandie
; d’azur, au pélican d’or.
Le Camus; de gueules , au pélican d’argent ,en-
fanglanté de gueules dans fon aire, au chef coufu
d’azur, chargé d’une fleur de lis d’or. ( PL VL
fig , qtH).. )
Collinet de la Malmaifon , & Boufinard, en
Barrois ; d’azur, au pélican d’argent, fur une ter-
raffe de même.
PELLE, f, f. meuble d’armoiries.
Glaret; de gueules, à trois pelles d’argent. ( PL
XI. fig. $ 7 ƒ. )
PEND A N S , f. m. pl. parties faillantes fous la
tringle du lambel, au nombre de deux, trois , quatre
, cinq, fix , &c. Elles imitent les gouttes des
triglyphes de la frife dorique. r3
On nomme le nombre des pendans, quand il n’y
en a que deux, ou quand il y en a. plus de trois.
De Saint-Jean, feigneur dudit lieu , en Bretagne;
d’argent, à la fafee vivrée d’azur, au lam-
bel de quatre pendans de même.
PENNON, f. m. bannière à pointe pendante,
affeâée autrefois aux écuyers & aux bacheliers qui
n’avoient pas le droit de porter la bannière quarrèe.
( Voyez. P A N N O N & la planche X X . )
PENSÉE, f .f . fleur qui s’employe quelquefois
comme meuble dans les armoiries. ~
Chabenat de Bonneuil ; d’argent», à trois penféés
au naturel, tigées & feuillées de finople, au chef
d’azur , chargé d’un foleil d’or. ( Pl. VIII.fig. 420. )
PERCÉ, ée, ad)., ce mot a la même Lignification
dans le Blafon que par-tout ailleurs .; il exprime
l’état fuppofé accidentel d’une pièce a&uellement
percée, & dont l’état naturel n’eft point de l’être.
La forme'de l’ouverture ou trou qui paroît dans
la pièce percée doit s’exprimer dans le Blafon : ainfi
une croix qui a un trou quarré, ou qui eft percée
au centre ,1e blalfonne au quarré percé, ce qui vaut
mieux que de dije au quartier percé, comme Leigh
s’exprime ; on dit en France, percé en quarré : quand
le trou eft rond, il faut dire percé en rond. C’eft ce
que Gibbon nomme en latin perforata , à caufe
Hifioire. Tom. I.
P ER 137
que tous les trous faits avec des perçoirs ou des tarières
font ronds. Si le trou an centre eft en forme
de lo fange, on dit percé en lofange.
Tout ce qui eft percé, c’eft-à-dire le trou,doit
toujours être de la couleur du champ ou de l’écu,
parce qu’il eft naturel que le trou d’une pièce laiflê
voir ce qui eft deffous : ainfi quand on voit au
centre d’une croix de femblables figures qui ne
font pas de la couleur de l’éeu , on ne doit pas
fuppofer que la croix foit >percée, mais que cette
figure eft une autre pièce ; on doit par conféquent
l’exprimer en blafonnant.
Les macles, les ruftres, les molettes ,bris-d’huis,
.fers de cheval, moïeux de roues, quintefeuilles,
ray-d’efcarboucles , &c. font toujours percés , de
forte que l’on voit le champ de récu à travers ,
ce qui ne s’exprime point en blafonnant ; mais s’il
fe trouve dans les armoiries d’autres pièces ouvertes
en rond, on dit qu’elles font percées.
De Huchet de Cintré, du Breuil , diocèfe de
Saint-Malo, en Bretagne ; d’azur , à fix billettes
percées d’argent.
De Bologne d’A lanfon, en Dauphiné d’argent,
à la patte d’ours de fable en pal, les griffes en haut;
cette patte percée de fix trous.
PERCHE, é e , adj. fe dit des oifeaux pofé$
fur les branches d’arbres, fleurs , bâtons, &c.
Auriol de Lauraguel, diocèfe de Narbonne ; d’argent,
au figuier de finople , un oifeau de fable
perché au haut de l’arbre.
De Rohello deQuenhuen, en Bretagne ; de gueules
, à une fleur de lis d’or & deûx oifeaux d’argent
affrontés & perchés {\iir les retours.
De Laumont de Puigaillard-, en Guyenne; d’azur,
au faucon d’argent, perché de même.
PERDREAU, f. m.
PERDRIX ,-f. f. meuble d’armoiries repréfentant
cet oifeau.
Raguier ; d’argent, au fautoir de fable, cantonné
de quatre perdrix de gueules.
G u y o t, en Lorraine ; d’azur à une perdrix d’o r ,
membrée de gueules, au chef aufli d’or.
Le Doux ; a’azur , à trois têtes de perdreaux ar*
rachées d’or. ( PL VI. fig. 32SL--3. )
PÉRI, ie , adj. fe dit d’un meuble qui fe trouve
au centre de l’écu, & qui eft d’une très - petite
proportion. Péri fe dit plus ordinairement d’un petit bâton ,
pofé en bande ou en barre, qui fert de brifure, &
qui eft aufli pofé au centre de l’écu.
Lepine de Grainville, près de Gifors, en Normandie;
d’azur, à trois molettes d’éperon d’or ,
un trèfle de même péri au centre.
Quelques branches cadettes de la maifon de France
brifent leurs armes d’un bâton péri en bande ,
&les branches légitimées , d’un bâton péri en barre.
( Voye£ pl. X V III. fig. 1—6. & planche XVII. fig, HH HH PERLE, f. r. eft un mot dont font ufage ceux qui
blafonnent avec des pierres précieufes, au lieu dq