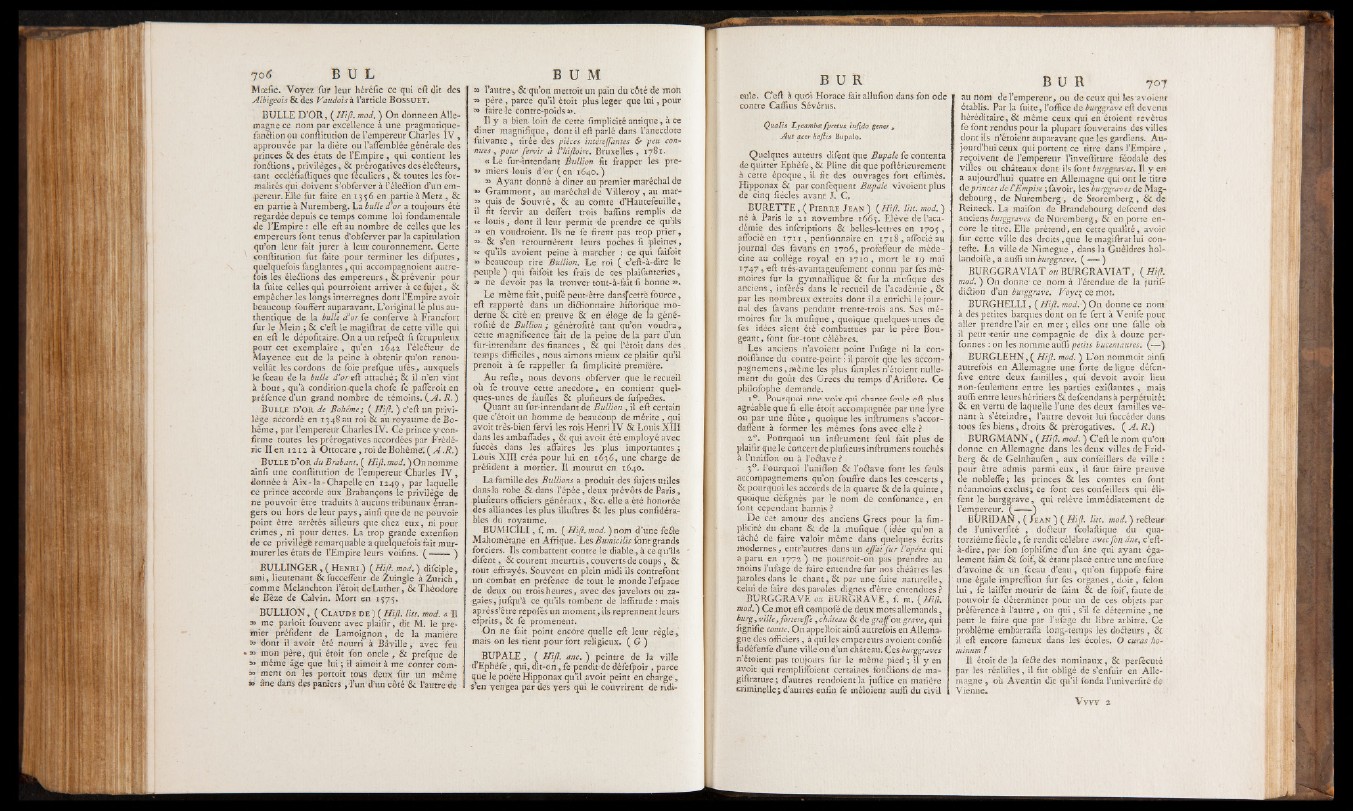
yo6 B U L
Moefie. Voyez fur leur héréfie ce qui eft dit des
Albigeois & des Vaudois à l’article Bossuet.
BULLE D ’O R , {Hiß. mod. ) On donneen Allemagne
ce nom par excellence à une pragmatique-
fanaion ou conftitution de l’empereur Charles I V ,
approuvée par la diète ou l’aflemblée générale des
princes 8c des états de l’Empire, qui contient les
fondions, privilèges, & prérogatives des électeurs,
tant eccléfiaftiques que féculiers, & toutes les formalités
qui doivent s’obferver à l’éle&ion d’un empereur.
Elle fut faite en 1356 en partie à Metz , 8c
en partie à Nuremberg. La bulle d'or a toujours été
regardée depuis ce temps comme loi fondamentale
de l ’Empire : elle eft au nombre de celles que les
empereurs font tenus d’obferver par la capitulation
qu’on leur fait jurer à leur couronnement. Cette
conftitution fut faite pour terminer les difputes,
quelquefois faoglantes, qui accompagnoient autrefois
les éle&ions des empereurs, & prévenir pour
la fuite celles qui pourroient arriver à ce fujet, &
empêcher les longs interrègnes dont l’Empire avoit
beaucoup fouffert auparavant. L’original le plus authentique
de la bulle d’or fe conferve à Francfort,
fur le Mein ; & c’eft le magiftrat de cette ville qui
en eft le dépofitaire. .On a un refpeél fi fcrupuleux
pour cet exemplaire , qu’en 1642 Féle&eur de
Mayence eut de la peine à obtenir qu’on renou-
vellât k s cordons de foie prefque ufés, auxquels
Je fceau de la bulle d’or eft attaché ; 8c il n’eri vint
à bout, qu’à condition que la chofe fe .pafferoit en
préfence d’un grand nombre de témoins. ( A . R. ) Bulle d’or de Bohême; ( Hiß. ) c’eft un privilège
accordé en 1348 au roi & au royaume de Bohême
, par l’empereur Charles IV. Ce prince y confirme
toutes les prérogatives accordées par Frédéric
II en i 2 12 à Ottocare , roi de Bohêmel ( A .R .) Bulle-d’or du Brabant. { Hifl.mod. ) On nomme
ainfi une conftitution de l’empereur Charles TV,,
donnée à Àix - la - Chapelle en 1249, Par laquelle
ce prince accorde aux Brabançons le privilège de
fie pouvoir être traduits à aucuns tribunaux étrangers
ou hors de leur pays, ainfi que de ne pouvoir
point être arrêtés ailleurs que chez eux, ni pour
crimes , ni pour dettes. La trop grande extenfion
de ce privilège remarquable a quelquefois fait murmurer
les états de l’Empire leurs voifins. ( ------ )
BULLINGER, ( Henri) ( Hifl.mod.) difçiple,
ami, lieutenant & fucceffeur de Zuingle à Zurich,
comme Melanchton l’étoit de Luther, & Théodore
de Bêze de Calvin. Mort en 1575.
BULLION, ( Claude de ) ( Hiß. litt. mod. « Il
» me. partait fouvent avec plaifir, dit M. le premier
préfident de Lamoignon, de la manière
&> dont il avoit été nourri à Bâville, avec feu
» mon père, qui étoit fon oncle, & prefque de
»> même âge que lui ; il aimoit à me conter com-
» ment on les portoit tous deux fur un même
» âne dans des paniers , Tun d’un côté & l’autre de
B U M
» l’autre > & qu’on mettoit un pain du côté de mon
» père, parce qu’il étoit plus leger que lu i, pour
» faire le contre-poids».
Il y a bien loin de xette fimplicité antique, à ce
dîner magnifique, dont il e.ft parlé dans l’anecdote
fuivante, tirée des pièces intèreffantes & peu connues
, pour fervir à i ’hifoire. Bruxelles , 1781.
« Le fur-intendant Bullion fit frapper les pre-
» miers louis d’or (en 1640.)
» Ayant donné à dîner au premier maréchal de
« Grammont, au maréchal de Villeroy, au maf-
» quis de Souvré, & au comte d’Hautefeuille,
il fit fervir au deffert trois baflins remplis de
<c louis, dont il leur permit de prendre ce qu’ils
» en voudroient. Ils ne fe firent pas trop prier,
» 8c s’en retournèrent leurs poches fi -pleines,
« qu’ils avoient peine à marcher : ce qui faifoit
» beaucoup rire Bullion. Le roi ( c’eft-à-dire le
peuple ) qui faifoit lès frais de ces plaifanteries,
» ne devoir pas la trouver tont-à-fait fi bonne ».
Le même fait, puifé peut-être dansfcettè fource,
eft rapporté dans un diftionnaire hiftorique moderne
8c cité en preuve & en éloge de îa géné-
rofitê de Bullion ; générofité tant qu’on voudra,
cette magnificence fait de la peine de la part d’uh
fur-intendant des finances , 8c qui l’étoit dans des
temps difficiles, nous aimons mieux ce plaifir qu’il
prenoit à fie rappéller fa fimplicité première.
Au refte, nous devons obferver que le recueil
où fe trouve cette anecdote, en contient quelques
unes de fauffes 8c plufieurs de fufpeâes.
Quant au fur-intendant de Bullion, il eft certain
que c’étoit un homme de beaucoup de mérite , qui
avoit très-bien fervi les rois Henri IV 8c Louis XIII
dans les ambaffades , 8c qui avoit été employé avec
fuccès dans les affaires les plus importantes ;
Louis XIII créa pour lui en 1636, une charge de
préfident à mortier. Il mourut en 1640.
La famille des Bullions a produit des fujets utiles
dansla robe 8c dans l’épée, deux prévôts de Paris ,
plufieurs officiers généraux, 8cc. elle a été honorée
des alliances les plus illuftres 8c les plus confidéra-
bles du royatime.
BUMICILI, f. m. { Hifl. mod. ) nom d’une feéîe
Mahométgne en Afrique. hesBumicilïs fontgrands
forciers. Ils combattent contre le diable, à ce qu’ils
difont, 8c courent meurtris, couverts de coups, 8c
tout effrayés. Souvent en plein midi ils contrefont
un combat en préfence de tout le monde l’efpace
de deux ou trois heures, avec des javelots ou za-
gaies, jufqu’à ce qu’ils tombent de laflitude : mais
après s’être repofés un moment , ils reprennent leurs
efprits, 8c fe promènent.
On ne fait point encore quelle eft leur règle »
mais on les tient pour fort religieux. ( G )
' BUPALE, ( Hifl. anc. ) peintre de îa ville
d’Ephëfe, qui, dit-on, fè pendit de défefpoir, parce
que le poète Hipponax qu’il avoit peint en charge »
■ skn vengea par des vers qûi le couvrirent de ridicule.
C’eft à quoi Horace fait allufion dans fon ode
contre Caffius Sévérus.
Q u a lis Lycamboe fpretus infldo gener ,
A u t acer hoftis Bupalo.
Quelques auteurs difent que Bupale fe contenta
de quitter Ephèfe, 8c Pline dit que poftérieurement
à cette époque, il fit des ouvrages fort eftimés.
Hipponax 8c par conféquent Bupale vivoient plus
de cinq fiècles avant J. C,
BURETTE, ( Pierre Je a n ) {Hifl. litt, mod.')
né à Paris le 21 novembre 1665. Elève de l’académie
des infcriptions 8c belles-lettres en 1705 ,
affocié en 1 7 1 1 , penfionnaire en 1718 , affocié au
journal des favans en 1706, profeffeur de médecine
au collège royal en 1710, mort le 19 mai
1747, eft très-avantageufoment connu par fes mémoires
fur la gymnaftique 8c fur la mufique des
anciens , inférés dans le recueil de l’académie , 8c
par les nombreux extraits dont il a enrichi le journal
des favans pendant trente-trois ans. Ses mémoires
fur la mufique, quoique quelques-unes de
fes idées aient été combattues par le père Bougeant,
font fur-tout célèbres.
Les anciens n’avoient point l’ufage ni la con-
noiffance du contre-point : il paroît que les accom-
pagnemens, même les plus fimples n’étoient nullement
du goût des Grecs du temps d’Ariftote. Ce
philofophe demande.
1 ®. Pourquoi une voix qui chante feule eft plus
agréable que fi elle étoit accompagnée par une lyre
ou par une flûte, quoique les inftrumens s’accor-
daflemt à former les mêmes fons avec elle ?
2°. Pourquoi un inftrument feul fait plus de
plaifir que le concert de plufieurs inftrumens touchés
à l’uniffon ou à Foéfave ?
- 30. Pourquoi l’unifïon 8c Foéfave font les feuls
accompagnemens qu’on fouffre dans les concerts,
8c pourquoi les accords de la quarte 8c de la quinte,
quoique défignés par le nom de confonance, en
font cependant bannis ?
De cet amour des anciens Grecs pour la fim-
plieité du chant 8c de la mufique (idée qu’on a
tâché de faire valoir même dans quelques écrits
modernes, entr’autres dans un ejfai fur l ’opéra qui
a paru en 1772 ) ne pourroit-on pas prendre au
moins l’ufage de faire entendre fur nos théâtres les
paroles dans le chant, 8c par une fuite naturelle,
'celui de faire des paroles dignes d’être entendues ?
BURGGRAVE ou BUR&RAVE, f. m. ( Hiß.
mod.) Ce mot eft compofé de deux mots allemands ?
burgyville 3 farterejfe, château 8c de graff ou graves qui
fignifie comte. On appelloit ainfi autrefois en Allemagne
des officiers, à qui les empereurs avoient confié
ladéfenfe d’une ville ou d’un château. Ces burggraves
n’étoient pas toujours fur le même pied ; il y en
avoit qui rempliffoient certaines fondions de ma-
giftrature; d’autres rendoientla juftice en matière
criminelle; d’autres enfin fe mêloient aufli du civil
D U A 707
; au nom de l’empereur, ou de ceux qui les avoient
établis. Par la fuite, l’office de burggraveeft devenu
héréditaire, 8c même ceux qui en étoient revêtus
fe font rendus pour la plupart fouverains des villes
dont ils n’étoient auparavant que les gardiens. Au~
| jourd’hui ceux qui portent ce titre dans l’Empire ,
reçoivent de l’empereur l’inveftiture féodale des
villes ou châteaux dont ils font burggraves. Il y en
a aujourd’hui quatre en Allemagne qui ont le titre
de princes de l’Empire ; favoir, les burggraves de Mag-*
debourg, de Nuremberg, de Storemberg , 8c de
Reineck. La maifon de Brandebourg defcend des
anciens burggraves de Nuremberg, 8c en porte encore
le titre. Elle prétend, en cette qualité, avoir
• fur cette ville des droits, que le magiftrat lui con-
tefte. La ville de Nimegue , dans la Guèldres hol-
landoife, a aufli un burggrrwe. { —— )
BURGGRAVIAT ou BURGRAVTAT, {Hifl.
mod. ) On donne1 ce nom à l’étendue de la jurifi
diéfion d’un burggrave. Voyeç ce mot.
BURGHELLI, {Hifl. mod.-) On donne ce nom
à dès petites barques dont on (e fert à Venife pour
aller prendre l’air en mer; elles ont une falle où
il peut -<enir une compagnie de dix à douze per-
fonnes : on les nomme aufli petits bucentaures. {— )
BURGLEHN, ( Hifl. mod. ) L’on nommoit ainfi
autrefois en Allemagne une forte de ligue défen-
five entre deux familles, qui de voit avoir lieu
non-feulement entre les parties exiftantes , mais
aufli entre leurs héritiers 8c defcendans à perpétuité;
8c en vertu de laquelle l’une des deux familles venant
à s’éteindre, l’autre devoit lui fuccéder dans
tous fes biens, droits 8c prérogatives. ( A. R.)
BURGMANN, ( Hift. mod. ) C ’eft le nom qu’on
donne en Allemagne dans les deux villes de Frid-
herg 8c de Gelnhaufen , aux confei 11ers de ville :
pour être admis parmi eux, il faut faire preuve
de nohleffe; les princes 8c les comtes en font
néanmoins exclus ; ce font ces confeillers qui éli-
fent le burggrave, qui relève immédiatement de
l’empereur. ( ----- )
BURIDAN, ( Jean ) ( Hifl. litt. mod. ) refteur
de Funiverfité , do&eur fcolaftique du quatorzième
fiècle, fe rendit célèbre avec fon âne, c’eft-
à-dire, par fon fophifme d’un âne qui ayant également
faim 8c foif, 8c étant placé entre une mefure
d’avoine 8c un fceau d’eau, qu’on fuppofe faire
une égale impreffion fur fes organes , doit, félon
lu i, fe laiffer mourir de faim 8c de foif, faute de
pouvoir fe déterminer pour un de ces objets par
préférence à l’autre, ou qui, s’il fe détermine , ne
peut le faire que par Fufage du libre arbitre. Ce
problème embarraffa long-temps les doâeurs , 8c
il eft encore fameux dans les écoles. O curas ho-
minum !
Il étoit de la feéle des nominaux, 8c perfécuté
par les réaliftes, il fut obligé de s’enfuir en Allemagne
, où Aventin dit qu’il fonda Funiverfité dg
Vienne.
V v w 2