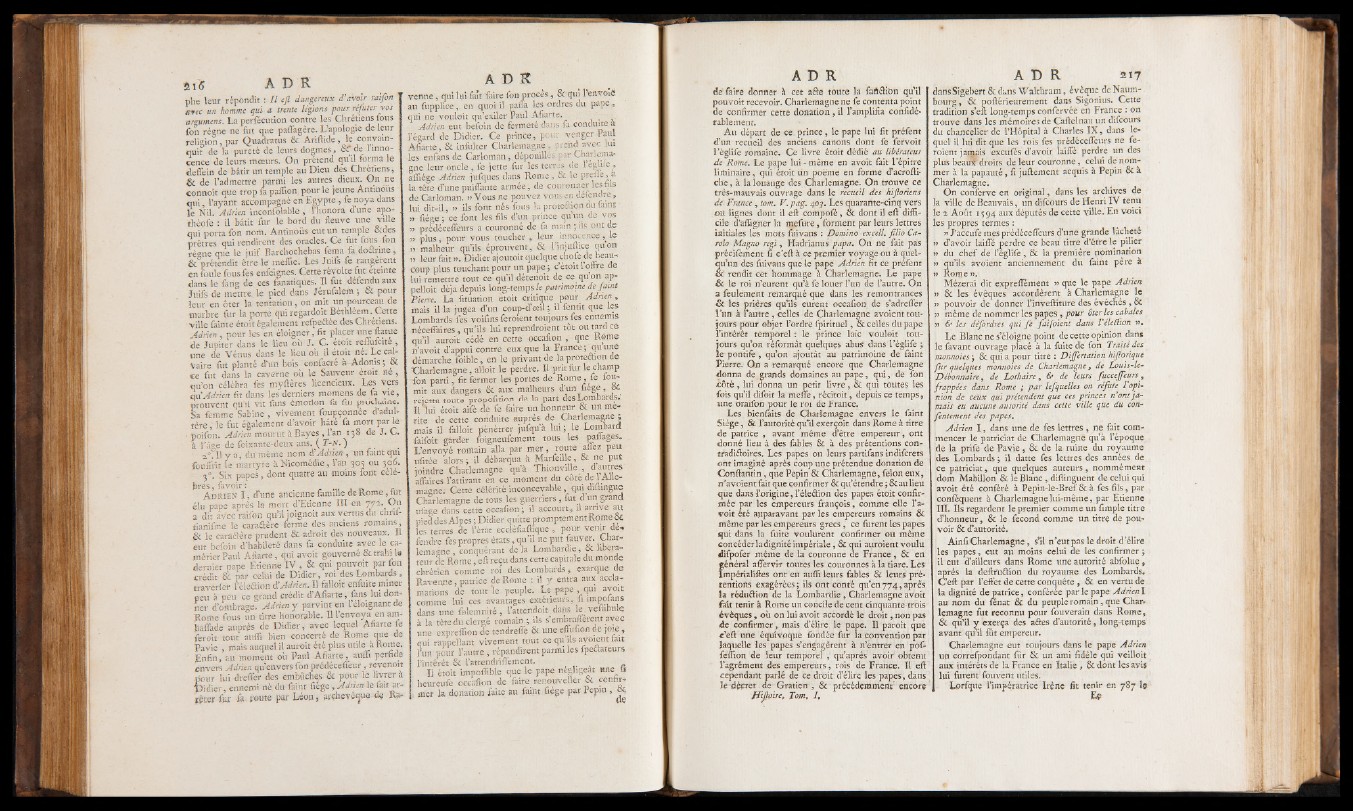
A D R
plie leur répondit : I l eft dangereux d’avoir raifon'
avec un homme qui a trente légions pour réfuter vos
argumens. La perfécution contre les Chrétiens lous
fon règne ne fut que paffagère. L’apologie de leur
religion, par Quadratus & Arifiide, le convainquit
de la pureté de leurs dogmes, &* de l’inno-
cence de leurs moeurs. On prétend qu il forma le
«leffein de bâtir un temple au Dieu des Chrétiens,
6c de l’admettre parmi les autres dieux. On ne
connoît que trop la paffion pour le jeune Antinous
qui, l’ayant accompagné en Egypte , fe noya dans
le Nil. Adrien inconfQlable, l honora d’une apo-
théofe : il bâtit fur le bord du fleuve une ville
qui porta fon nom. Antinoüs eut un temple 8cdes
prêtres qui rendirent des oracles. Ce fut fous fon
rèene que le juif Barchochebas fema fa clofîrine,
& prétendit être le mèflie. Les Juifs fe rangèrent
en foule fousfes enfeignes. Cette révolte fut éteinte
dans le fang de ces fanatiques. Il fut défendu aux
Juifs de mettre le pied dans Jérufalem ; & pour
leur en ôter la tentation, on mit un pourceau de
marbre fur la porte qui regardoit Béthleem. Cette
ville faillie étoit également rcfpeâée des Chrétiens.
'Adrien , pour les en éloigner, fit placer une fia tue
de Jupiter dans le lieu où J. C. était reflùfcité ,
une de Vénus dans le lieu où il étoit né: Le cal-r
Vaire fut planté d’un bois confacre -a- Adonis ; Sl
ce fut dans la caverne où le Sauveur etoit n é ,
qu’on célébra fes myflères licencieux. Les vers
qu'Adrien fit dans les derniers momens de fa v ie ,
prouvent qu’il vit fans émotion fa fin jn'ochaine.
Sa femme Sabine , vivement fouççonnée d’adultère
, le fut également d’avoir hâte fa mort par le
■ poifon. Adrien mourut à B ayes, l’an 138 de J. C.
a l’âge de foixante-deux ans. ( T-N. )
2.0. Il y a , du même nom d’Adrien , un faint qui
fouffrit le martyre à Nicomédie, l’an 305 ou 306.
. Six papes, dont quatre au moins font célébrés,
favoir -
A drien I , d’une ancienne famille de Rome, tut
élu pape après la mort d’Etienne III en 77a. On
a dit avec raifon qu’il joignoit aux vertus du chtif-
fiânilrne le caraftère ferme des anciens romains,
& le caractère prudent & adroit des nouveaux. Il
eut befoin d’habileté dans fa conduite avec le ca-
mérier Paul Afiarte, qui avoit gouverné & trahi 1«
dernier pape Etienne I V , & qui pouvoir par fon
crédit & par celui de Didier, roi des Lombards,
traverfer l’élefiion A’Adrien. Il falloit enfuite miner
peu à peu ce grand crédit d’Afiarte, fans lui donner
d’ombrage. Adrien y parvinten 1 éloignant de
Borne fous un titre honorable. Il l’envoya en am-
baflade auprès de Didier, avec lequel Afiarte fé
fer oit tout. aufli bien concerté de Rome P que de
Pavie , mais auquel il auroit été plus utile à Rome.
Enfin, au moment où Paul Afiarte, aufli perfide
envers Adrien qu’envers fon prédéceflèur , revenoit
pour lui dreffer des embûches 8c pour le livrer a
Didier, ennemi né du faint fiege, Adrien, le fait ar-
ïéter fur fa - route par Léon, arçhevê^ue de Ra*-
A D R
venne, qui lui fait faire fon procès, & qui l’envoië
au fu p p lic e en quoi il pana les ordres du pape,
qui ne vouloit qu’exiler Paul Afiarte.
Adrien eut befoin de fermeté dans fa conduite a
l’égard de Didier. Ce prince, pour venger Paul
Afiarte , 8c infulter Charlemagne, prend avec lui
les enfans de Carloman.,. dépouillés par Charlemagne
leur oncle , fe jette fur les terres de lé g liie ,
afliége Adrien jufques dans Rome, & le prelie, a
la tête d’une puiflànte armée, de couronner les fils
de Carloman. « Vous ne pouvez vous en défendre ,
lui dit-il, « ils font nés fous la protection du faint
n fiége ; ce font les fils d’un prince qu’un de vos
j? prédéceffeurs a couronné de fa main ; ils ont de
» plus, pour vous toucher , leur innocence le
j> malheur qu’ils éprouvent, 8c TinjuAice quon
î> leur fait». Didier ajoütoit quelque chofe defieau-<
i coup plus touchant pour un pape; c’étoit l’offre de
lui remettre: tout ce qu’il détenoit de ce qu on appelait
déjà depuis long-temps le patrimoine de faint
Pierre. La fituation étoit critique pour Adrien,
mais il la jugea d’un coup-d’oeil; il fentit que les
Lombards fes voifinsféroient toujoursfes ennemis
néoeffaires, qu’ils lui reprendroient tôt ou tard cê
qu’il auroit cédé en cette oecafion , que Rome
n’avoit d’appui contre eux que la France; qu une
démarche foible, en le privant de la protection de
■ Charlemagne, alloit le perdre. Il prit fur le champ
fon parti, fit fermer les portes de Rome, fe fournit
aux dangers 8c aux malheurs d’un fiége, oC
rejetta toute propofition de la part des Lombards.
Il lui étoit aifé de fe faire un honneur & un mérite
de cette conduite ■ auprès de Charlemagne ;
mais il falloit pénétrer jufqu’à lui ; le Loinbard
faifoit gârder loigneufement tous les pailages.
L’envoyé romain alla par mer, route affez peu
ufitée alors; il débarqua à Marfeille, & ne put
joindre Charlemagne qu’à Thionville , d autres
affaires l’attirant en ce moment du cote de 1 Allemagne;
Cette célérité inconcevable, quidiffingue
Charlemagne de tous les guerriers , fut d’un grand
ufage dans cette oecafion; il accourt, il arrive ai*
pied des Alpes ; Didier quitte promptement RomeôC
les terres de l’état eccléfiafiique, pour venir défendre
fes propres états, qu’il ne put fauver. Charlemagne
, conquérant de la Lombardie, 8c libérateur
de Rome, eA reçu dans cette capitale du monde
chrétien comme roi des Lombards, exarque de
Ravénne, patrice de Rome : il y entra aux acclamations
de tout le peuple. Le pape, qui avoit
comme lui ces avantages extérieurs.,- f i nnpolans
dans une folemnité , l’attendoit dans le . veAibnle
à la tête du clergé romain ; ils s’embrimerent avec
une expreffion de tendrçffe & une effufion de joie ,
qui rappellant vivement tout ce qu'ils avaient fait
l’un pour l’autre, répandirent parmi les fpectateurs
l’intérêt & l’attendriffement. A n
Il étoit impoffible que le pape négligeât une il
heüreufe oecafion de faire renouvellér & confira
mer la donation faite au faint fiége par Pepm, oc,
de
A D R
de faire donner à cet aéle toute la fartefitm qu’il
pouvoit recevoir. Charlemagne ne fe contenta point
de confirmer cette donation, il l’amplifia confidé-
rablement.
Au départ de ce.prince, le pape lui fit préfent
d’un recueil des anciens canons dont fe fervoit
i ’églife romaine. Ce livre étoit dédié au libérateur
de Rome. Le pape lui-même en avoit fait l ’épi tre
liminaire, qui etoit lin poème en forme d’acroAi-
c h e ,à la louange des Charlemagne. On trouve ce
très-mauvais ouvrage dans le recueil des hifloriens
de France, tom. V. pag. 403. Les quarante-cinq vers
ou lignes dont il eA compofé, oc dont il eA difficile
d’affigner la mefure, forment par leurs lettres
initiales les mots fuivans : Domino excell. fdio Ca-
roîo Magno régi, Hadrianus papa. On ne fait pas
précifément fi c’eA à ce premier voyage ou à quelqu’un
des fuivans que le pape Adrien fît ce préfent
et rendit cèt hommage à Charlemagne. Le pape
6c le roi n’eurent qu’à fe louer l’un de l’autre. On
a feulement remarqué que dans les remontrances
6c les prières qu’ils eurent oecafion de s’adreffer
l ’un à l’autre , celles de Charlemagne avoient toujours
pour objet l’ordre fpîrituel, & celles du pape
l’intérêt temporel : le prince laïc vouloit toujours
qu’on réformât quelques abu$ dans l’églife ;
îe pontife, qu’on ajoutât au patrimoine de faint
Pierre. On a remarqué encore que Charlemagne
donna de grands domaines au pape, qui, de fon
c ô té , lui donna un petit livre, 6c qui toutes les
fois qu’il difoit la mène, récitoit, depuis ce temps,
une Oraifon pour le roi de France^
Les bienfaits de Charlemagne envers le faint
Siège, & l’autorité qu’il exerçoit dans Rome à titre
de patrice , avant même d’être empereur , ont
donné lieu à des fables 8c à des prétentions conr
tradiéloires. Les papes ou leurs partifans indiferets
ont imaginé après coup une prétendue donation de
Confiantin, que Pépin & Charlemagne, félon eux,
ïfavoient fait que confirmer & qu’étendre ; 8c au lieu
que dans l’origine, l’éleâion des papes étoit confirmée
par les empereurs françois, comme elle l’a-
voit été auparavant par les empereurs romains 8c
même par les empereurs grecs, ce furent les papes
qui dans la fuite voulurent confirmer ou même
concéder la dignité impériale, 8c qui auroient voulu
difpofer même de la couronne de France, 8c en
générai aflervir tontes les couronnes à la tiare. Les
ïmpérialiAes ont eu auffi leurs fables 8c leurs prétentions
exagérées ; ils ont conté qu’en 774, après
la rédnftion de la Lombardie , Charlemagne avoit
fait tenir à Rome un concile de cent cinquante trois
évêques, où on lui avoit accordé le droit, non pas
de confirmer, mais d’éijre le pape. Il pafroît que
c’efi une équivoque fondée fur la convention par
laquelle les papes s’ërigàgêrent à n’entrer en pof-
fefiion de leur temporel , qu’après avoir obtenu
l’agrément des empereurs, rois de France. Il eA
cependant parlé de ce droit d’élire les papes, dans
le décret , de Gratien , 8c précédemment encore
ffiflçire, Tom. /,
A D R 4 1 7
dansSigebert 8c dans Walthram, évêque de Naum-
bourg, -8c poAérieurement dans Sigonius. Cette
tradition s’eA long-temps confervée en France : on
trouve dans les mémoires de CaAelnau un difeours
du chancelier de l’Hôpital à Charles IX , dans lequel
il lui dit que les rois fes prédéceffeurs ne fe-
roient jamais exeufés d’avoir laiffé perdre un des
plus beamr droits de leur couronne, celui de nommer
à la papauté, fi juAement acquis à Pépin 8c à
Charlemagne.
On conferve en original, dans les archives de
la ville de Beauvais, un difeours de Henri IV tenu
le 2. Août 1594 aux députés de cette ville. En voici
les propres termes :
r> J’accufe mes prédéceffeurs d’une grande lâchete
j> d’avoir laiffé perdre ce beau titre d’être le pilier
jj du chef de l’eglife, 8c la première nomination
jj qu’ils avoient anciennement du faint père a
jj Komc’V
Mézerai dit expreffément jj que le pape Adrien
jj 8c les évêques accordèrent à Charlemagne le
jj pouvoir de donner l’inveAiture des évêchés , 8c
jj même de nommer les papes , pour ôter les cabales
jj & les défordres qui fe faifoient dans VeleElion jj.
Le Blanc ne s’éloigne point de cette opinion dan*
le favant ouvrage placé à la fuite de fon Traité des
monnoies ; 8c qui a pour titre : Differtation hijlorique
fur quelques monnoies de Charlemagne , de Louis-le-
Débonnaire, de Lothaire, & de leurs fucceffeurs 9
frappées dans Rome ; par lefquelles on réfute l opinion
de ceux qui prétendent que ces princes n ont ja mais
eu aucune autorité dans cette ville que du con-
fentement des papes.
' Adrien I , dans une de fes lettres , ne fait commencer
le patriciat de Charlemagne qu’à l’époque
de la prife de Pavie, 8c de la ruine du royaume
des Lombards ; il datte fes lettres des années de
ce patriçiat, que quelques auteurs, nommément
dom Mabillon 8c le Blanc , diflinguent de celui qui
avoit été conféré à Pepin-le-Bref 8c à fes fils, par
conféquent à Charlemagne lui-même, par Etienne
III. Ils regardent le premier comme un fimple titre
d’honneur, 8c le fécond comme un titre de pouvoir
8c d’autorité.
Ainfi Charlemagne, s*H n’eut pas le droit d’élire
les papes, eut au moins celui de les confirmer ;
il eut d’ailleurs dans Rome une autorité abfolue ,
après la defiruéfion du royaume des Lombards.
C’eA par l’effet de cette conquête , 8c en vertu de
la dignité de patrice, conférée par le pape AdrienI
au nom du fénat 8c du peuple romain, que Charlemagne
fut reconnu pour fouverain dans Rome,
8c qu’il y exerça des aâes d’autorité, long-temps
avant qu’il fut empereur,
Charlemagne eut toujours dans le pape Adrien
un eorrefpondant fûr 8ç un ami fidèle qui veilloit
aux intérêts de la France en Italie, & dont les avi$
lui furent fouvent utiles.
Lprfqite l’impératrice Irène fit tenir en 787 le
Ee