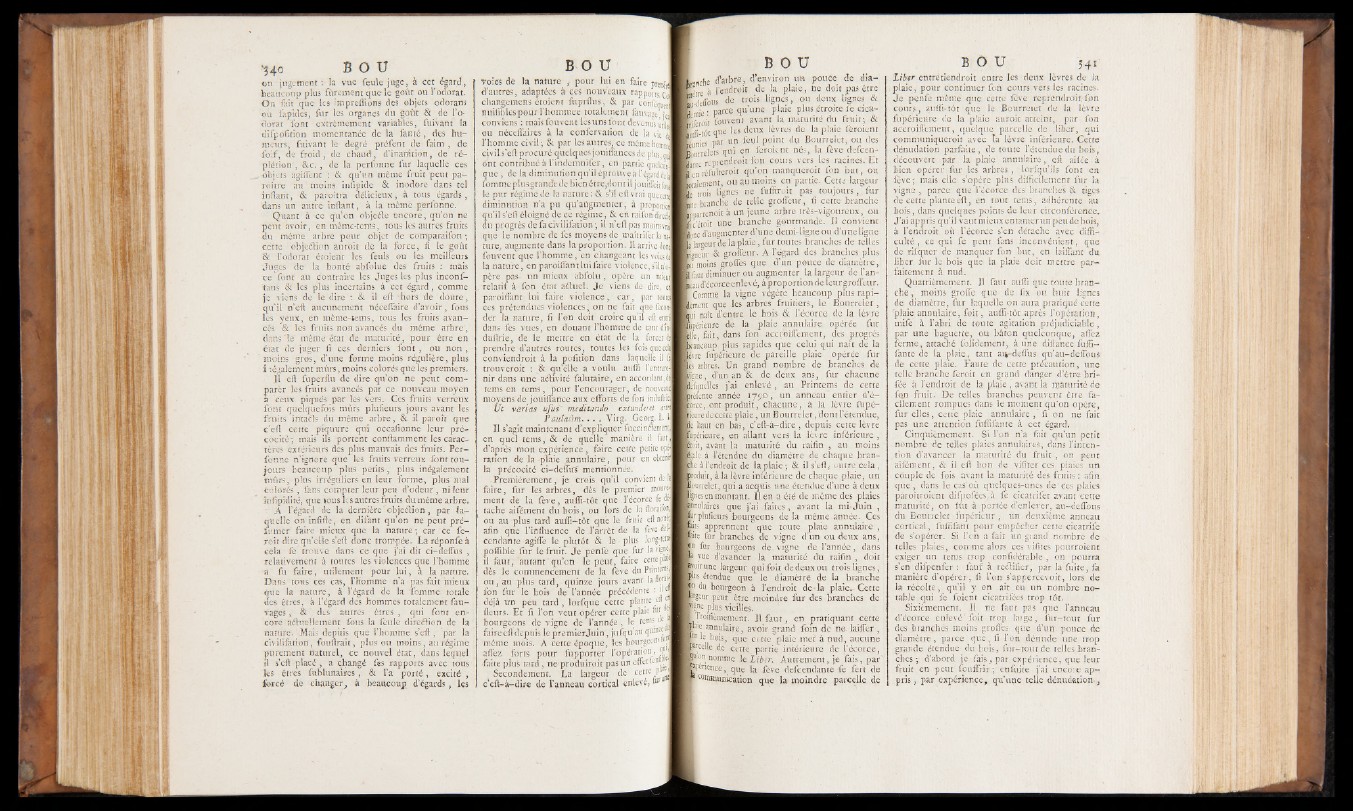
^4o B O U
on jugement : la vue feule juge, à cet égard.,
beaucoup plus fûrement que le goût ou l'odorat.
On fait que les irhpreffions des objets odorans
ou lapides, fur les organes du goût & de l’odorat
font extrêmement variables, fuivànt la
difpofition momentanée de la fanté , des humeurs,
fuivant le degré préfent de faim , de
foif, de froid, de chaud, d’inanition, de ré-
plétion , &c., de la. perlbnne fur laquelle ces
objets agiiTent : & qu’un même fruit peut pa-
roître au moins inupide & inodore dans tel
inflant, & paraîtra délicieux, à tous égards,
dans un autre inflant, à la même perfonne.
Quant à ce qu’on objeéle encore, qu’on ne
peut avoir, en même-tems, tous les autres fruits
du même arbre pour objet de compâraifon •
cette objeéBon aurait de la force, fi le goût
& l’odorat étoierit les feuls, ou les meilleurs
Juges de' la bonté abfolue des fruits : mais
ce font au contraire les Juges les plus inconf-
tans & les plus incertains à cet égard, comme
je viens de le dire & il eft hors dé dôure,
qu’il n’eft aucunement néceflaire d’avoir, fous
les yeux, en même-tems, tous les fruits avancés
& les fruits non avancés du même arbre,
dans le même état de maturité, pour être en
état dé juger fi ces derniers font, ou non,
moins gros, d’une forme moins régulière, plus
i légalement mûrs, moins colorés que les premiers.
Il eft fuperflu de dire qu’on ne peut com-
parèr les fruits avancés par ce nouveau moyen
a ceux piqués par les ver-Sr Ces fruits verreux
font quelquefois mûrs plufieurs jours avant les
fruits intaéïs du même arbre, & il paroît que
c’eft cette piquure qui occafionne leur précocité
-, mais ils portent conftamment les caractères
extérieurs des plus mauvais des fruits. Perfonne
n’igriorê que les fruits verreux font toujours
beaucoup plus petits-, plus inégalement
mûrs, plus irréguliers en leur forme, plus mal
Colorés, fans compter leur peu d’odeur, ni leur
infipidité, que tous les autres fruits du même arbre.
• A l’égard de la dernière ' objection, par laquelle
on infifte, en difant qu’on ne peut prélu
mer faire mieux que la nature -, car ce fe-
roit dire qu’elle s’eft donc trompée. La réponfe à
cela fe trouve dans ce que j’ai dit ci-deffus ,
relativement à toutes les violences que l’homme
a fu faire, utilement pour lui, à la nature.
Dans tous ces cas, l’Homme n’a pas fait mieux
que la nature, à l’égard de la 'fomme totale
des êtres, à l’égard des hommes totalement fau-
vages, & des autres êtres , qui font encore
actuellement fous la feule direction de la
nature. Mais depuis que l’homme s’eft, par la
civilifation, fouftrait, plus ou moins, au régime
purement naturel, ce nouvel état, dans lequel
il s’eft placé , a changé fes rapports avec tous
les êtres fubluttaires, & l’a p'orté, excité ,
forcé de changer, à beaucoup d’égards, les
B o u
voiés de la nature ,• pour lui en faire pfer.M
d’autres j adaptées à ces nouveaux rapports. c3
changemefts étoient fnprflus, & par confécj
nuifiblespour l’hommee totalement fauv^e* i’J
conviens : mais fouvent les uns font devenus iuilj
ou néceffaires à la confervation de la vie J
l’homme civil*, & par les autres, ce mêmehoir.nl
civil s’eft procuré quelques joui flan ces de pliis,™]
ont contribué à l’indcmnifer, en partie cjuclconJ
que , de la diminution qu’il éprouve à l’égard dc|l
fomme plusgrand'e dç bien être,dont il jouiûbitfoj
le pur régime de la nature : & s’il eft vrai queccttJ
diminution n’a pu qu’aügmenter, à proportion
qu’il s’efl éloigné de ce régime, & en raifon dirccle]
du progrès de fa civilifation *, il n’eft: pas moins vrai
que le nombre de fes moyens de maîtrifer la iJ
ture, augmente dans la proportion. Il arrive dons
fouvent que l’homme, en changeant les voiesdl
la nature, en paroiifant lui faire violence, s’iln’oJ
père pas- un mietix ablolu , opère lin inieuî
relatif à fon état aétuel. Je viens de dire, en]
paroiftant lui faire violence, car, par toutes
ccs prétendues violences x on ne fait que feconl
der la nature, fi l’on doit croire qu’il eft entra
dans fes vues, en douant l’homme de tant d’inl
dufirie, de le. mettre en état de la forcer de
prendre d’autres routes, toutes les fois que celai
conviendroit à la pofitîon dans laquelle il ta
trouveroit : & qu’élle a voulu aufii l’entrete-j
nir dans une aélivité falutaire-, en accordant,dé
tems en tems, pour l’encourager , de nouveau!
moyens de jouiffance aux efforts de fon induflriej
Ut varias ufus~ meditando extunderet arui
Paulaiim. . . . Virg. Georg. L. Il
Il s’agit maintenant d’expliquer fuccinétementj
en quel tems, & de quelle manière il faut 1
d’après mon expérience, faire cette petite opéj
ration de la -plaie annulaire, pour en obtenir]
la précocité ci-defllrs mentionnée.
-Premièrement, je crois qu’il convient de 11
faire, fur lès arbres, dès le premier mouve-j
ment de la fève, auffi-tôt que l’écorce fe ddj
tache aifément du bois, ou lors de la floraifonj
ou au plus tard auffi-tôt que le fruit eft noirci
afin que l’influence de l’arrêt de la fève défi
cendante agiffe le plutôt & le plus long-tems
poffible fur le fruit. Je penfe que fur la vigne]
il faut, 'autant qu’on le peut, faire cette pw
dès le commencement de la fève du Printemsj
ou, au plus tard, quinze jours avant la
fon fur le bois de l’année précédente : ne
déjà un peu tard , lorfque cette plante cil ej
fleurs. Et fi l?on veut opérer cette plaie un j’,
bourgeons de vigne de l’année, le tems djj J
faireefidepuis le premiérJuin, jufqu’aiî ftuïnzl j
même mois. À cette époque, les bourgeons J
affez forts pour fupporter l’opération, J1j
•faite plus tard , ne^produiroit pas un effet leniil
Secondement. La largeur de cette P J
e’eft-à-dire de l’anneau cortical enlevé, n>r j
B o u
Branche dVbre, d’environ un pouce de dia-
l ‘|ri j (endroit de la plaie, lie doit pas être
■ n-deVous de trois lignes , ou deux lignes &
■ inie: parce qu’une plaie plus étroite le cica-
ïïToit ïouvenr avant la maturité du fruit; &
Kjll-tôcque les deux lèvres de la plaie fèroient
R •„ nar un feul point Hlin.i'* ■ ir* p d_pi Boi uràr eletj, oru des Bourrelets qui en feraient nés, la lève delcen-
B a n te reprendroit Ion cours vers les racines. Et
I^ rëfulteroit qu’on manquerait fon but, ou
italeniènt, où au moins en partie. Cet u largeur
Be trois lignes ne lùffiroit pas toujours, fur
ine branche de telle groffeur, fi cette branche
«pparrenoit à un jeune arbre très-vigoureux, ou
Bc’étoit une branche gourmande. II convient
Bonc d’augmenter d’une demi-ligne ou d’une ligne
■ a labeur de la plaie, fur toutes branches de telles
tueur & groffeur. À l’égard des branches plus
Bu moins groffes que d’un pouce de diamètre,
Ij faut diminuer ou augmenter la largeur de l’an-
■ îaud’écorce enlevé, àproportiori de leurgroffeur.
| Gomme la vigne'végète beaucoup plus rapidement
que les arbres fruitiers, le Bourrelet,
»•qui naît d’entre le bois & l’écorce de la lèvre
■ jipérieure de la plaie annulaire opérée fur
Hle fait, dans fon accroiflement, des progrès
Beaucoup plus rapides que celui qui naît de la
lèvre fupérieure de pareille plaie opérée fur
les arbres. Un grand nombre de branches de
wigne j d’un an & de deux ans,, fur chacune
fcjquelles j’ai, enlevé , au Printems de cette
wéfente année 17530, un anneau’ entier d’é-
lorce,.ont produit, chacune, à la lèvre fupé-
Iticure de cette plaie, un Bourrelet, dont l’étendue,
Me haut en bas, c’eft-à-dire , depuis cette lèvre
Supérieure, en allant vers la lèvre inférieure,
«toit, avant la maturité du raifin , au moins
Bgalc à l’étendue du diamètre de chaque bran-
Ihe à l’endroit de la plaie ; & il s’efi,- outre cela,
Produit, à la lèvre inférieure de chaque plaie, un
Bourrelet, qui a acquis une étendue d’une à deux
lignes en montant, lien a été de même des plaies
Inmilaires que j’ai faites, avant la mi-Juin ,
|ur plufieurs bourgeons delà même-année. Ces
laits apprennent que toute plaie annulaire ,
laite fur branches de vigne d’un ou deux ans,
#u fur bourgeons de vigne de l’année, dans
Ba vue d’avancer la maturité du raifin , doit
«voir une largeur qui foit de deux ou trois lignes,
|ps étendue que le diamètre de la branche
B11 du bourgeon à l’endroit de-la plaie.- Cette
JFgeur peut être moindre fur des branches de
■ gne plus vieilles.
iTroifièmeinent. Il faut, en pratiquant cette
■ |ie annulaire, avoir grand foin de nev laifiër ,
■ ür M bois , que cette plaie inef à nud, aucune
Batcelle,de cette.,partie intérieure de l’écorce,
B 11 on nomme le Liber. Autrement, je fais, par'
Spénençe, que la fève defeendante -fe fert de
m C01nmunication que la moindre parcelle de
B Ô U 341
Libvr entrëtiendroit entre les deux lèvres de la
plaie, pour continuer fon cours vers les racines.
Je penfe même que cette fève reprendroit; fon
cours, aulïi-tôt que le. Bourrelet de la lèvre
fupérieure de la plaie auroit atteint, par fon
accroiflement, quelque parcelle de , liber, qui
communiqueroit avec ta lèvre inférieure. Cette
dénudation parfaite, de toute l’étendue du bois,
découvert par la plaie annulaire, eft ailée à
bien opérer fur les arbres, lorsqu’ils font en
fève* mais elle s’opère plus difficilement fur la
vigne, parce que l’écorce des branches & tiges
de cette plante eft , en tout teins, adhérente au
bois, clans quelques points de leur circonférence.
J’ai appris qu’il vaut mieux entamer un peu de bois,
à l’endroit où l’écorce s’en détache avec difficulté
, ce q.ui fe peut fans inconvénient, que
de rilquer de manquer fon but, en 1 aillant du
liber fur le bois que la plaie doit mettre parfaitement
à nud.
Quatrièmement. U faut aufii que tonte branche
, moins grofle que de fix ou huit lignes
de diamètre, fur laquelle on aura pratiqué cette
'plaie annulaire, foit, auffi-tôt après l’opération,
mife à l’abri de toute agitation préjudiciable,
par une baguette, ou bâton quelconque, afiez
ferme, attaché folidement, à une cliftance fuffi-
fante de la plaie., tant aifr-deflûs qu’au-defibus
de cette plaie. Faute de cette précaution, une
telle branche feroit en grand danger d’être bri-
fée à l’endroit de la plaie, avant la maturité de
fon fruit. De telles branches peuvent être facilement
rompues dans le moment qu’on opère,
fur elles, cette plaie annulaire, fi on ne fait
pas une attention fuffifante à cet égard.
Cinquièmement. Si l’on n’a fait qu’un petit
.nombre de telles plaies annulaires, dans l’intention
d’avancer la maturité du fruit, on peut
aifément, & il eft bon de yifiter ces plaies un
couple de fois avant la maturité des fruits : afin
que , dans le cas où quelques-unes de'ccs plaies
pâroîiroicnt difpoféesrà fe cicatrifer avant'cette
maturité, on fût à portée d’enlever, au-deflous
du Bourrelet fupéricur , un deuxième anneau
cortical, fuffifant pour empêcher cette cicatrife
de s’opérer. Si l’cn a fait un grand nombre de
telles plaies, comme alors ces vifites pourroient
exiger un tems trop confidérable , on pourra
s’en difpenfer : faut’ à reélifier, par la fuite, fa
manière d’opérer, fi l’on s’appercevoit, lors de
la récolte, qu’il y en ait eu un nombre notable
qui fe foient cica tri fées trop tôt.
Sixièmement. 11 ne faut pas que l’anneau
d’écorce enlevé''foit trop large, fur-tout fur
des branchés moins groffes que d’un pouce de
diamètre, parce que, fi l’on dénude une trop
grande étendue du bois, fur-tout de telles branches
; d’abord je fais, par expérience, que leur
fruit en peut fouffrir-, cnfûite j’ai encc: e appris
, par expérience, qu’une telle dénudation^