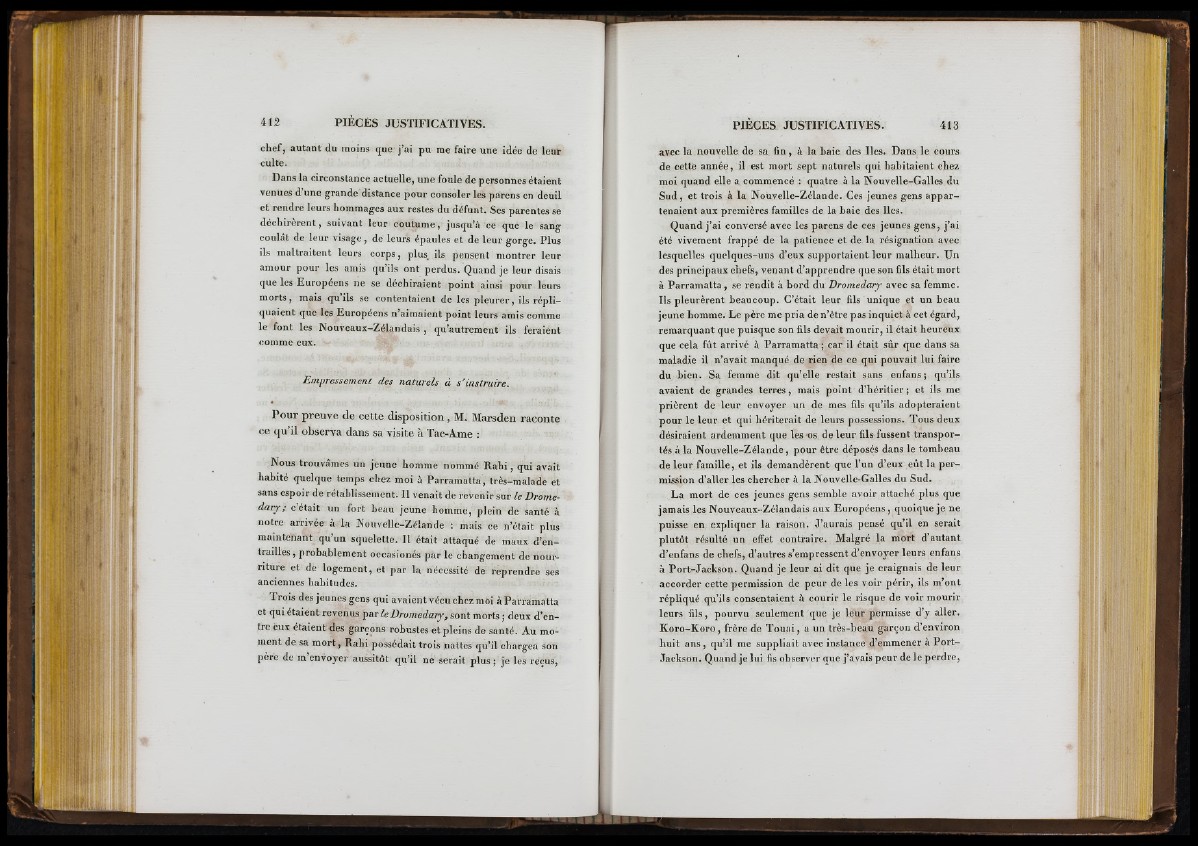
tl, ■
u
t
“l i l t
chef, autant du moins que j ’ai pu me faire une idée de leur
culte.
Dans la circonstance actuelle, une foule de personnes étaient
venues d’une grande distance pour consoler les parens en deuil
et rendre leurs hommages aux restes du défunt. Ses parentes se
déchirèrent, suivant leur coutume, jusqu’à ce que le sang
coulât de leur visage, de leurs épaules et de leur gorge. Plus
ils maltraitent leurs corps, plus ils pensent montrer leur
amour pour les amis qu’ils ont perdus. Quand je leur disais
que les Européens ne se déchiraient point ainsi pour leurs
morts , mais qu’ils se contentaient de les pleurer, ils répliquaient
que les Européens n’aimaient point leurs amis comme
le font les Nouveaux-Zélandals , qu’autrement ils feraient
comme eux.
Empressement des naturels à s ’ instruire.
P our preuve de cette disposition, M. Marsden raconte
ce qu’il observa dans sa visite à Tae-Ame :
Nous trouvâmes un jeune homme nommé R ah i, qui avait
habité quelque temps chez moi à Parramatta, très-malade et
sans espoir de rétablissement. Il venait de revenir sur le Dromedary;
c’était un fort beau jeune bomme, plein de santé à
notre arrivée à bi Nouvelle-Zélande ; mais ce n’était plus
maintenant qu’un squelette. Il était attaqué de maux d’en-
trailles, probablement occasionés par le changement de nourriture
et de logement, et par la nécessité de reprendre ses
anciennes babitudes.
Trois des jeunes gens qui avaient vécu chez moi à Parramatta
et qui étaient revenus par le Dromedary, sont movU; deux d’entre
eux étaient des garçons robustes et pleins de santé. Au moment
de sa mort, Rabi possédait trois nattes qu’il chargea son
père de m’envoyer aussitôt qu’il ne serait plus ; je les reçus,
avec la nouvelle de sa fin, à la baie des Iles. Dans le cours
de cette année, il est mort sept naturels qui habitaient cbez
moi quand elle a commencé : quatre à la Nouvelle-Galles du
Sud, et trois à la Nouvelle-Zélande. Ces jeunes gens appartenaient
aux premières familles de la baie des Iles.
Quand j’ai conversé avec les parens de ces jeunes gens, j’ai
été vivement frappé de la patience et de la résignation avec
lesquelles quelques-uns d’eux supportaient leur malheur. Un
des principaux chefs, venant d’apprendre que son fils était mort
à Parramatta , se rendit à bord du Dromecîarj^ avec sa femme.
Ils pleurèrent beaucoup. C’était leur fils unique et un beau
jeune homme. Le père me pria de n’être pas inquiet à cet égard,
remarquant que puisque son fils devait mourir, il était heureux
que cela fut arrivé à Parramatta ; car il était sûr que dans sa
maladie il n’avait manque de rien de ce qui pouvait lui faire
du bien. Sa femme dit qu’elle restait sans enfans; qu’ils
avaient de grandes terres, mais point d’héritier ; et ils me
prièrent de leur envoyer un de mes fils qu’ils adopteraient
pour le leur et qui hériterait de leurs possessions. Tous deux
désiraient ardemment que les os de leur fils fussent transportés
à la Nouvelle-Zélande, pour être déposés dans le tombeau
de leur famille, et ils demandèrent que l’un d’eux eût la permission
d’aller les chercher à la Nouvelle-Galles du Sud.
La mort de ces jeunes gens semble avoir attaché plus que
jamais les Nouveaux-Zélandais aux Européens , quoique je ne
puisse en expliquer la raison. J’aurais pensé qu’ il en serait
plutôt résulté un effet contraire. Malgré la mort d’autant
d’enfans de chefs, d’autres s’empressent d’envoyer leurs enfans
à Port-Jackson. Quand je leur ai dit que je craignais de leur
accorder cette permission de peur de les voir périr, ils m’ont
répliqué qu’ils consentaient à courir le risque de voir mourir
leurs fils, pourvu seulement que je leur permisse d’y aller.
Koro-Koro , frère de T ou ai, a un très-beau garçon d’environ
buit ans, qu’il me suppliait avec instance d’emmener à Port-
Jackson. Quand je lui fis observer que j’avais peur de le perdre,
. ’H