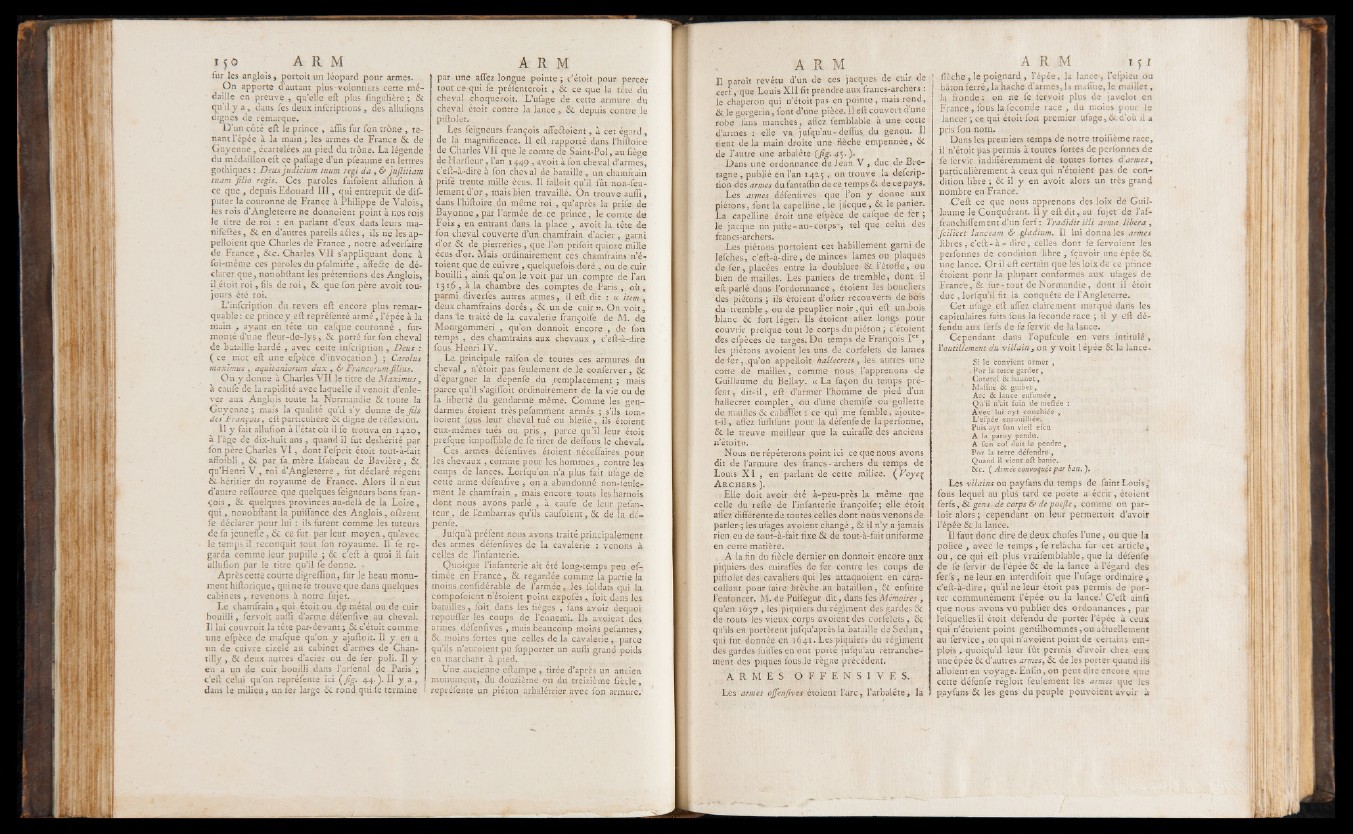
fur les anglois, portoit un léopard pour armes.
On apporte d’autant plus-volontiers cette médaille
en preuve , qu’elle eft plus fingulière ; &
qu’il y a , dans Tes deux infcriptions , des allufions
dignes de remarque.
D ’un côté eft le prince , aflis fur fon trône , tenant
l’épée à la main ; les armes de France &. de
Guyenne, écartelées au pied du trône. La légende
du médaillon eft ce paffage d’un pfeaume en lettres
godiiques : De us judicium tuum régi du , & jujlitiam
tuam filio regis. Ces paroles faifoient allufion à
ce que , depuis Edouard I I I , qui entreprit de disputer
la couronne de France à Philippe de Valois,
les rois d’Angleterre ne donnoient point à nos rois
le titre de roi : en parlant d’eux dans leurs ma-
nifeftes, & en d’autres pareils aères , ils ne les appelaient
que Charles de'France , notre, .advèrfaire
de France, & c . Charles VII s’appliquant donc à
foi-même ces paroles du pfalmifte, affe&e- de déclarer
que , nonobftant les prétentions des Anglois,
il étoit r o i , fils de ro i, & que fon père avoit toujours
été roi.
L’infcription du revers eft encore plus remarquable
: ce prince y eft repréfenté armé, l’épée à la
main ; ayant en tête Un cafque couronné , fur-
monté d’une fleur-de-lys, & porté fur fon cheval
de bataille bardé , avec cette infeription , Deus :
( ce mot eft une efpèce d'invocation ) ; Carolus
maximus , aquïtaniorum dux , & Francorum filins.
On y donne à Charles V II le titre de Maximus ,
à caule de la rapidité avec laquelle il ve-noit d’enlever
aux Anglois toute la Normandie & toute la
Guyenne ; mais la qualité qu’il s’y donne de Jils
des François, eft particulière & digne de réflexion.
11 y fait allufion à l’état où il fe trouva en 1420,
à l’âge de dix-huit ans, quand il fut déshérité par
fon père Charles V I , dont l’efprit étoit tout-à-fait
affoibli , & par fa^mère Ifabeau de Bavière , &
qu’Henri V , roi d’Angleterre , fut déclaré régent
& héritier du royaume de France. Alors il n’eut
d’autre reffource que quelques feigneurs bons fràn-
çois , & quelques provinces au-delà de la Loire,
qui , nonobftant la puiffance des Anglois, ofèrent.
fe déclarer pour lui : ils furent comme les tuteurs
de fa jeuneffe, & ce fut par leur moyen, qu’avec
le temps il reconquit tout fon royaume. Il fe regarda
comme leur pupille ; & ç’eft à quoi il fait
allufion par le titre qu’il fe donne.
Après cette courte dîgreflion, fur le beau monument
hiftorique, qui ne fie trouve que dans quelques
cabinets , revenons à notre fujet.
Le chamfrain, qui étoit ou de métal ou de cuir
bouilli, fervoit aufli d’arme défenfive au cheval.
Il lui couvroit la tête par-devant ; & c’étoit comme
une efpèce de mafque qu’on y ajuftoit. Il y en a
un de cuivre cizelé au cabinet d’armes de Chant
il ly , & deux autres d’acier ou de fer . poli. Il y
en a un de cuir bouilli dans l’arfenal de Paris ;
c’eft celui qu’on repréfente ici ( fig. 44. ). Il y a ,
dans le milieu, un fer large ôc rond qui fe termine I
par une allez longue pointe ; c’étoit pour percer
tout ce-qui fe prélènterôit ,- & ce que la tête, du
cheval choqueront. 'L ’ufage de cette armure du
cheval étoit contre la lance , 8t depuis contre le
piftolet.
L^s feigneurs françois affe&oient, à cet égard,
de la magnificence. Il eft rapporté dans l’hiftoire
de Charles V II que le comte de Saint-Pol, au fiège
de Harfleur , l’an 1449 , avoit à fon cheval d’armes,
c eft-a-dire a fon cheval de bataille , un chamfrain
prifé trente mille écus. Il falloit qu’il fût non-feulement
d’or-, mais bien travaillé.. On trouve aufli *
dans l’hiftoire du même roi , qu’aprës la prife de
Bayonne , par l’armée de ce prince, le comte de
Foix * en entrant dans la place , avoit la tête de
fon cheval couverte d’un chamfrain d’acier , garni
d’or & de pierreries , que l’on prifoit quinze mille
écus d’or. Mais ordinairement ces chamfrains n’é-
toient que de cuivre , quelquefois doré , ou de cuir
bouilli, ainfi qu’on le voit par un compte de l’an
131,6 , à la chambre des comptes de Paris , où ,
parmi diverfes autres armes, il eft dit : « item ,
deux chamfrains doré§ , & un de cuir ». On vo it,
dans 'le traité de la cavalerie françoife de M. de
Montgommeri , qu’on donnoit encore , de fon
temps , des chamfrains aux chevaux , c’eft-à-dire
.fous Henri IV.
La principale raifon de toutes ces armures du
cheval, n’étoit pas feulement de le conferver, &
d’épargner la dëpenfè du ^emplacement ; mais
parce qu’il s’agifloit ordinairement de la vie ou de
la liberté du gendarme même. Comme les gendarmes
étoient très pefamment armés ; s’ils tom-
boient fous leur cheval tué ou ,bie.ffé, ils étoient
eux-mêmes^tués ou pris., parce qu’il leur étoit
. prefque impoffible de fe tirer de deffous le cheval.
Ces armes- défenfives étoient néceffaires. pour
les chevaux , comme pour les hommes , contre les
coups de lances. Lorfqu’on. n’a plus fait ufage de
cette arme défenfive , on a abandonné non-leule.r
ment le chamfrain , mais encore tours les harnois
dont nous avons parlé , à caufë de leur pefan-
teur, de ^embarras qu’ils caufoient, & de là dc-
penfe. ,r
Jufqu’à préfent nous avons traité principalement
des armes défenfives de la cavalerie venons à
celles de l’infanterie.
Quoique l’infanterie ait été long-temps peu ef-
tim.ée en France , & regardée comme la partie la
moins considérable de l’armée ,..les Soldats qui la
compofoient n’étoient point expofés , foit dans les
batailles , foit dans les ftèges , fans avoir dequoi
repouffer les coups de l’ennemi. Ils .avaient désarmés
défenfives , mais beaucoup moins pelantes,'
& moins fortes que celles de la cavalerie, parce
qu’ils n’auroient pu fupporter un aufli grand poids,
en marchant à pied.
Une ancienne eftamp.e , tirée d’après un ancien
monument, du douzième eu du treizième fiècle,
repréfente un piéton arbalétrier avec fon armure.
Il paroît revêtu d’un de ces jacques de cuir de
cerf, que Louis XII fit prendre aux francs-archers :
le chaperon qui n’étoit pas en pointe , mais rond,
& le gorgerin, font d’une pièce. § eft couvert d’qne
robe fans manches , allez femblable a une cotte
d’armes : elle va, jufqu’au-deffus. du genou. Il
tient de la main droite une flèche empennée, &
de l’autre une arbalète (fig* )•
Dans une ordonnance de Jean V , duc de Bretagne
, publié en l’an 1425 , on trouve ,1a deferip-
tion des armes du fantaflin de ce temps & de ce pays.
Les armes défenfives que l’on y donne aux
piétons, font la capelline , le jâcque , êc le panier.
La capelline étoit une efpèce de cafque de fer ;
le jacque un jufte-au-corps-, tel que celui des
francs-archers.
.Les piétons portoient cet habillement garni de
lefehes, c’eft-à-dire, de minces lames ou plaques
de fer , placées entre la doublure & l’étoffé, ou
bien de mailles. Les paniers de tremble, dont il
eft parlé dans l’ordonnance , étoient les boucliers
des piétons ; ils étoient d’ofier recouverts de bois
du tremble , ou de peuplier noir ,qui eft un,bois
blanc & fort léger. Ils étoient afl'ez longs pour
couvrir prefque tout le corps du piéton ; c’ëtoient
des efpèçes de targes. Du temps de François Ier,
les piétons avoient les uns de corfelets de lames
de fe r , ,qu’on appelloit hallecrets , les autres une
cotte de mailles, comme nous l’apprenons de
Guillaume du Bellay. « La façon du temps préfent
, dit-il, eft d’armer l’homme de pied d’un
hallecret complet, ou d’une chemife ou gollette
de mailles & cabinet : ce qui me femble, ajoute-
t-il , affez fuftifant pour la défenfe de la perfonne,
& le treuve meilleur que la cuiraffe des anciens
n’étoit».
Nous fie répéterons point ici ce que nous avons
dit de l’armure des francs - archers du temps de
Louis X I , en parlant de cette milice. ( Voye^
Archers ).
Elle doit avoir été à-peu-près la même que
celle du refte de l’infanterie Françoife; elle étoit
afl'ez différente de.toutes celles dont nous venons de
parler^; les ufages avoient changé , & il n’y a jamais
rien eu de tout-à-fait fixe ÔC de tout-à-fait uniforme
en cette matière.
A la fin du fiècle dernier on donnoit encore aux
piquiers des- c.uiraffes de fer contre les coups de
piftolet des cavaliers qui les attaquoient en cara-
collant pour faire brèche au bataillon, & enfuite
l’enfoncer. M. de Puifegur dit, dans fes Mémoires ,
qu’en 1637 , les piquiers du régiment des gardes &
de touts les vieux corps avoient des corfelets, &
qu’ils en portèrent jufqu’après la bataille de Sedan,
qui fut donnée en 1641. Les piquiers du régiment
des gardes fuiffes en ont porté jufqu’au retranchement
des piques fous le règne précédent.
A R M E S O F F E N S I V E S .
Les armes ojfenfivcs étoient l’arc,, l'arbalète, la
j flèche, le poignard , l’épée, la lance, l'efpieu ou
J bâton ferré, la hache d’armes, la mafiue, le maillet,
la fronde on ne fe fervoit plus de javelot en
Franpe , fous la fécondé race , du moins pour le
lancer ; ce qui étoit fon premier ufage, & d’où il a
pris fon nom.
Dans les premiers temps de notre troifième race,
il n’étoit pas permis à toutes fortes de perfonnes de
fe fervir indifféremment de toutes fortes d'armes,
particulièrement à ceux qui n’étoient pas de condition
libre ; & il y en avoit alors un très grand
nombre en France.
.C’eft ce que nous apprenons des loix de Guillaume
le Conquérant. Il y eft dit, aû fujet'de l’af»
franchiffement-d’un ferf : Tradidit illi arma libéra. ,
l'fcilicet lançeam & ^gladium. Il lui donna les armes
libres , c’eft- à - dire, celles dont fe fer voient les
perfonnes de condition libre , fçavoir une épée 6c
une lance. Or-il eft certain que les loix de ce prince
étoient pour la plupart conformes aux ufages- de
Franck j ôc fur-tout de Normandie , dont il. étoit
duc , lorfqu’il fit la conquête de l’Angleterre.
Cet ufage. eft affez clairement marqué dans les
capitulaires faits fous la fécondé race ; il y eft défendu
aux ferfs de fe fervir de la lance.
Cependant dans l’opufcule en vers intitulé,
l’outillement du villain, on y voit 1 épée & la lance.
Si le tonvient armer ,
< Por la terre garder ,
Coterel & haunet,
Maffiië & Jgaibet, , ^
Arc Sc lance enfumée ,
Qu’il n’ait foin de meflée :
Avec lui' ayt èouchiée
L’efpê.e enrouilliée;
Puis ayt fon vieil efcü
A la paroy pendu.
A fon col doit le pendre ,
Por la' terre défendre-,
Quand il vient oft banie.
&c. ( Armée convoquée par ban. ).
Les vilains ou payfans du temps de faint Louis,"
fous lequel au plus tard ce poète a é c r it, étoient
ferfs, & gens de corps & de poefle, comme on par-
loit alors ; cependant on leur permettoit d’avoir
l’épée Scia lance.
Il faut donc dire de deux chofes l’une, ou que la
police , avec le temps , fe relâcha fur cet article,
o u , ce qui eft plus vraifemblable, que la défenfe
de fe fervir de l’épée & de la lance à l’-égard des
ferfs, ne leur,en interdifoit que l’ufage ordinaire,
c’eft-à-dire, qu’il ne leur étoit pas permis de porter
.communément l’épée ou la lance.’ C ’eft ainft
que nous avons vu publier des ordonnances , par
lefquelles il étoit défendu de porter l’épée à ceux
qui n’étoient point gentilhommes,ou a£luellement
au fervice , ou qui n’avoient point de certains emplois
, quoiqu’il leur fût permis d’avoir chez eux
une épée ôc d’autres armes, 61 de les porter quand ils
alloient en voyage. Enfin, on peut dire encore que
cette défenfe régloit feulement les armes que les
payfans & les gens du peuple pouvoient avoir à