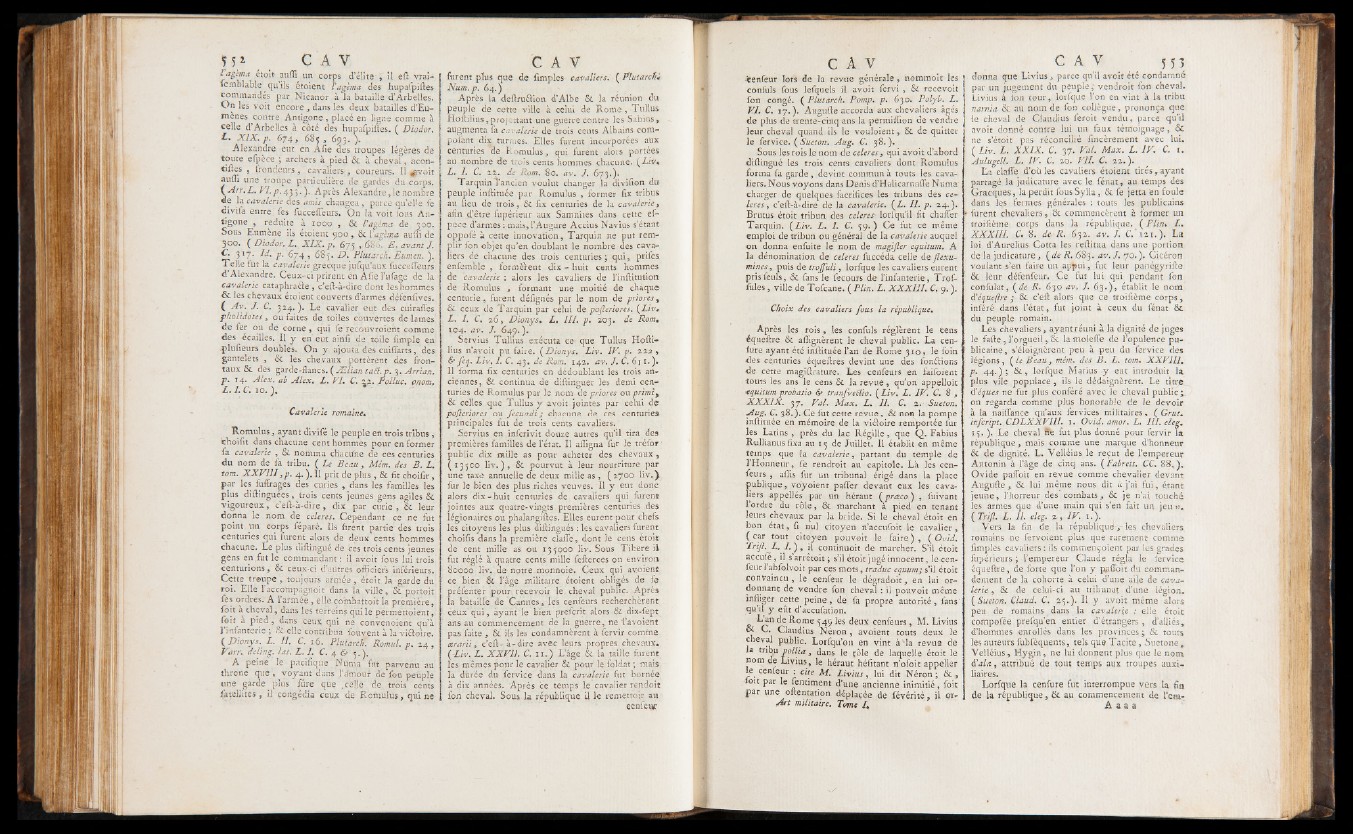
U * Ç A V
lagema étoit auffi un corps d’élite , il eft vrai-
lemblable ^ qu’ils étoient l’agèma des hupafpiftes
commandes par Nicanor à la bataille d’Arbelles.
O n les voit encore , dans les deux batailles d’Eu-
mènes contre Antigone, placé en ligne comme à
celle d’Arbelles à côté des hupafpiftes. ( Dïodor.
£. XIX. p . 6 7 4 , 68 5 /6 9 3 . )..
Alexandre eut en A fie des troupes légères de
toute efpèce ; archers à pied & à cheval, acon-
tiftes , frondeurs, cavalierscoureurs. Il ^voit
aufli une troüpe particulière de gardes du corps.
\Ar r .L. V L p. 433. ). Après Alexandre, le nombre
ee la cavalerie des amis changea, parce qu’elle le
divifa entre, fes fuccefleurs. On la voit ions An-
tigone , réduite à 1000 , & l’agèma de 300.
Sous Eumène ils étoient 900 , & Yagèrna aufii de
300. ( Diodor. L. XIX. p. 6 7 5 ,6 8 6 . E. avant J.
317- ïd. p. 674 , 685. D . Plutarch. Eumen. ).
Telle fut la cavalerie grecque jufqu’aux fuccefleurs
d’Alexandre. Ceux-ci prirent ên Afie l’ufage de la
cavalerie cataphraâe, c’eft-à-dire dont les hommes
& les chevaux étoient couverts d’armes défenfives.
( Av. J. C. 324. ). Le cavalier eut des cuirafîes
pkolidoies , ou faites de toiles couvertes de lames
de ter ou dé corne , qui fe recouvroieht comme
des écailles. Il y en eut ainfi de toile fimple en
.plufieurs doubles. On y ajouta des cuiffarts, des
gantelets , & les chevaux portèrent des frontaux
& des garde-flancs. ( Ælian taSl.p. 3. A;rrian.
p. 14. Alex, ab Alex. L. VL C, 22. Pollue. ojiom,
L. 1. C. 10. ).
Cavalerie romaine|
Romulus, ayant divifé le peuple en trois tribus ,
ichoifit dans chacune cent hommes pour en former
fa cavalerie , & nomma cHactfhe de ces centuries
du nom de fa tribu. ( Le Beau , Mêm. des B. L.
tom. X X V 111, p. 4. ). Il prit de plus , & fit çhoifir,
par les fuffragés des curies , dans les familles les
plus diftinguées, trois cents jeunes gens agiles &
vigoureux, c’eft-à-dire, dix par curie , & leur
donna le nom de celeres. Cependant ce ne fut
point Un corps féparé. Ils firent partie des trois
centuries qui furent alors de deux cents hommes
chacune. Le plus diftingué de ces trois cents jeunes
gens en,fut le commandant : il avoit fous lui trois'
centurions, & ceux-ci d’autres officiers inférieurs.
Cette troupe , toujours a rm é e é to it la garde du
roi. Elle l’accompagnoit dans la v ille , & portoit
fes ordres. A l’armée , elle çombattoit la première,
foit a cheval , dans les terreîns qui le perméttoient,
foit a p ied , dans ceux qui ne convenoient qu’à
1 infanterie ; & elle contribua foirvent à la viéloire.
( Dionys. L. II. C. 16. PluiarcK. Romul. p. 2 4 ,
Varr. deling'. lat. L. I. C. 4 & 5. ).
A peine ‘ le pacifique ' Num;a fut parvenu au
throne que , voyant dans l’amour de fon peuple
une garde plus fûre que s celle de trois cents
&tellites , il congédia ceu* de Romulus, qui ne
C A V
furent plus que de Amples cavaliers. ( Plutarchi
Num.p. 64.)
Après la deftru&ion d’Albe & la réunion du
peuple de cette ville à celui de R om e , Tullus
Hoftilius,projettant une guerre contre les Sabins
augmenta fa cavalerie de trois cents Albains com-
polànt di^ turmes. Elles furent incorporées aux
centuries de Romulus , qui furent alors portées
au nombre de trois cents hommes chacune. {Liv*
L. 1. C. 22. de Rom. 80. âv. J. 673.).
Tarquin l’ancien voulut changer la divifion du
peuple inftituée par Romulus , former fix tribus
au lieu de trois, & fix centuries de la cavalerie,
afin d’être fupérieur aux Samnites dans cette ef-
pece d’armes-.mais,l’Augure Accius Navius s’étant
oppofé à cette innovation, Tarquin ne put remplir
fon objet qu’en doublant le nombre des cavaliers
dè chacune des trois centuries ; qui, prifes
enfemble , formèrent dix - huit cents hommes
de cavalerie : alors les cavaliers de l’inftitutioiï
de Romulus , formant une moitié de chaque
centurie, furent défignés par le nom de prions,
& ceux de Tarquin par celui de pofieriores. ( Liv#
L. I. C. 26 , Dionys. Z. III. p. 203. de Rom•
104. av. J. 649.).
Servius Tullius exécuta ce que Tullus Hofti-
lius n’avoit pu faire. ( Dionys. Liv. IV. p. 222 ,
6* feq. Liv. I. C, 43. de Rom. 142. av. J. C. 6 1 1.)*
11 forma fix centuries en dédoublant les trois anciennes,
& continua de diftinguer les demi centuries
de Romulus par le nom de prions ou primi%
& celles que Tullus y avoit jointes par celui de
pofieriores ou fecundi ; chacune de ces centuries
principales fut de trois cents cavaliers.
Seryius en inferivit douze autres qu’il tira des
premièrès familles de l’état. Il afligna fur le tréfor ;
public dix raille as pour acheter des chevaux,
( 13500 l i v . ) , & pourvut à leur nourriture par
une taxe annuelle de deux mille a s , ( 2700 liv. )
fur le bien des plus riches veuves. Il y eut donc
alors dix-huit centuries de cavaliers qui furent
jointes aux quatre-vingts premières centuries des
légion aires ou phalangiftes. Elles eurent pour chefs
les citoyens les plus diftingués : les cavaliers furent
choifis dans la première clafle, dont le cens étoit
de cent mille as ou 135900 liv. Sous Tibere il
fut réglé à quatre cents mille fefterces ou environ
80000 liv. de notre monnoie. Ceux qui avaient
ce bien & l’âge militaire étoient obligés de fe
préfenter pour, recevoir le cheval public. Apres
la bataille de Cannes, les cenfeurs recherchèrent
ceux'qui , ayant le bien preferit alors •&. dixdept
ans au commencement de la, guerre, ne Tàvoient
pas faite , & ils les condamnèrent à fervir comine
eerarii 3 c’e ft-à-dire avec leurs propres chevaux*
{-Liv. L. XXVIL C. 1 1 .) L’âge & la taille furent
les mêmes pour le cavalier &. pour le foldat ; mais
la durée du fervice dans la cavalerie fut bornée
à dix années. Après ce temps le cavalier rendoit
fon' cheval. Sous la république il le remettoit au
eenfeujr
c A v
-fcenfeur lors de la revue générale, nommoit les
confuls fous lefquels il avoit fervi , & recevoit
fon congé. ( Plutarch. Pomp. p. 630. Polyb. L.
VI. C. 17 .) . Augufte accorda aux chevaliers âgés
de plus de trente-cinq ans la permiflion de vendre
leur cheval quand ils le vouloient, & de quitter
le fervice. ( Sueton. Aug. C. 38. ).
Sous les rois le nom de celeres3 qui avoit d’abord
diftingué les trois cents cavaliers dont Romulus
forma fa garde, devint commun à touts les cavaliers.
Nous voyons dans Denis d’Halicarnafîe Numa'
charger de quelques facrifices les tribuns des celeres
, c’eft-à-dire de la cavalerie. (Z . II. p. 24.).
Brutus étoit tribun des celeres lorfqu’il fit chaffer
Tarquin. {Liv. L. 1. C. 59.) Ce fut ce même
emploi de tribun ou général de la cavalerie auquel
on donna enfuite le nom de magifier equitum. A
la dénomination de celeres fuccéda celle de flexu-
mines, puis de trojfuli, lorfque les cavaliers eurent
prisfeuls, & fans le fecours de l’infanterie, Trof-
fules, ville de Tofcane. ( P lin. L. XXXIII. C, 9. ).
Choix des cavaliers fous la république.
Après les rois, les confuls réglèrent le Cens
équeftre & alignèrent le cheval public. La cen-
lure ayant été inftituée l’an de Rome 310, le foin
des ce.nturies équeftres devint une des fondions
de cette magiftrature. Les cenfeurs en faifoient
touts les ans le cens & la revue, qu’on appelloit
'equitum probatio & tranfvettio. { Liv. Z. IV. C. 8 ,
XXXIX. 37. Val. Max. L. 11. C. 2. Sueton.
•Aug. C. 3#.). Ce fut cette revue, & non la pompe
inftituée en mémoire de la viéloire remportée fur
les Latins , près du lac Régille, que Q . Fabius
Rullianus fixa au 15 de Juillet. Il établit en même
temps que la cavalerie, partant du temple de
l’Honneur, fe rendroit au capitole. Là les cenfeurs
, affis fur un tribunal érigé dans la place
publique, voyoient pafler devant eux les cavaliers
appellés par un héraut {p ra coy , fuivant
1 ordre du rôle, & marchant à pied en tenant
leurs chevaux par la bride. Si le cheval étoit en
bon état, fi nul citoyen n’accufoit le cavalier ,
( car tout citoyen pouvoit le faire ) , ( Ovid.
Trifi. L. I. ) , il continuoit de marcher. S’il étoit
accufe, il s’arretoit ; s’il étoit jugé innocent, le cen-
feurl abfolvoit par ces mots, traduc equum3 s’il étoit
convaincu, le cenfeur le dégradoit, en lui ordonnant
de vendre fon cheval : il pouvoit même
infliger cette peine, de fa propre autorité, fans
qu’il y eut d’accufation.
L an de Rome 549 les deux cenfeurs, M. Livius
et C. Claudius Néron, avoient touts deux le
cheval public. Lorfq u’011 en vint à 4a revue de
la tribu pollia 3 dans le çôle de laquelle étoit le
nom de Livius , le héraut héfitant n’ofoit appeller
le cenfeur : cite M. Livius 3 lui dit Néron; & 3
-loit par le ffintiment d’une ancienne inimitié, foit
par une oftentation déplacée de févérité, il oi>
Art militaire. Tome ƒ.
c A V 553
donna que Livius , parce qu’il avoit été condamné
par un jugement du peuple,' vendroit fon cheval.
Livius à Ion tour, lorfque l’on en vint à la tribu
narnia & au nom de fon collègue, prononça que
le cheval de Claudius feroit vendu, parce qu’il
avoit donné contre lui un faux témoignage, &
ne s’étoit pas réconcilié fincèrement avec lui.
( Liv. L. XXIX. C. 37. Val. Max. L. IV. C. 1.
Aulugell. L. IV. C. 20. VIL C. 22. ).
La clafle d’où les cavaliers étoient tirés,ayant
partagé la judicature avec le fénat, au temps des
Gracques, la perdit fous S ylla, & fe jetta en foule
dans les fermes générales : touts les publicains
furent chevaliers, & commencèrent à former un
troifième corps dans la république. > ( Plin> Z.
XXXIII. C. 8. de-‘ R. 632. av. J. C. * 121. ). La
loi d’Aurelius Cotta les reftitua dans une portion
de la judicature, {de R. 683. av. J. 70.). Cicéron
voulant s’en faire un appui, fut leur panégyrifte
ôt leur défenfeur. Ce fut lui qui pendant fon
confulat, ( de R. 630 av, J. 6 3 .) , établit le nom
d’équeflre ; &. c’eft alors que ce troifième corps,
inféré dans l’é tat, fut joint à ceux du fénat ÔC
du peuple romain.
Les chevaliers, ayantréuni à la dignité de juges
le fafte, l’orgueil , la molefte de l’opulence pu-
blicaine, s’éloignèrent peu à peu du fervice des
légions, {le Beau3 mém. des B . L. tom. XXV1I1.
p. 44. ) ; & , lorfque Marius -y eut introduit la
plus vile populace, ils le dédaignèrent. Le titre
d’éques ne fut plus conféré avec Je cheval public;
on regarda comme plus honorable de Je devoir
à la naiflance qu’aux fervices militaires, ( Grut.
infcript. CDLXXVllI. 1. Ovid. amor. Z. III. eleg.
15. ). Le cheval flfe fut plus donné pour fervir la
république, mais comme une marque d’honneur
& de dignité. L. Yelléius le reçut de l’empereur
Antonin à l’âge de cinq ans. {Fabreit. CC. 88,).
Ovide paflôit en revue comme chevalier devant
Augufte, & lui même nous dit « j ’ai fui, étant
jeune, l’horreur des combats, & je n’ai touché
les armes que d’une main qui s’en fait un jeu ».
{Trifi. L. 11. eleg. 2 , IV. 1.). ,
Vers la fin de la républiques les chevaliers
romains ne fervoient plus que rarement comme
fimples cavaliers; ils commençoient par les grades
fupérieurs ; l’empereur Claude régla le lervice
équeftre, de forte que l’on y paftoit du commandement
de la cohorte à celui d’une aile de cavalerie
, & de celui-ci au tribunat d’une légion.
( Sueton. Claud. C. 25.). Il y avoit même alors
peu de romains dans la cavalerie : elle étoit
compofée prefqu’en entier d’étrangers , d’alliés,
d’hommes enrollés dans les provinces ; & touts
les auteurs fubféquents, tels que Tacite , Suetone,
Velléius, Hygin, ne lui donnent plus que le nom
d’a la , -attribué de tout temps aux troupes auxiliaires.
Lorfque la cenfure fut interrompue vers la fin
de la république, & au commencement de l’em-
A a a a