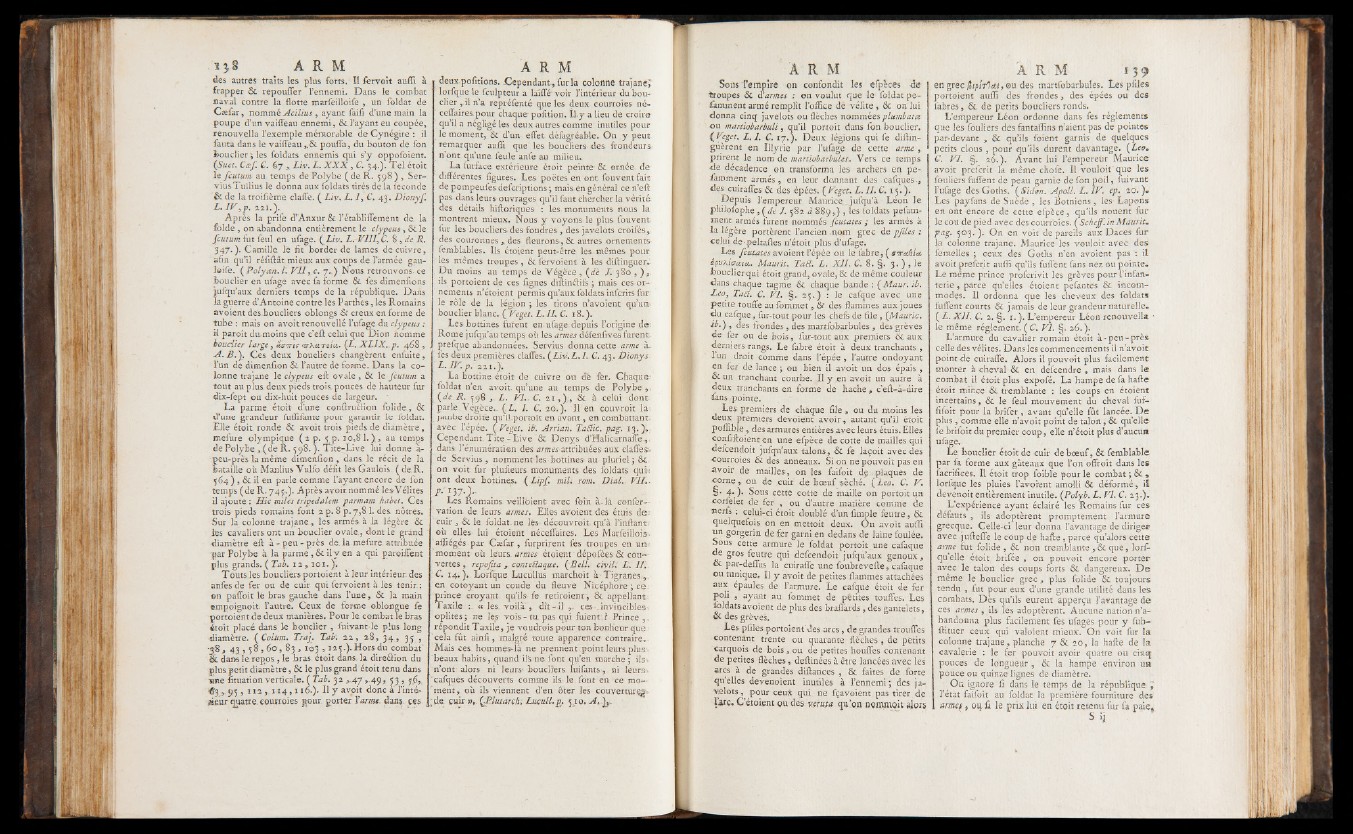
des autres traits les plus forts. Il iervoît aufli à
frapper 8c repoulfer l’ennemi. Dans le combat
naval contre la flotte marfeilloife , un foldat de
Cæfar, nommé Acilius , ayant fâifl d’une main la
poupe d’un vaifleau ennemi, 6c Payant eu coupée,
renouvella l’exemple, mémorable de Cynégire : il
fauta dans le vaifleau ,.5c pouffa, du bouton de fon
bouclier ; les foldats ennemis qui s’y oppofoient.
(Suet. Ctéf. C. 67 ,, Liv. L. X X X , C. 34.). T e l étoit
le fcutum au temps de Polybe ( de R. 598 ) , Ser-
vius Tullius le donna aux foldats tirés de la leconde
& de latroiflème clafle. ( Liv. L. 1, C. 43. Diotvyf.
L . lV ,p . 221.)..
Après la prife d'Anxur ôc l’établiflement de la
folde , on abandonna entièrement Le clypeus, 6c le
fcutum fut feul en ufage. { Liv. L.-V11I , C. 8 , de R.
347*)• Camille le fit border de lames de cuivre,
afin qu’il réfiflât mieux aux coups de l'armée gau-
loife. ( Polyeen. L V I I , c. 7..} Nous retrouvons, ce
bouclier en ufage avec fa forme 6c fes dimenfions
jufqu’aux derniers temps de la république. Dans
la guerre d’Antoine contre les Parthes, les Romains
avoient de's.boucliers oblongs 6f creux en forme de
tube : mais on avoit renouvellé l’ufage du clypeus :
il paroît du.moins que c’eft celui que Dion nomme
bouclier large, acrriç 'srhetTêia. (L .X L lX ,.p . 468 ,
A . B. ). Ces deux boucliers changèrent enfuite,
l’un de dimenfion 6c l’autre de fowne. Dans la colonne
trajane le clypeus eft ovale , ôc le fcutum a
tout au plus deux pieds trois, pouces de hauteur fur
dix-fept ou dix-huit pouces-de largeur. *
La parme étoit d’une conflruaion folide., ÔC
d’une grandeur fuffifante pour garantir le foldat.
Elle étoit ronde 6c avoit trois pieds de diamètre,
mefure olympique (2 p. 5 p. 10,81. )., au temps
de P o lyb e ,(d e R. 598. ). Tite-Live lui donne à-
• peu-près la même dimenfion , dans le récit de la
bataille oîi Manlius Vulfo défit lès Gaulois. ( de.R.
564) , 6c il en parle comme l’ayant encore de fon
temps (de R. 74 5>). Après avoir.nommé les-Vélites
il ajoute. : Hic mile's tripedalem parmam habet. Ces
trois pieds romains font 2 p. 8 p. 7,8 1. des nôtres.
Sur la colonne trajane, les armés à .la légère 6c
les cavaliers ont un bouclier ovale., dont le grand
diamètre eft à -p e u -p r è s de.là mefure.attribuée
par Polybe à la parme, 6c i l y en a qui paroiflent
plus grands. ( Tab. 12,101« ).
Touts.les boucliers portoient à leur intérieur, des
anfes de fer ou de cuir qui fervoient à.lès tenir.:
©n pafîoit lè bras gauche dans l’une, 6c là main
empoignoit. l’autre. Ceux de forme oblongue fe
portoient.de deux manières. Pour le combat le bras
étoit placé dans le bouclier , fuivant le plus long
diamètre. ( Colüm. Traj. Tab: 22 , 28, 34,, 35 ,
•38 , 4 3 ,5 8 ,6 0 , 8 3 ,10 3 ,12 5 .) . Hors du combat’
Ôc dans le. repos , le hras étoit dans, la direâion du
plus petit diamètre, ôc le plus grand étoit tenu dans
■ Hiie fituation verticale. ( Tab. 32 „4 7 ,.49, K y , 56,,
^3 »• 95 9 1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 6 .) . Il y avoit donc a î’inté-
âeur quatre, courroies pour porter Y arme dans, ces
deux pofitïons. Cependant, fur la colonne trajane^
lorfque le fculpteur a laiffé- voir l’intérieur du bouclier
, il n’a repréfenté que les deux courroies né-
çeflaires.pour chaque: pofition. îl.y a lieu de croire
qu’il a négligé les deux autres comme inutiles pour
le moment, 6c d’un effet défagréable. On y peut
remarquer aufli que les boucliers des frondeurs
n’ont qu’une feulé anfe au milieu.
La furface extérieure étoit peinte- 6c ornée de
différentes figures. Les poètes en ont- fouvent fait
de pompeufes deferiptions ; mais en général ce n’eft
pas dans leurs ouvrages qu’il faut chercher la vérité
des, détails hiftoriques : les monuments nous la
montrent mieux. Nous y voyons le plus fouvent
fur les boucliers, des foudres , des javelots croifés,
des couronnes des fleurons, Ôc autres ornements
femblables.. Ils étoient peut-être les mêmes pour
les mêmes troupes , 6c l'ervoient à les diftinguer.
Du moins au temps de Yégè'ce, (de L 380 , ) , .
ils portoient d.e ces Agnes diftin&ifs ; mais ces ornements
n’étoient permis qu’aux foldats inforits fur
le rôle de la légion ; les tirons n’avoient qu’uit
bouclier blanc. ( Veget. L .IL C. 18. ).
Les bottines furent en ufage depuis l’origine de:
Rome jufqu’au temp$où les armes défenfives furent-
prefque abandonnées. Servius donna cette arme à-
fes deux premières clafles. (LH.L.I..Ç. 43. Dionys
L .lV .p . 221.),
La bottine, étoit de cuivre ou dè fër. Chaque:
foldat n’en avoit. qu’une au temps de Polybe ,,
(de R. 598 L. VL. C. 2 1 , )., 6c .à celùi dont:
parle. Végèce- ( L. 1. C. 20. ). Il en couvroit la
jambe droite qu’il:portoit en avant, en combattant.:
avec l’épée. (, Veget. ïb\ Arrian. Ta Rie. pag. 13 .).
Cependant. Tite - Live ôc Denys d’Halicarnafle.,.
dans; l’énumérati@n des ^rmer attribuées aux clafles1*
de Servius , nomment les-bottines-au pluriel ; 6c.
on voit: fur plufieurs monuments des foldats qui!
ont deux bottine^. ( Lipf. mili rom. Dial. VIL.
P‘ 13.7* )•* ; *
Les R omains veillôienf avec foin à-là eonfer—
vation de. leurs armes. Elles avoient des étuis de-'
cuir , Ôc le foldat. ne les découvroit. qu’à Pinflant-
où elles- lui étoient néceffaires. Les Marfeillois-
alfiégés - par Cæfar , furprirent fés troupes en un*
moment où leurs, armes étoient dépofées ôc couvertes
,. repofta 9: conte Raque. ( Bell. civiL L. I L .
C. 14. ). Lorfque Lucullus marchoit à-Tigranes., .
en côtoyant un coude du fleuve Nicéphore ; ce.
prince croyant qu’ils fe retiroient, 6c appellant;
Taxile ; « les. v o ila , d it - il ,. ces-.invincibles-,
oplites; ne les- vois-tu. pas qui fuient;? Prince ,*
répondit Taxile, je voudrois pour ton bonheur que
cela fût ainfi, malgré toute apparence contraire»
Mais ces hommeslà ne prennent point leurs plus-
beaux habits, quand ils.-ne..font qu’en marche; ils>.
n’ont: alors ni leurs' boucliers, luifants , ni leurs; I'cafques découverts comme ils le. font en ce m o -
^ment, où ils viennent d’en ôter les couverture^-
'd e cuir»,. QPlutarch; Lucull.p\. 5^10. A , ^
Sous fempire on confondit les efpèces de
troupes 6c & armes : on voulut que le foldat pe-
fàmment armé remplît l’office dè vélite , 6c on lui
donna cinq javelots ou flèches nommées plumbatee
©u martiobarbuli, qu’il portoit dans fon bouclier.
{ Veget, L . l. C. 17. }. Deux légions qui fe diftin-
guèrent en Illyrie par l’ufage de cette arme ,
prirent le nom de martiobarbules. Vers ce temps
•de décadence on transforma les archers en pe-
famment armés, en leur donnant des cafques.,
des cuirafîes 6c des épées. ( Veget. L. 11. C. 15. ).
Depuis l’empereur Maurice iufqu’à Leon le
philofophe, ( de J. 582 à 889,) , les foldats pefam-
ment armés furent nommés feutates ; les armés à
la légère portèrent l’ancien nom grec de pfdes :
•celui de'.peltaftes n’étoit plus d’ufage.
Les feutates avoient l’épée ou le fabre, ( errcRRa,
epvhicciict,. Maurit. TaR. L. XII. C. 8. §. 3. ) , le
bouclier qui étoit grand, ovale, Ôc de même couleur
dans chaque tagme 6c chaque bande : ( Maur. ib.
Léo, TaR. Ç. VI. § . 25 .) : le cafque avec une
petite touffe au fommet, 6c des flammes aux joues
du cafque., fur-tout pour les chefs de file , (Mauric.
ib.) , des frondes , des martfobarbules., des grèves
de fer ou de bois, fur-tout aux premiers 6c aux
derniers rangs. Le fabre étoit à deux tranchants ,
1 un droit comme dans l’épée , l’autre ondoyant
en fer de lance ; ou bien il avoit un dos épais ,
©Cun tranchant courhe. Il y .en avoit un autre à
deux .tranchants en forme de hache , c’eft-à-dire
fans pointe.
Les premiers de chaque file , ou du moins les
deux premiers dévoient avoir, autant qu’ il étoit
poffible, des armures entières avec leurs étuis. Elles
confiftoienten une efpèce de cotte de mailles qui
defeendoit jufqu’aux talons, 6c fe laçoit avec des
©Qurroies Ôc des anneaux. Si on ne pouvoit pas en
avoir de mailles, on les faifoit dp . plaques de
corne, ou de .cuir de boeuf séché. ( Léo. C. V.
§• 4* )• Sous cette cotte de maille on portoit un
corfelet de fer , ou d’autre matière comme de
nerfs : celui-ci étoit doublé d’un Ample feutre, 6c
quelquefois on en meitoit deux. On avoit aufli
gorgerin de fer garni en dedans de laine foulée.
Sous cette armure le foldat portoit une cafaque
de gros feutre qui defeendoit jufqu’aux genoux,
6c par-defîùs la cuiraiïe une foubrevefte, cafaque
ou tunique. Il y avoit de petites flammes attachées
aux épaulés de l’armure. Le cafque étoit de fer
poli ayant au fommet de pêtites touffes. Les
foldats avoient de plus des braflàrds, des gantelets,
& des grèves.
Les pfiles portoient'des arcs, de grandes troufles
contenant trente ou quarante flèches , de petits,
carquois de bois, ou de petites houffes contenant
de petites flèches, deftinées à être lancées avec les
arcs à de grandes diftances , 6c faites de forte
qu’elles devenoient inutiles à l’ennemi; des javelots,
pour ceux qui ne fçavoient pas tirer de
Lare. C ’éîoient ou des v.eruta qu’on noromoit alors
en grec ^iplr'lcu, ©u des martfobarbules. Les pfiles
portoient aufli des frondes, des épées ou des
labres, 6c de petits boucliers ronds.
L’empereur Léon ordonne dans fes réglements
que les fouliers des fantaflins n’aient pas de pointes
par-devant , 6c qu’ils foient garnis de quelques
petits clous , pour qu’ils durent davantage. (Léo.
G. VI. i§. 26.). Avant lui l'empereur Maurice
avoit preferit la même chofe. Il vouloir que les
fouliers fuflent de peau garnie de fon p o il, fuivant
l’ufage des Goths. ( Sidon. Apoll. L. IV. ep. 20. ).
Les payfans de Suèdè , les Botnie-ns, les Lapons
en ont-encore de cette efpèce, qu’ils nouent fur
le cou de pied avec des courroies. (Schejf. in Maurit.
pag. 503. ). On en voit de pareils aux Daces fur
la colonne trajane. Maurice les vouloit avec des
femelles ; ceux des Goths n’en avoient pas : il
avoit prefcr.it aufli qu’ils fuflent fans nez ou pointe.
Le même prince proferivit les grèves pour l’infanterie
, parce qu’elles étoient pefantes 6c incommodes.
Il ordonna que les cheveux des foldats
fuflent courts 6c jamais de leur grandeur naturelle.
( L. XII. C. 2. 1. ). L’empereur Léon renouvella •
le même réglement. (C . VI. §. 26.).
L’armure du cavalier romain étoit à-peu-près
celle des vélites. Dans les commencements il n’avoit
point de cuirafle. Alors il pouvoit plus facilement
monter à cheval 6c en defeendre , mais dans le
combat il étoit plus expofé. La hampe de fa hafte
étoit mihçe 6c tremblante : les coups en étoient
incertains, Ôc le feul mouvement du cheval fuf-
fifoit pour la brifer, avant qu’elle fût lancée. De
plus , comme elle n’avoit point de talon, 6c qu’elle
fe brifoit du premier coup, elle n’étoit plus d’aucun
ufage.
Le bouclier étoit de cuir de boeuf, 8c femblable
par fa forme aux gâteaux que l’on offroit dans les
lacrifices. Il étoit trop foible pour le combat ; 6c ,
lorfque les pluies l’avorent amolli 6c déformé, il
devenoit entièrement inutile. (Polyb. L. VI. C. 23.).
L’expérience ayant éclairé les Romains fur ces
défauts , ils adoptèrent promptement l’armure
grecque. Celle-ci leur donna l’avantage de dirige*
avec juftefle le coup de hafte , parce qu’alors cette
arme fut folide , 6c non tremblante^6c que, lorsqu'elle
étoit brifée , on pouvoit encore porter
avec le talon des coups forts 8c dangereux. D e
même le bouclier gre*c , plus folide 6c toujours
tendu , fut pour eux d’une grande utilité dans les
combats. Dès qu’ils eurent apperçu l’avantage de
ces armes, ils les adoptèrent. Aucune nation n’abandonna
plus facilement fes ufages pour y fub-
ftituer ceux qui valoient mieux. On voit fur la
colonne trajane, planche 7 6c 20, la hafte de la
cavalerie : le fer pouvoit avoir quatre ou cinq
pouces de longueur , 6c la hampe environ un
pouce ou quinze lignes de diamètre.
On ignore fl dans le temps de la république ,
l’état faifoit au foldat la première fourniture des
aw e f, ou fi le prix lui en étoit retenu fur fa paie$
S ij