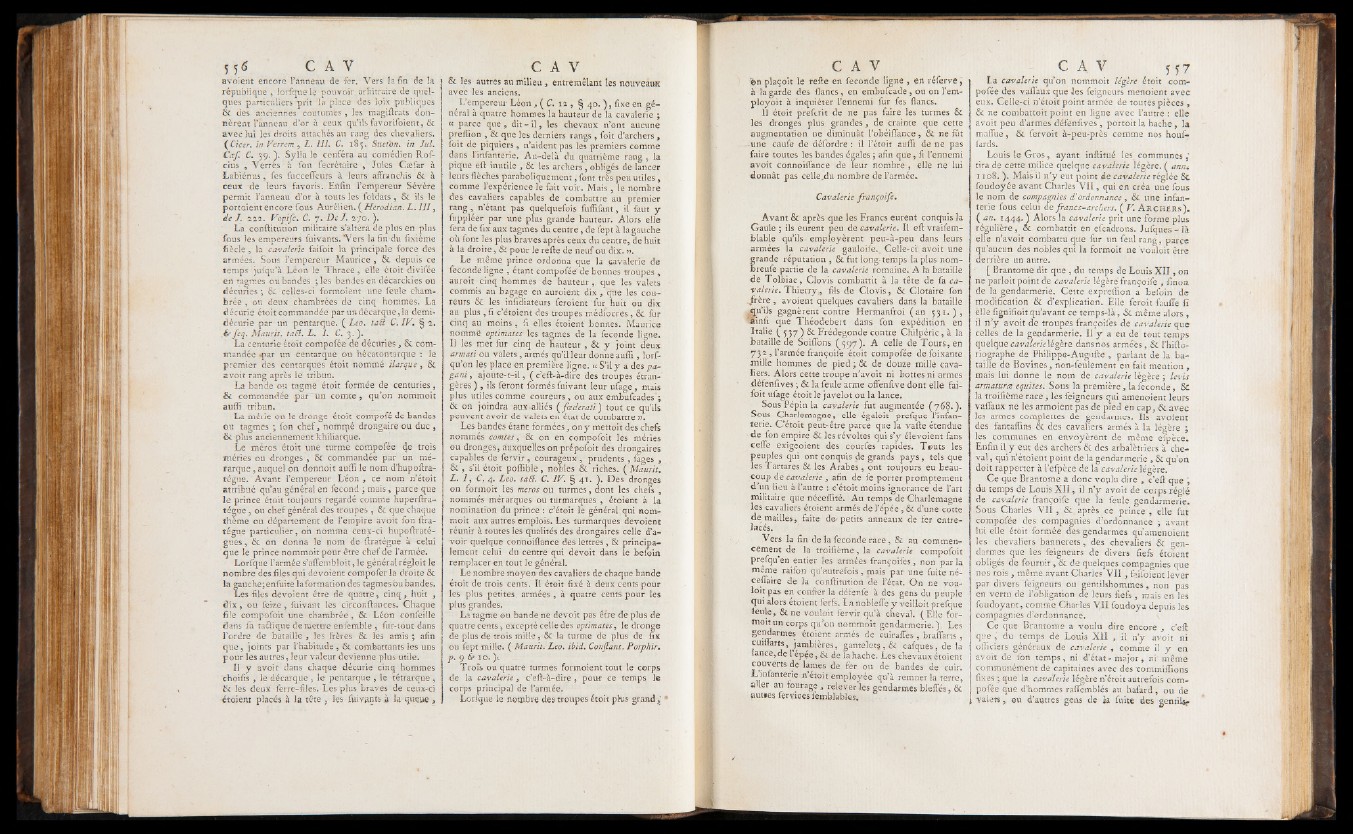
avoient encore l’anneau de fer. Vers la fin de la
république , lorfquele pouvoir arbitraire de quelques
particuliers prit la place des loix publiqyes
8c des anciennes coutumes , les magiftrats donnèrent
l’anneau d’or à ceux qu’ils favorifoient, &
avec lui les droits attachés au rang des chevaliers.
( Cicer. inVerrem, L. HL C. 185. Sue ton. in Jul.
Ccef. C. 39. ). Sylla le conféra au comédien Rof-
cius , Verrès à fon fçcrétaire , Jules Cæfar à
Labiénus, fes fuceeffeurs à leurs affranchis 8c à
ceux de leurs favoris-Enfin l’empereur Sévère
permit l’anneau d’or à touts les-foldats, & ils le
portaient encore fous Aurélien. ( Herodian. L. I I I ,
de 7. 2.22. Vopifc. C. 7. De J. 270. ).
La conftitution militaire s’altéra de plus en plus
fous les empereurs fuivants. V ers la fin'du fixième
fiècle , la cavalerie faifoit la principale force des
armées. Sous l’empereur Maurice , & depuis ce
temps jufqu’à Léon le Thrace, elle étoit divifée
en tagmes ou bandes ; les bandes en décarckies ou
décuries ; & celles-ci formoient une feule cham-.
ferée , ou deux chambrées de cinq hommes. La
décurie étoit commandée par un décarque, la demi-
décurie par un pentarque. ( Léo. ta6l C. IV. § 2.
.& feq. Maurit. tait. L. L C. 3. ).
La centurie étoit compofée de décuries , & commandée
«par un centarque ou hécatontarque : le
premier des centarques étoit nommé ilarque , 8c
avoit rang après le tribun.
La bande ou tagme étoit formée de centuries,
& commandée -par'Un comte , qu’on nommoit
suffi tribun.
La mérie où le dronge étoit compofé de bandes
ou tagmes ; fon chef, nommé drongaire ou duc ,
& plus anciennementdthiliarque.
Le méros étoit une turme compofée de trois
méries ou 'dronges , & commandée par un Hiérarque
, auquel ç>n donnoit auffi le nom d’hupoftra-
tégue. Avant l’empereur Léon , ce nom n’étoit
attribué qu’au général en fécond ; mais , parce que
le prince étoit toujours regardé comme huperftra-
tégue, ou chef général des troupes , 8c que chaque
thème ou département de l’empire avoit fon ftra-
tégue particulier, on nomma ceux-ci hupoftraté-
gues, & on donna le nom de ftratégue à celui
que le prince nommoit pour être chef de l’armée.
Lorfque l’armée s’aflembloit, le général régloit le
nombre des.files qui dévoient compofer la droite 8c
la gauche; enfuite laformation des tagmes bu bandes.
Les files dévoient être de quatre, cinq , huit ,
d ix , ou feize , fuivant les circonftances. Chaque
file compofoit une chambrée , & Léon confeille
dans ia taélique de mettre enfemble , fur-tout dans
l'ordre de bataille , les frères & les amis ; afin
que, joints par l’habitude , 8c combattants les uns
pour les autres, leur valeur devienne plus utile.
Il y avoit dans chaque décurie cinq hommes
choifis , le décarque , le pentarque , le tétrarque ,
8c les deux Terre-files. Les plus braves de ceux-ci
étaient placés à la tête ? les fuivaçts à la queue >
& les autres au milieu, entremêlant les nouveau«
avec les anciens.
L’empereur Léon , ( C. 12 , § 40. ) , fixe en général
à quatre hommes la hauteur de là cavalerie ;
<t parce que , dit - i l , les chevaux n’ont aucune
preffion , 8c que les derniers rangs , foit d’archers ,
foit de piquiers , n’aident pas les premiers comme
dans 1 infanterie. Au-delà du quatrième rang, la
pique eft inutile , 8c les archers, obligés de lancer
leurs fléchés paraboliquement, font très peu utiles ,
comme l’expérience le fait voir. Mais , le nombre
des cavaliers capables de combattre au premier
rang, n’étant pas quelquefois fuffifant, il faut y
fuppléer par une plus grande hauteur. Alors elle
fera de fi* aux tagmes du centre, de fept à la gauche
où font les plus braves après ceux du centre, de huit
a la droite, & pour le refte de neuf ou dix. ».
Le -même prince ordonna que la cavalerie de
fécondé ligne , étant compofée' de bonnes troupes ,
auroit cinq hommes de hauteur ,. que les valets
commis au bagage en auroient dix , que les coureurs
8c les infidiateurs feroient ' fur huit ou dix
au plus , fi c’étoient des troupes médiocres , 8c fur
cinq au moins, fi elles étoient bonnes. Maurice
nommé optimales les tagmes de la fécondé ligne.
Il les met fur ciyq de hauteur , 8c y joint deux
armati ou valets, armés qu’il leur donne auffi , lorf-
qu’on les place en première ligne. « S’il y a des pa-
gani, ajoùte-t-il, ( c’eft-à-dire des troupes étrangères
) , ils feront formés fuivant leur ufage, mais
plus utiles comme coureurs , bu aux embufeades’ ;
& on joindra aux.alliés ( foederati) tout ce qu’ils
peuvent avoir de valets en état de combattre ».
Les bandes étant forméeson y mettoit des chefs
nommés comtes, & on en compofoit les méries
ou dronges, auxquelles dn prépofoit des drongaires
capables de fervir , courageux , prudents , fages ,
8c , s’il étoit poffible, nobles & riches. ( Maurit.
L. 1, C. 4. Léo. taSl. C. IV. § 41. ). Des dronges
on formoit les meros ou turmes, dont les chefs |
nommés mérarques ou turmarques , étoient à la
nomination du prince : c’étoit le général qui nommoit
aux autres emplois. Les turmarques dévoient
réunir à toutes les qualités des drongaires celle d’avoir
quelque connoifîance des lettres, & principalement
celui du centre qui devoit dans le beloin
remplacer en tout le général.
Le nombre moyen des cavaliers de chaque bande
étoit de trois cents. Il étoit fixé à deux cents pour
les plus petites, armées , à quatre cents pour les
plus grandes.
La tagme ou bande ne devoit pas être de plus de
quatre cents -, excepté celle des optimales, le dronge
de plus de trois mille, & la turme de plus de lix
ou fept mille. ( Maurit. Léo. ibid. Confiant. Porphir•
p . 9 & 10. )i
Trois ou quatre turmes formoient tout le corps
de la cavalerie, c’eft-à-dire, pour ce temps le
corps principal de l’armée.
Lorfque le nombre des troupes étoit phis grand >
fen plaçoit le refte en fécondé ligne , en réferve,
à la garde des flancs, en embufeade , ou on l’em-
ployoit à inquiéter l’ennemi fur fes flancs.
11 étoit preferit de ne pas faire les turmes 8c
les dronges plus grandes, de crainte que cette
augmentation ne diminuât l’obéiffance, 8c ne fût
—une caufe de défordre : il l’étoit auffi de ne pas
faire toutes les bandes égales ; afin que, fi l’ennemi
avoit connoiftance de leur nombre , elle ne lui
donnât pas celle,du nombre de l’armée.
Cavalerie françoife.
Avant & après que les Francs eurent conquis la
Gaule ; ils eurent peu de cavalerie. Il eft vraifem-
blable qu’ils- employèrent peir-à-peu dans leurs
armées la cavalerie gauloife., Celle-ci1 avoit une
grande réputation , ôc fut long-temps la plus nom-
breufe partie de la cavalerie romaine. A la bataille
de Tolbiac, Clovis combattit à la tête de fa cavalerie.
Thierry*, fils de Clovis, 8c Clotaire fon
/ rère, avoient quelques cavaliers dans la bataille
x[u’ils gagnèrent contre Hermanfroi (an 5 3 1 . ) ,
'âinfi. que Théodebert dans fon expédition en
Italie ( 5 37 ) & Frédegonde contre Chilpéric, à là
bataille de boiflons (5 9 7 ) . A celle de Tours, en
732 , l’armée françoife étoit compofée de foixante
mille hommes de pied ; & de douze mille cavaliers.
Alors cette troupe n’avoit ni bottes ni armes
défenfives ; & la. feule arme offenfrve dont elle faifoit
ufage étoit le javelot ou la lance.
Sous Pépin la cavalerie fut augmentée ( 768. ).
Sous Charlemagne, elle égaloit prefque l'infanterie.
C’étoit peut-être parce que la vafte étendue
de fon empire & les révoltes qui s’y élevoient fans
cefle exigeoient des courfes rapides. Teuts les
peuples qui ont conquis de grands pays, tels que
les Tartares 8c les Arabes , ont toujours eu beaucoup
de cavalerie , afin de fe porter promptement
d’un lieu à l’autre : c’étoit moins ignorance de l’art
militaire que néceffité. Au temps de Charlemagne
les cavaliers étoient armés de l’épée, 8c d’une cotte
de mailles, faite de* petits anneaux de fer entrelacés.
Vers la fin de la fécondé race, & au commencement
de la troifième, la cavalerie compofoit
prefqu’en entier les armées françoifes , non par la
meme ràifon qu’autrefois, mais par une fuite- né-
ceflarre de la conftitution de l’état. On ne vou-
loit pas en confier la défenfe à des gens du peuple
qui alors étoient ferfs. l a noblefle y veilloil prefque
ièule, 8c ne vouloit fervir qu’à cheval. (Elle formoit
un corps qu’on nommoit gendarmerie.). Les
gendarmes étoient armés de euiraffes , braflarts ,
cuiflarts, jambières, gantelets, 8c calques, de la
lance, de 1 épçe, 8c de la hache. Les chevaux étoient
couverts de lames de fer ou de bandes de cuir.
L infanterie n étoit employée qu’à remuer la terre,
aller au fourage, relever les gendarmes bleffés, 8c
çiut»es lerymes femblables.
La cavalerie qu’on nommoit légère étoit compofée
des valïaux que les feigneurs menoient avec
eux. Celle-ci n’étoit point armée de toutes pièces ,
& ne combattoit point en ligne avec l’autre : elle
avoit peu d’armes défenfives , portoit la hache, la
maflùe, & fervoit à-peu-près comme nos houf-,
lards.
Louis le Gros, ayant inftitué les communes ,
tira de cette milice quelque cavalerie légère. ( anm
1108. ). Mais il n’y eut point de cavalerie réglée 8c
foudoyée avant Charles V I I , qui en créa une fous
le nom de compagnies d'ordonnance, & une infanterie
fous celui de francs-archers. ( V. A rchers ).
( an. 1444. ) Alors la cavalerie prit une forme plus
régulière, oc combattit en efeadrons. Jufques-là
elle n’avoit combattu que fur un feulrang, parce
qu’aucun des nobles qui la formoit ne Vouloit être
derrière un autre.
[ Brantôme dit que , du temps de Louis X I I , on
ne parloit point de cavalerie légère françoife , finon.
de la gendarmerie. Cette expreffion a befoin de
modification 8c d’expjication. Elle feroit faufle fî
elle fignifioit qu’avant ce temps-là, 8c même alors ,
il n’y avoit de troupes françoifes de cavalerie que
celles de la gendarmerie. Il y a eu de tout temps
quelque cavalerie légère dansnos armées, 8c l’hifto-
riographe de Philippe-Augufte , parlant de la bataille
de Bovines, non-feulement en fait mention ,
mais lui donne le nom de cavalerie légère ; levis
armaturce équités. Sous la première, la fécondé, 8c
la troifième race , les feigneurs qui amenoient leurs
vaflaux ne les armoient pas de pied en cap, 8c avec
les armes com.plettes de gendarmes. Ils avoient
des fantaffins 8c des cavaliers armés à la légère ;
les communes en envoyèrent de même eipèce.
Enfin il.y eut des archers 8c des arbalétriers à cheval
, qui n’étoient point de la gendarmerie, 8c qu’on
doit rapporter à l’efpècé de la cavalerie légère.
Ce que Brantôme a donc voylu dire , c’eft que
du temps de Louis X I I , il n’y avoit de corps réglé
de cavalerie françoife que la feule gendarmerie.
Sous Charles V I I , 8c après ce prince , elle fut
compofée des compagnies d’ordonnance ; avant
lui elle étoit formée des gendarmes qu amenoient
les chevaliers bannerets, des chevaliers 8c gendarmes
que les feigneurs de divers fiefs étoient
obligés de fournir, & de quelques compagnies que
nos rois , même.avant Charles VII , faifoient lever
par divers "feigneurs ou gentilshommes, non pas
en vertu de l’obligation de leurs fiefs , mais en les
foudoyant, comme Charles VfI l foudoya depuis les
compagnies d’ordonnance.
Ce que Brantôme a voulu dire encore , c’eft
que , du temps de Louia XII , il n’y avoit ni
officiers généraux de cavalerie,, comme il y en
avoit de Ion temps, ni d’état - major, ni même
communément de capitaines avec des rommiffions
fixes ; que la cavalerie légère ri’étoit autrefois compofée
que d’hommes raflemblés au hafard, ou de
valets, ou d’autres gens de ia fuite des gentils