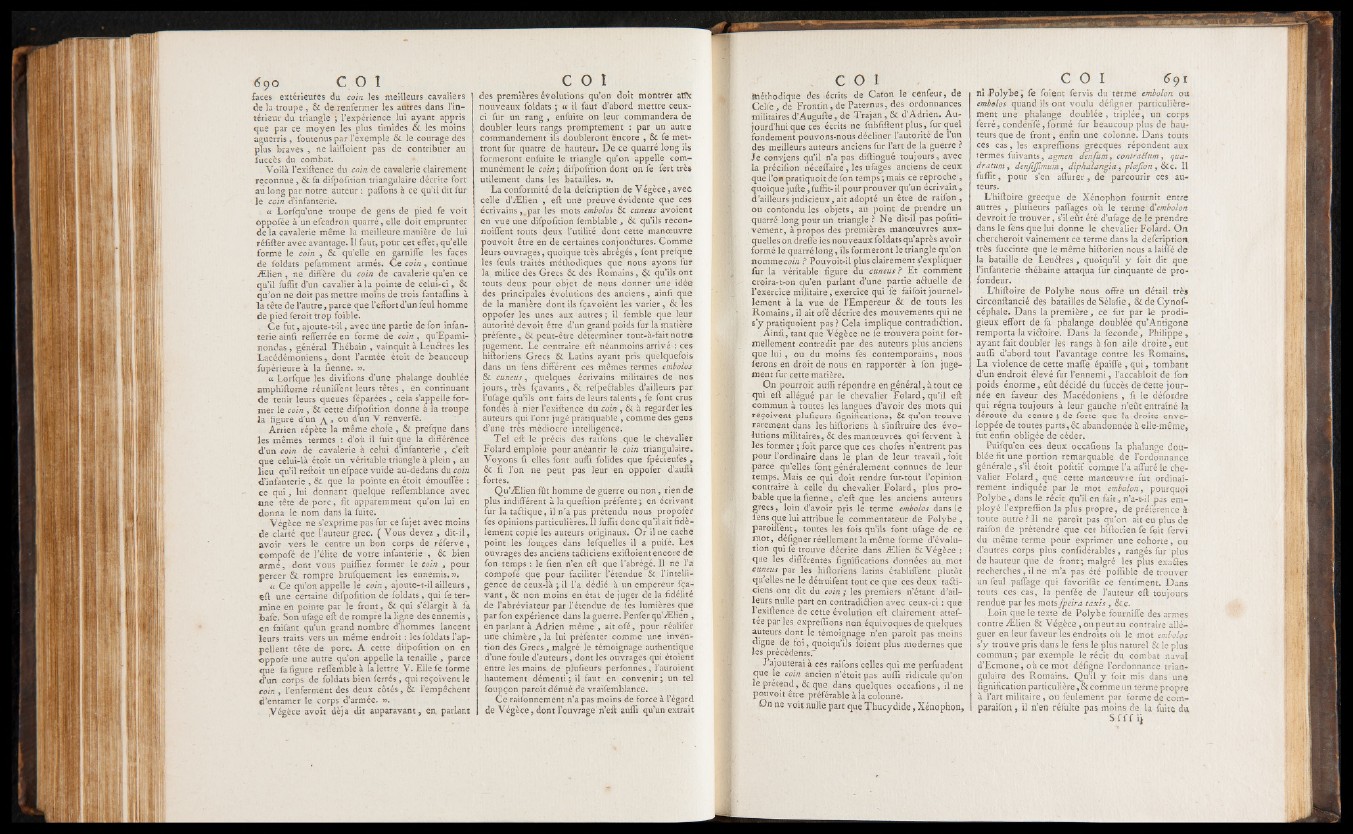
<Î90 C O I
faces extérieures du coin les meilleurs cavaliers
de la troupe , ôc de renfermer les autres dans l’intérieur
du triangle ; l’expérience lui ayant appris
que par ce moyen les plus timides oc les moins
aguerris , foutenus par l’exemple 8c le courage des
plus braves , ne laifloient pas de contribuer au
ïuccès du combat.
Voilà l’exiftence du coin de cavalerie clairement
reconnue, 8c fa difpofition triangulaire décrite fort
au long par notre auteur : paffons à ce qu’il dit fur
le coin d’infanterie.
. « Lorfqu’une troupe de gens de pied fe voit
oppofée à un efcadron quarré, elle doit emprunter
de la cavalerie même la meilleure manière de lui
réfifter avec avantage. 11 faut, pour cet effet, qu’elle
forme le coin , 8c qu’elle en garnifle les faces
de foldats pefamment armés. C e coin, continue
Ælien , ne diffère du coin de cavalerie qu’en ce
qu’il fuffit d’un cavalier à la pointe de celui-ci, 8c
qu’on ne doit pas mettre moins de trois fantafïins à
la tête de l’autre, parce que l’effort d’un feul homme
de pied feroit trop foible.
Ce fut, ajoute-t-il, avec une partie de fon infanterie
ainfi refferrée en forme de coin, qu’Epami-
nondas , général Thébain , vainquit à Leucires les
Lacédémoniens, dont l’armée étoit de beaucoup
lupérieure à la Tienne. ».
« Lorfque les divifions d’une phalange doublée
amphiftome réunifient leurs têtes , en continuant
de tenir leurs queues féparées , cela s’appelle former
le coin , 8crcette difpofition donne à la troupe
la figure d’un ou d’un V renverfé.
Arrien répète la même chofe , 8c prefque dans
les mêmes termes : d’ou il fuit que la différence
d’un coin de cavalerie à celui d’infanterie , ç’eft
que celui-là étoit un véritable triangle à plein , au
lieu qu’il reftoit un efpace vuide au-dedans du coin
d’infanterie , 8c que la pointe en étoit émouffée :
ce q u i, lui donnant quelque reffemblance avec
une tête de porc, fit apparemment qu’on lui en
donna le nom dans la fuite.
Végèce ne s’exprime pas fur ce fujet avec moins
de clarté que l’auteur grec. ( Vous deyez , dit-il,
avoir vers le centre un bon corps de réferve ,
compofé de l’élite de votre infanterie , 8c bien
armé, dont vous puiffiez former le coin , pour
percer & rompre brufquement les ennemis.».
« Ce qu’on appelle le coin , ajoute-t-il ailleurs ,
eft une certaine difpofition de foldats, qui fe.termine
en pointe par le front, & qui s’élargit à fa
bafe. Son ufage eft de rompre la ligne des ennemis,
en faifant qu’un grand nombre d’hommes lancent
leurs traits vers un même endroit : les foldats l’appellent
tête de porc. A cette difpofition on en
•oppofe une autre qu’on appelle la tenaille , parce
que fa figure reffemble à la lettre V . Elle fe forme
d’un corps de foldats bien ferrés, qui reçoivent le
coin, l’enferment des deux côtés, & l’empêchent
d’entamer le corps d’armée. ».
,Végèce avoit déjà dit auparavant, ea parlant
c o i
des premières évolutions qu’on doit montrer atte
nouveaux foldats ; « il faut d’abord mettre ceux-
ci fur un rang, enfuite on leur commandera de
doubler leurs rangs promptement : par un autre
commandement ils doubleront encore , 6c fe mettront
fur quatre de hauteur. De ce quarré long ils
formeront enfuite le triangle qu’on appelle communément
le coin ; difpofition dont on fe fert très
utilement dans les batailles. ».
La conformité de la defeription de Végèce, avec
celle d’Ælien , eft une preuve évidente que ces
écrivains,, par les mots embolos 6c cuneus avoient
en vue une difpofition femblable , 8c qu’ils recon-
noiffent touts deux l’utilité dont cette manoeuvre
pouvoit être en de certaines conjon&ures. Comme
leurs ouvrages, quoique très abrégés, font prefque
les feuls traités méthodiques que nous ayons fur
la milice des Grecs & des Romains, §c qu’ils ont
touts deux pour objet de nous donner une idée
des principales évolutions des anciens, ainfi que
de la manière dont ils fçavoiént les varier , 8c les
oppofer les unes aux autres ; il femble que leur
autorité devoit être d’un grand poids fur la matière
préfente, & peut-être déterminer tout-à-fait notre
jugement. Le contraire eft néanmoins arrivé : ces
hiftoriens Grecs 8c Latins ayant pris quelquefois
dans un fens différent ces mêmes termes embolos
8c cuneus, quelques écrivains militaires de nos
jours, très fçavants, 8c refpe&ables d’ailleurs par
l’ufage qu’ils ont faits de leurs talents, fe font crus
fondés à nier l’exiftence du coin , & à regarder les
auteurs qui l’ont jugé pratiquable , comme des gens
d’une très médiocre intelligence.
Tel eft le précis des raifons ,que le chevalier
Folard emploie pour anéantir le coin triangulaire.
Voyons fi elles font auffi folides que fpécieufes ,
8c fi l’on ne peut pas leur en oppofer d’auffi
fortes.
Qu’Ælien fût homme de güerre ou non, rien de
plus indifférent à la queftion préfente ; en écrivant
fur la taélique, il n’a pas prétendu nous propofer
fes opinions particulières. Il fuffit donc qu’il ait fidèlement
copié les auteurs originaux. Or il ne cache
point les fouaces dans lefquelles il a puifé. Les
ouvrages des anciens ta&iciens exiftoient encore de
fon temps : le fien n’en eft que l’abrégé. Il ne l’a
compofé que pour faciliter l’étendue 8c l’intelligence
de ceux-là ; il l’a dédié à un empereur fça-
vant, & non moins en état de juger de la fidélité
de l’abréviateur par l’étendue de les lumières que
par fon expérience dans la guerre. Penfer qu’Ælien -,
en parlant à Adrien même, aitofé, pour réalifer
une chimère, la lui préfenter comme une invention
des Grecs, malgré le témoignage authentique
d’une foule d’auteurs, dont les ouvrages qui étoient
entre les mains, de plufieurs perfonnes, l’auroient
hautement démenti ; il faut en convenir ; un tel
foupçon paroît dénué de vraifemblance.
Ce raifonnement n’a pas moins de force à l’égard
de Végèce, dont l’ouvrage n’eft auffi qu’un extrait
c o i
méthodique des écrits de Caton le cenfeur, de
C elle, de Frontin, de Paternus, des ordonnances
militaires d’Augufte, de Traja'n, & d Adrien, Aujourd’hui
que ces écrits ne fubfiftent plus, fur quel
fondement pouvons-nous décliner l’autorite de 1 un
des meilleurs auteurs anciens fur l’art de la guerre ?
Je conviens qu’il n’a pas diftingué toujours, avec
la précifion néceffaire, les ufages anciens de ceux
que l’on pratiquoit de fon temps ; mais ce reproche ,
quoique jufte, fuffit- il pour prouver qu’un écrivain ,
d’ailleurs judicieux, ait adopté un être de raifon ,
ou confondu les objets, au point de prendre un
quarré long pour un triangle ? Ne dit-il pas pofiti-
vement, à propos des premières manoeuvres auxquelles
on dreffe les nouveaux foldats qu’après avoir
formé le quarré long, ils formeront le triangle qu’on
nomme coin ? Pouvoit-il plus clairement s’expliquer
fur la véritable figure du cuneus? Et comment
croira-t-on qu’en parlant d’une partie aétuelle de
l’exercice militaire, exercice qui fe faifoit journellement
à la vue de l’Empereur & de touts les
Romains, il ait ofé décrire des mouvements qui ne
s’y pratiquoient pas ? Cela implique contradi&ion.
Ainfi, tant que Végèce ne fe trouvera point formellement
contredit par des auteurs plus anciens
que lu i , ou du moins fes contemporains, nous
ferons en droit de nous en rapporter à fon jugement
fur cette matière.
On pourroit auffi répondre en général,atout ce
qui eft allégué par le chevalier Folard, qu’il eft
commun à toutes les langues d’avoir des mots qui
reçoivent plufieurs lignifications, 8c qu’on trouve
rarement dans les hiftoriens à s’inftruire des évolutions
militaires, & des manoeuvres qui fervent à
les former ; foit parce que ces chofes n’entrent pas
pour l’ordinaire dans le plan de leur travail, loit
parce qu’elles font généralement connues de leur
temps. Mais ce qui doit rendre fur-tôut l’opinion
contraire à celle du chevalier Folard, plus probable
quela Tienne, c’eft que les anciens auteurs
grecs, loin d’avoir pris le terme embolos dans le
lens que lui attribue le commentateur de Polybe |
paroiffent, toutes les fois qu’ils font ufage de ce
mot, défigner réellement la même forme d’évolution
qui fe trouve décrite dans Ælien & Végèce :
que les différentes fignifications données au. mot
cuneus par les hiftoriens latins établiffent plutôt
qu’elles ne le détruifent tout ce que ces deux tacticiens
ont dit du eoin ,* les premiers n’étant d’ailleurs
nulle part en contradi&ion avec ceux-ci : que
lexiftence de cette évolution eft clairement attef-
tee par les expreffions non équivoques de quelques
auteurs dont le témoignage n’en paroît pas moins
digne de foi, quoiqu’ils loient plus modernes que
les précédents."
J ajouterai à ces raifons celles qui me perfuadent
que le coin ancien n’étoit pas auffi ridicule qu’on
le prétend, 8c que dans quelques occafions, il ne
pouvoit etre préférable à la colonne.
.Oiï ne voit nulle part que Thucydide, Xénophon,
C O I 6 9 1
ni Polybe \ fe foient fervis du terme embolon ou
embolos quand ils ont voulu défigner particulièrement
une phalange doublée, triplée, un corps
ferré, condénfé, formé fur beaucoup plus de hauteurs
que de front, enfin une colonne. Dans touts
ces cas, les expreffions grecques répondent aux
termes fuivants, agmen denfum, contrattum, qua-
dratum, denjîjjimum, diphalangia, plotjion, 8cc. Il
fuffit, pour s’en affurer , de parcourir ces auteurs.
L’hiftoire grecque de Xénophon fournit entre
autres , plufieurs paffages où le terme d'embolon
devroit fe trouver, s’il eut été d’ufage de le prendre
dans le fens que lui donne le chevalier Folard. On
chercheroit vainement ce terme dans la defeription
très fuccinte que le même hiftorien nous a laifle de
la bataille de Leuétres, quoiqu’il y foit dit que
l’infanterie thébaine attaqua fur cinquante de profondeur.
. L’hiftoire de Polybe nous offre un détail très
circonftancié des batailles de Sélafie, 8c de Cynof-
céphale. Dans la première, ce fut par le prodigieux
effort de fa phalange doublée qu’Antigone
remporta la viéloire. Dans la fécondé, Philippe ,
ayant fait doubler les rangs à fon aile droite, eut
auffi d’abord tout l’avantage contre les Romains.
La violence de cette marte épaifle , qui, tombant
d’un endroit élevé fur l’ennemi, l’accabloit de fon
poids énorme, eût décidé du fuccès de dette journée
en faveur des Macédoniens , fi le défôtdre
qui régna toujours à leur gauche n’eût entraîné la
déroute du centre ; de forte que la droite enveloppée
de toutes parts,6c abandonnée à elle-même,
fut enfin obligée de céder.
Puifqu’en ces deux occafions la phalange doublée
fit une portion remarquable de l’ordonnance
générale , s’il étoit pofitif comme l’a affuré le chevalier
Folard, que cette manoeuvre, fut ordinairement
indiquée par le mot embolon, pourquoi
Polybe, dans le récit qu’il en fait, n’a-t-il pas employé
l’expreffion la plus propre, de préférence à
toute autre ? Il ne paroît pas qu’on ait eu plus de
raifon de prétendre que cet hiftorien fe foit fervi
du même terme pour exprimer une cohorte, ou
d’autres corps plus confidérables, rangés fur plus
de hauteur que de front ; malgré les plus exa&es
recherches , il ne m’a pas été poffible de trouver
un feul partage qui favorifât ce fentiment. Dans
touts ces cas, la penfée de l’auteur eft toujours
rendue par les mots fpeira taxis , 6cc.
Loin que le texte de Polybe fournifle des armes
contre Ælien 6c Végèce, on peut au contraire alléguer
en leur faveur les endroits où le mot embolos
s’y trouve pris dans le fens le plus naturel 6c le plus
commun ; par exemple le récit du combat naval
d’Ecmone, où ce mot défigne l’ordonnance triangulaire
des Romains. Qu’il y foit mis dans une
lignification particulière, 6c comme un terme propre
à l’art militaire , ou feulement par forme de com-
paraifon, il n’en réfulte pas moins de la fuite du,
S f f f i j