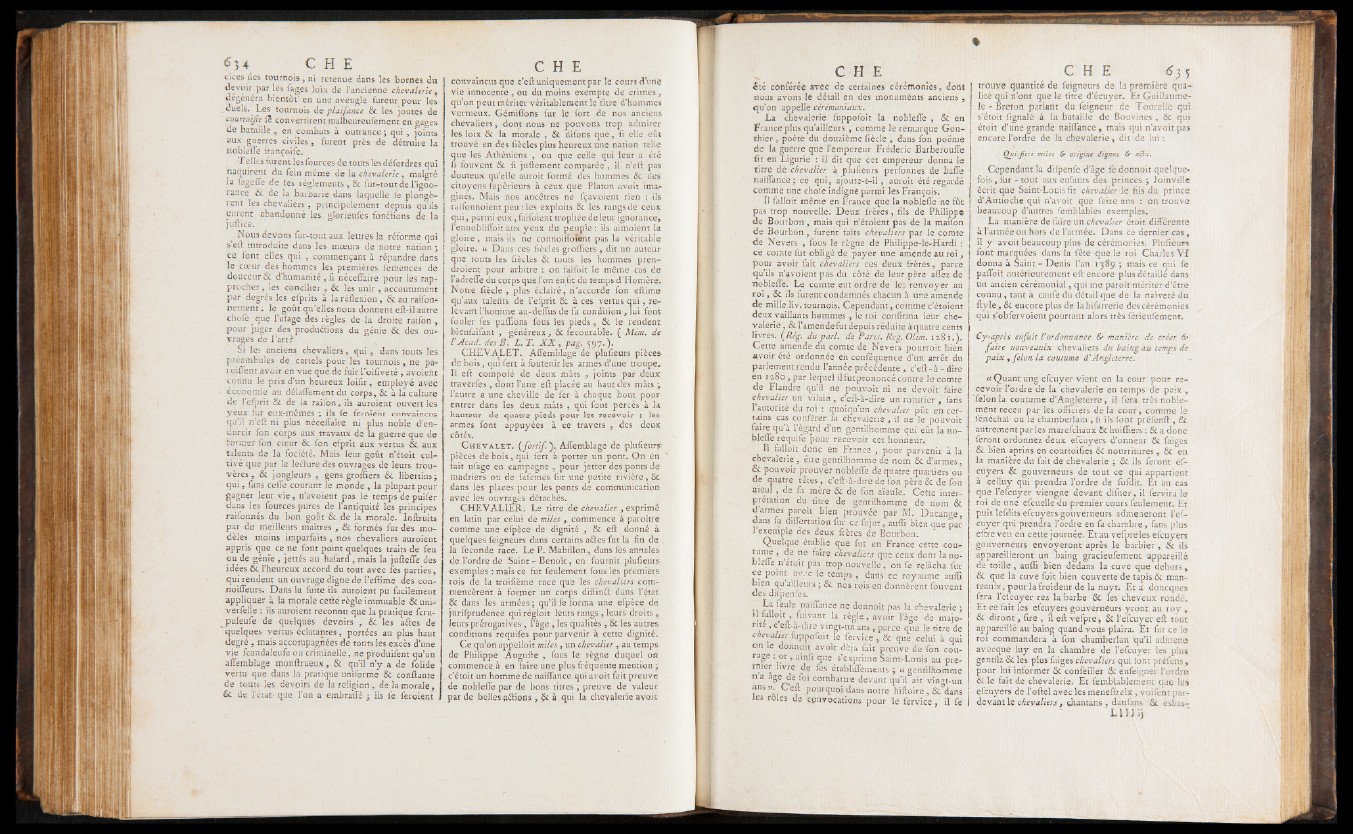
cices aes tournois , ni retenue dans les bornes du
devoir par les lages loix de l’ancienne chevalerie,
dégénéra bientôt’ en une aveugle fureur pour les
duels. Les tournois de plaifance & les joutes de
courtoijîe f l convertirent malheureufement en gages
de bataille , en combats à outrance ; q u i, joints
aux guerres civiles, furent près de détruire la
nobleffe françoife.
Telles furent les fources de touts les défordres qui
naquirent du fein même de la chevalerie, malgré
la fageffe de les réglements , & fur^tout de l’ignor-
rance & de la barbarie dans laquelle fe plongèrent
les chevaliers , principalement depuis qu’ils
eurent abandonné les gîorieufes fon&ions de la
juffice.
Nous devons fur-tout aux lettres la réforme qui
s eft introduite dans les moeurs de notre nation ;
ce font elles qui , commençant à répandre dans
le coeur des hommes les premières, femences de
douceur & d’humanité1 fi néceffaire pour les rapprocher
, les concilier , & les unir , accoutument
par degrés les efprits à la réflexion, & au raifon-
nement : le goût qu’elles nous donnent eft-il autre
chofe que l’ufage des règles de la droite raifon,
pour juger des produirions du génie & des ouvragés
de l’art?
Si les anciens chevaliers, q u i, dans touts les
préambules de cartels pour les tournois, ne pa-
roiffent avoir en vue que de fuir l’oifiveté , avoient
connu le prix d’un heureux loifir, employé avec
économie au délaffement du corps, & à la culture
de 1 efprit & de la raifon , ils auroient ouvert les
yeux fur eux-mêmes ; ils fe feroient convaincus
qu’il n’eft ni plus néceffaire ni plus noble d’endurcir
fon corps aux_ travaux de la guerre que de
former fon coeur & fon efprit aux vertus & aux
talents de la fociété. Mais leur goût n’étoit cultivé
que par la leâure des ouvrages de leurs trouvères
, & jongleurs , gens gr.omers & libertins;
q u i, fans ceffe courant le monde , la plupart pour
gagner leur v ie , n’avoient pas le temps de puifer
dans les fources pures de l'antiquité les principes
raifonnés du bon goût & de la morale. Inftruits
par de meilleurs maîtres , & formés fur des modèles
moins imparfaits , nos chevaliers auroient
appris que ce ne font point quelques traits de feu
eu de génie , jettés au hafard , mais la jufteffe des
idées &. l’heureux accord du tout avec fes parties,
qui rendent un ouvrage digne de l’eftime des con-
noiffeurs. Dans la fuite ils auroient pu facilement
appliquer à la morale cette règle immuable & uni-
verfelle : ils auroient reconnu que la pratique fcru-
puleufe de quelques devoirs , & les a&es de
quelques vertus éclatantes, portées au plus haut
degré , mais accompagnées de touts les excès d’une
vje fcandaleufe ou criminelle, ne produifent qu’un
affemblage monftrueux, & qu’il n’y a de folide
vertu que dans la pratique uniforme & confiante
de touts les devoirs de la religion, de la morale,
& de l ’état- qae l’on a embraffé ; ils fe feroient ,
convaincus que c’efl uniquement par le cours d’une
vie innocente, ou du moins exempte de crimes ,
qu’on peut mériter véritablement le titre d’hommes
vertueux. Gémiffons fur le fort de nos anciens
chevaliers, dont nous ne pouvons trop admirer
les loix & la morale , & difons que, fi elle eût
trouvé en des fiècles plus heureux une nation telle
que les Athéniens , ou que celle qui leur a été
fi fouvent & fi juftement comparée , il n’efl pas
douteux qu’elle auroi.t formé des hommes & des
citoyens fupérieurs à ceux que Platon avoît imaginés.
Mais nos ancêtres ne' fçavoient rien : ils
raifonnoient peu : les exploits & les rangs de ceux
qui, parmi eux, faifoient trophée de leur ignorance,
l’ennobliffoit aux yeux du peuple : ils aimoient la
gloire, mais ils ne connoiffoient pas la véritable
gloire. « Dans ces fiècles grofïiers , dit un auteur
que touts les fiècles & touts les hommes pren-
droient pour arbitre : on faifoit le même cas de
l’adreffe du corps que l’on en fit du temps d’Homère.
, Notre fiècle , plus éclairé, n’accorde fon eftime
qu’aux talents de l’efprit &. à ces vertus qui, relevant
l’homme au-deffus de fa condition , lui font
fouler fes pallions fous les pieds , & le rendent
bienfaifant , généreux , & fecourabïe. ( Mém. de-
VAcad, des B . L. T. X X , pag. 5 9 7 . ).
CHEVALET. Affemblage de plufieurs pièces
de bois, qui fert à foutenir les armes d’une troupe*
Il eft compofé de deux mâts joints par deux
travèrfes , dont l’une eft placée au haut des mâts ;
l’autre a une cheville de fer à chaque bout pour
entrer dans les deux mâts , qui font percés à la
hauteur de quatre pieds pour les recevoir : les
armes font appuyées à ce travers , des deux
côtés.
C h e v a l e t , ( fo r t if . ) .Affemblage de plufieurs'
pièces de bois, qui fert à porter un pont. On en
fait ufage en campagne , pour jetter des ponts de
madriers ou de fafcines fur une petite rivière, &
dans les places pour les ponts de communication-
i avec les ouvrages détachés.
; CHEVALIER. Le titre de chevalier , exprimé
en latin par celui de miles , commence à paroître
comme une efpèce de dignité , & eft donné à
quelques feigneurs dans certains aéles fur la fin de .
la fécondé race. Le P. Mabillon, dans fes annales
de l’ordre de Saint r Benoît, en fournit plufieurs
exemples : mais ce fut feulement fous les premiers
rois de la troifième race que les chevaliers commencèrent
à former un corps diftinéf dans l’état
& dans les armées; qu’il fe forma une efpèce de
jurifprudence qui régloit leurs rangs , leurs droits ,
leurs prérogatives , l’âge , les qualités , & les autres
conditions requifes pour parvenir à cette dignité.
Ce qu’on appeiloit miles, un chevalier , au temps
de Philippe Augufte , fous le règne duquel on
commence à en faire une plus fréquente mention ;
. c’étoit un homme de naiffance qui a voit fait preuve
de nobleffe par de bons titres, preuve de valeur
par de belles allions , & à qui la chevalerie avoit
%
été conférée avec de certaines cérémonies, dont
nous avons le détail en des monuments anciens ,
qu’on appelle cérémoniaux.
La chevalerie fuppofoit la nobleffe -, & en
France plus qu’ailleurs , comme le remarque Gon-
thier, poète du douzième fiècle , dans fon poëme
de la guerre que l’empereur Frédéric Barberouffe
fit en Ligurie : il dit que cet empereur donna le
titre de chevalier à plufieurs perfonnes de baffe
naiffance; ce qui, ajoute-t-il, auroit été regardé
comme une chofe indigne parmi les François.
Il falloit même en France que la nobleffe ne fût
pas trop nouvelle. Deux frères, fils de Philippe
de Bourbon, mais qui n’étoient pas de la maifon
de Bourbon, furent faits chevaliers par le comte
de Ne vers , fous le règne de Philippe-le-Hardi : j
ce comte fut obligé de payer une amende au roi , j
pour avoir fait chevaliers ces deux frères, parce
qu’ils n’avoient pas du côté de leur père affez de
nobleffe. Le comte eut ordre de les, renvoyer au
r o i, & ils furent condamnés chacun à une amende j
de mille liv, tournois. Cependant, comme c’étoient
deux vaillants hommes , le roi confirma leur chevalerie
, & l ’amendefutdepuis réduite à quatre cents
livres. (Règ. du pari, de Paris. Reg. Ohm. 12.81.).
Cette amende du comte de Nevers pourroit bien
avoir été ordonnée eh conféquence d’un arrêt du
parlement rendu l’année précédente , c’eft-à - dire
en 12.80 , par lequel il fut prononcé contre le comte
de Flandre qu’il ne pouvoit ni ne devoit faire
chevalier^ un vilain, c’eft-à-dire un roturier, fans '
Fautorite du roi : quoiqu’un chevalier pût en certains
cas conférer la chevalerie , il ne le pouvoit
faire qu’à l’égard d’un gentilhomme qui eût la rio-
bleffe requife pour recevoir cet honneur.
Il falloit donc en France , pour parvenir à la
chevalerie , être gentilhomme de nom & d’armes,
& pouvoir prouver nobleffe de quatre quartiers ou
de quatre têtes , c’eft-à-dire de fon père & de fon
aïeul , de fa mère & de fon aïeule. Cette interprétation
du^ titre de gentilhomme de nom &
d armes paroît bien prouvée par M. Ducange,
dans fa differtation fur ce fujet, auflï bien que par
1 exemple des deux frères de Bourbon.
Quelque établie que fut en France cette coutume
, de ne faire chevaliers que ceux dont la nobleffe
netoit pas trop nouvelle, on fe relâcha fur
ce point avvc le temps , dans ee royaume auflï
bien qu ailleurs ; &. nos rois en donnèrent fouvent
des difpenfes.
naiffance ne donnôit pas la chevalerie ;
il falloit , fuivant la règle, avoir l’âge de majo-
rite , c eft-a-dire vingt-un ans , parce que le titre de
chevalier fuppofoit le fervice , & que celui a qui
on fe donnoit avoit déjà fait preuve de fon cou-
raëe :,?r 5 a’n*î flue s’exprime Saint-Louis au pre-
xnier livre de fes établiffements ;’ te gentilhomme
il a âge de foi combat tre devant qu’il ait vingt-un
ans » C ’eft pourquoi dans notre hiftoire, & dans
les rôles de convocations pour 1e fervice, il fe
trouve quantité de feigneurs de la première qualité
qui n’ont que 1e titre d’écuyer. Et Guillaume-
le - Breton pariant du feigneur de Tourelle qui
s’étoit fignalé à la bataille de Bouvines , & qui
étoit d’une grande naiffance , mais qui n’avoit pas
encore l’ordre de la chevalerie, dit de lui :
Quifieri miles & origine' dignus & actu.
Cependant la difpenfe d’âge fe donnoit quelquefois,
fur - tout aux enfants des princes ; Joinville
écrit que Saint-Louis fit chevalier le fils du prince
d’Antioche qui n’avoit que feize ans : on trouve
beaucoup d’autres femblables exemples.
La manière de faire un chevalier étoit différente
à l’armée ou hors de l’armée. Dans ce dernier cas,
il y avoit beaucoup plus de cérémonies. Plufieurs
font marquées dans la fête que le roi Charles V I
donna à Saint - Denis l’an 1389 ; mais ce qui fe
paffoif antéfieurement eft encore plus détaillé dans
un ancien cérémonial, qui me paroît mériter d’être
connu, tant à caufe du détail que de la naïveté du
ftyle , & encore plus de labifarrerie des cérémonies
qui s’obfervoient pourtant alors très férieufement.
Cy-après enfuit Vordonnance & maniéré de créer 6*
faire nouveaulx chevaliers du baing au temps de
paix , félon la coutume d’Angleterre.
« Quant ung efcuyer vient en la cour pour recevoir
l’ordre de la chevalerie en temps de paix ,
félon la coutume d’Angleterre, il fera très noblement
receu par les officiers de la cour, comme le
fénéchal ou le Chamberlain , fi ils font préfenft , &
autrement par fes mai efchaux & huiflïers : & a donc
feront ordonnez deux efcuyers d’onneur & faiges
&. bien aprins en courtoifies & nourritures , & en
la manière du fait de chevalerie ; & ils feront efcuyers
& gouverneurs de tout ce qui appartient
à celluy qui prendra l’ordre de fufdit. Et au cas
que l’efcuyer viengne devant difner, il fervira le
roi de une efcuelle du premier cours feulement. Et
puis lefdits efcuyers gouverneurs admeneront l’efcuyer
qui prendra l’ordre en fa chambre, fans plus
eftreveu en cette journée. Etau vefpreles efcuyers
gouverneurs envoÿeront après le barbier , & ils
appareilleront un baing gracieufement appareillé
de toille, auflï bien dedans la cuve que dehors ,
& que la cuve foit bien couverte de tapis & man-
teaulx, pour la froideur de la nuyt. Et a' doneques
fera l’efcuyer rez la barbe & les cheveux ronde.
Et ce fait les efcuyers gouverneurs yront au roy ,
& diront, fire , il eft vefpre, & l’efcuyer eft tout
appareillé au baing quand vous plaira. Et fur ce le
roi commandera à fon chamberlan qu’il admene
avecque luy en la chambre de l’efcuyer les plus
gentilz & les plus faiges chevaliers qui font préfens ,
pour lui informer & confeiller & enfeigner l’ordre
& 1e fait de chevalerie. Et femblablement que le»
efcuyers de l’oftel avec les meneftrelx, voilent par-
devant le chevaliers, çhantans , dânfans Ôt esbas-
LlHi j