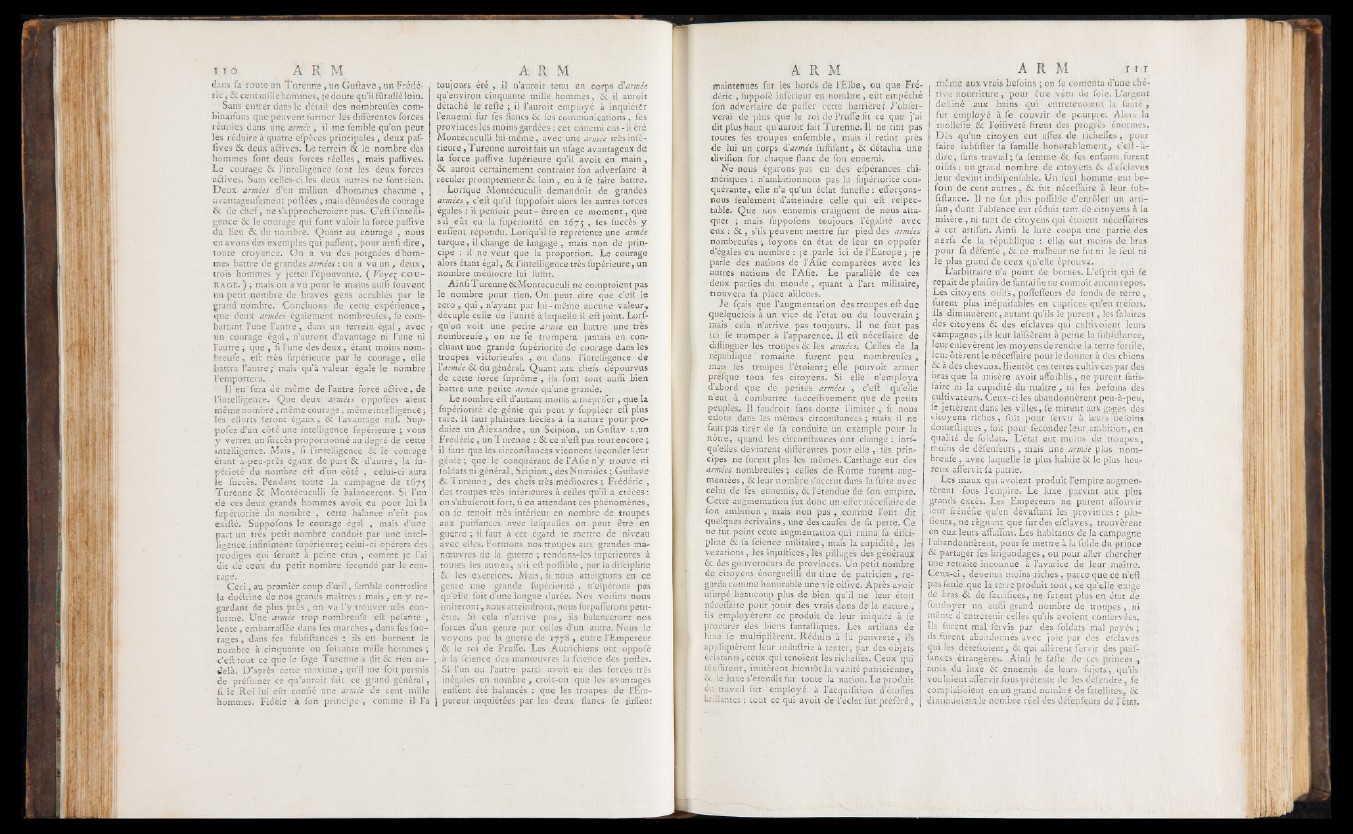
dans fa route un Turenne * un Guftave , un Frédéric,
6c cent mille hommes, je doute qu’il fût allé loin-.
Sans entrer dans le détail des nombreufes com-
binaifons que peuvent former les différentes forces
réunies dans une armée , il me femble qu’on peut
les réduire à quatre çfpèces principales , deux paf-
lives ôc deux aélives. Le terrein & le nombre des
hommes font deux forces réelles, mais paffives.
Le courage 6c l’intelligence font les deux forces
aétives. Sans celles-ci les deux autres ne font rien.
Deux armées d’un million d’hommes chacune ,
avantageufement poftées , mais dénuées de courage
6c de chef, ne s’approcheroient pas. C’eft l’intelligence
6c le courage qui font valoir la force paffive
du lieu 6c du nombre. Quant au courage , nous
en avons des exemples qui paffent, pour ainfi dire,
toute croyance. On a vu des poignées dhom-
mes battre de grandes armées : on a vu un, deux,
trois hommes' y jetter l’épouvante. ( Voye^ c o u r
a g e . ) ; mais on a vu pour le moins aulli louvent
un petit nombre de braves gens accablés par le
grand nombre. Concluons de cette expérience,
que deux armées également nombreufes, fe combattant
l’une l’autre, dans un terrein égal, avec
un courage égal, n’auront d’avantage ni l’une ni
l’autre ; que , fi l’une des deux, étant moins nom-
breufe, eft très fupérieure par le courage, elle
battra l’autre ; mais qu’à valeur égale le nombre
l’emportera.
Il en fera de même de l’autre force aéfive, de
l’intelligence. Que deux armées oppofées aient
même nombre, même courage, même intelligence ;
les efforts feront égaux, ôc l’avantage nul. . Sup-
pofez d’un côté une intelligence fupérieure ; vous
y verrez un fuccès proportionné au degré de cette
intelligence. Mais, fi l’intelligence 6c le courage
étant à-peu-près égaux de part 6c d’autre, la fu-
périoté1 du nombre eft d’un côté , celui-ci aura
le fuccès. Pendant toute la campagne de 1675
Turenne 6c Montécuculli fe balancèrent. Si l’un
de ces deux, grands hommes avoit eu pour lui la
fupériorité du nombre , cette balance n’eût pas
exifté. Suppofons le courage égal , mais d’une
part un très petit nombre conduit par une intelligence,
infiniment fupérieure; celui-ci opérera des
prodiges qui feront à peine crus , comme je l’ai
dit de ceux du petit nombre fécondé par le courage.
Ceci, au premier coup d’oeil, femble contredire
la doélrine de nos grands maîtres : mais, en y- regardant
de plus près , on va l’y trouver très conforme.
Une armée trop nombreufe eft pefante ,
lente, embarraffée dans fes marchés, dans fes fou-
rages , dans fes fubfiftances : ils en bornent le
nombre à cinquante ou foixante mille hommes ;
c’eft tout ce que le fage Turenne a dit 6c rien au-
delà. D’après cette maxime , qu’il me foit permis
de préfumer ce qu’auroit fait ce grand général,
fi le Roi lui eût confié une armée de cent mille
hommes. Fidèle à fon principe , comme il- l’a
toujours été , il n’auroit tenu en corps d * armée
qu’environ cinquante mille hommes, 6c il auroit
détaché le refte ; il l’auroit employé à inquiéter
l’ennemi fur fes flancs 6c fes communications , fes
provinces les moins gardées : cet ennemi eut-il été
Montécuculli lui-même, avec une armée très inférieure
, T urenne auroit fait un ufage avantageux de
la force paffive fupérieure qu’il avoit en main,
6c auroit certainement contraint fon adverfaire à
reculer promptement 6c loin , ou à fe faire battre.
Lorfque Montécuculli demandoit de grandes
armées , c’eft qu’il fuppofoit alors les autres forces
égales ; il penloit peut - être en ce moment, que
s’il eût eu la fupériorité en 1675 , les fuccès y
euffent répondu. Lorfqu’ii fe repréfente une armée
turque, il change de langage , mais non de principe
: il ne veut que la proportion. Le courage
alors étant égal, 6c l’intelligence très fupérieure, un
nombre médiocre lui iufh-t.
Ainfi Turenne 6cMontécuculi ne comptoient pas
le nombre pour rien. On peut dire que c’eft le
zéro , qui, n’ayant par lui-même aucune valeur,
décuple celle de l’unité à laquelle il eft joint. Lorf-
qu’on voit une petite armée en battre une très
nombreufe, on ne fe trompera jamais en concluant
une grande fupériorité de courage dans les
troupes viétorieufes , ou dans l’intelligence de
l’armée 6c du général. Quant aux, chefs dépourvus
de cette force fuprême , ils font tout auffi bien
battre une petite armée qu’une grande.
Le nombre eft d’autant moins à méprifer , que la
fupériorité de génie qui peut y fuppléer eft plus
rare. Il faut plulieurs fiècles à la nature pour produire
un Alexandre, un Scipion, unGuftav e.un
Frédéric , un Turenne : 8c ce n’eft pas tout encore ;
il faut que les circonftances viennent féconder leur
génie; que le conquérant de l’Afie n’y trouve ni
foldats ni général, Scipion , des Numides ; Guftave
êc Turenne, des chefs très médiocres ; Frédéric,
des troupes très inférieures à celles qu’il a créées :
on s’abuferoit fort, fi en attendant ces phénomènes,
on fe tenoit très inférieur en nombre de troupes
aux puiiTances avec lefquelles on peut être en
guerre ; il faut à cet égard fe mettre de niveau
avec elles. Formons nos troupes aux grandes manoeuvres
de la guerre ; rendons-les fupérieures à
toutes les autres, s’il eft poffible , par la difcipline
5c les exercices. Mais, fi nous atteignons en ce
genre une grande fupériorité , n’elpérons pas
qu’elle foit d’une longue durée. Nos voifins nous
imiteront, nous atteindront, nous furpafferont peut-
être. Si cela n’arrive pas, ils balanceront nos
forces d’un genre par celles d’un autre. Nous le
voyons par la guerre de 177.8, entre l’Empereur.
6c le roi de PrufTe. Les Autrichiens ont oppofé
I à la fcience des manoeuvres la fcience des poftes.
Si l’un ou l’autre parti avoit eu-des forces très
j inégales en nombre, croit-on que les avantages
1 eiiflënt été balancés : que les troupes de l’Em-
| pereur inquiétées par les deux flancs fe fuftent
maintenues fur les bords de l’Elbe , ou que Frédéric
, fuppofé inférieur en nombre , eût empêché
fon adverfaire de paffer cette barrière ? J’obfer-
verai de plus que le roi de PrufTe fit ce que j’ai
dit plus haut qu’auroit faitTurenne.il ne tint pas
toutes fes troupes enfemble, mais il retint près
de lui un corps d’armée fuffifant, 6c détacha une
divifion fur chaque flanc de fon ennemi.
Ne nous égarons pas en des efpérances chimériques
: n’ambitionnons pas la fupériorité conquérante
, elle n’a qu’un éclat funefte : efforçons-
nous feulement d’atteindre celle qui eft refpec-
table. Que nos ennemis craignent de nous attaquer
; mais fuppofons toujours l’égalité avec
eux : ôc , s’ils peuvent mettre fur pied des armées
nombreufes ; foyons en état de leur en oppofer
d’égales en nombre : je parle ici de l’Europe ; je
parle des nations de l’A fie comparées avec les
autres nations de l’Afie. Le parallèle de ces
deux parties du monde , quant à l’art militaire,
trouvera fa place ailleurs.
Je fçais que l’augmentation des troupes eft due
quelquefois à un vice de l’état ou du fouverain ;
mais céla n’arrive pas toujours. Il ne faut pas
ici, fe tromper à l’apparence. Il eft nécefTaire de
diftinguer les troupes 6c les armées. Celles de la ]
république ' romaine furent peu nombreufes ,
mais fes troupes Tétoient; elle pouYoit armer
prefque tous fes - citoyens. Si elle n’employa
d’abord que de petites armées , c’eft qu’elle
. n’eut à combattre fucceffivement. que de petits
peuples. Il faudroit fans doute l’imiter , fi nous
étions dans les mêmes circonftances ; mais il ne
faut pas tirer de fa conduite un exemple pour la
nôtre,, quand les circonftances ont changé ; lorsqu'elles
devinrent différentes :pour elle , lès principes
ne furent plus le s mêmes. Carthage eut des
armées nombreufes ; celles de Rome furent augmentées,
6c leur nombre s’accrut dans la fuite avec
celui de fes ennemis, 6c l’étendue de: fon, empire.
Cette augmentation fut donc un effet nécefTaire de
fon ambition , . mais non pas , .comme l’ont dit
quelques écrivains, une des caufes de fa perte. Ce
ne fut point cette augmentation qui ruina fa difcipline
& fa fcience militaire , mais la cupidité, les
vexations, les injuftices, les pillages des généraux
6c des gouverneurs de provinces. Un petit nombre
de citoyens énorgueilli du titre de patricien ,, ,re-i
garda comme honorable une vie oifive. Après avoir
ufurpé beaucoup .plus de bien qu’il ne leur étoit
nécefTaire pour jouir des vrais dons delà nature ,
ils employèrent ce produit de leur iniquité-à fe
procurer des biens fantaftiques. Les artifans de
luxe fe multiplièrent. Réduits à l a pauvreté , ils
appliquèrent leur induftrie à tenter, par des objets
éclatants,, ceux qui tenoient lès richéffes. Ceux qui
réuffirent, -imitèrent bientôt la vanité patricienne-,
6c le luxe s’étendit fur toute la nation. Le produit
du travail fut employé à Pacquifitiôn d’étoffes
brillantes : tout ce qui ayoit de l’éclat fut .préféré,
même aux vrais befoins ; on fe contenta d’une chétive
nourriture, pour être vêtu de foie. L’argent
defliné .aux bains qui entretenoient la fanté ,
fut émployé à fe couvrir de pourpre. Alors la
molleffe 6c l’oifiveté firent des progrès énormes.
Dès qu’un citoyen eut affez de richeffes, pour
faire lubfifter fa famille honorablement, c’ert-à-
dire, fans travail; fa femme 6c fes enfants.furent
oififs ; un grand nombre de citoyens 6c d’efclaves
leur devint indifpenfable. Un feul homme eut be-
foin de cent autres ., 6c fut nécefTaire à leur fub-
fiftance. Il ne fut plus poffible d’enrôler un arti-
fan, dont l’abfence eut réduit tant de citoyens à la
misère , ni tant de citoyens qui étoient néceffaires
à cet artifan. Ainfi le luxe coupa une partie des
nerfs de la république : elle», eut moins de bras
pour fa défenfe , ôc ce malheur ne fut ni le feul ni
le plus grand de ceux qu’elle éprouva.
L’arbitraire n’a point de bornes. L’efprit qui fe
repaît de piaifirs de fantaiûe ne connoît aucun repos.
Les citoyens oififs, poffeffeurs de fonds de terre ,
furent plus inépuifables en caprices qu’en tréfors.
Ils diminuèrent, autant qu’ils le purent, les falaires
dés citoyens 6c des efclaves qui cultivoient leurs
campagnes;ils leur laifsèrent à peine la fubfiftance,
leur enlevèrent les moyens de rendre la terre fertile,
leur ôtèrent le nécefTaire pour le donner à des chiens
6c à des chevaux. Bientôt ces terres cultivées par des
bras que la misère avoir affoiblis , ne purent fatis-
faire ni la cupidité du maître , ni les befoins des
cultivateurs. Ceux-ci les abandonnèrent peu-à-peu,
fe jettèrent dans les villes, fe mirent aux gages des
citoyens riches, foit pour fervir à leurs befoins
domeftiques, foit pour féconder leur ambition, en
qualité de foldats.. L’état eut moins de troupes,
moins de défenfeürs, mais une armée plus nombreufe
, avec laquelle le plus habile 6c le plus heureux
affervit fa patrie.
Les maux qui avoient produit l’empire augmentèrent
fous l’empire. Le luxe parvint aux plus
grands excès. Les Empereurs ne purent affouvir
leur frénéfie qu’en dévaftant les provinces : planeurs,
ne régnant que fur des efclaves, trouvèrent
en eux leurs afTaffins. Les habitants de la campagne
l’abandonnèrent, pour fe mettre à la folde du prince
6c partager fes brigandages, ou pour aller chercher
une retraite inconnue à l’avarice de leur maître.
Ceux-ci, devenus moins jriches , parce; que ce n’eft
pas feule que la terre produit tout, ce qu’elle exige
de bras 6c de faerifices , ne furent plus en état de
foudoyer un auffi grand nombre de ' troupes, ni
même d’entretenir celles qu’ils avoient confervées.
Ils furent mal fervis par des foldats mal payés ;
ils furent abandonnés avec joie par des efclaves
qui les. déteftoient, 6c qui allèrent fervir des puif-
fances étrangères. Ainfi le fafte de ces princes ,
amiss du luxe 6c ennemis de leurs fujcts'j qu’ils
vouloient afTervir fous prétexte de les défendre, fe
complaifoient en un grand nombre de fatellites, 6c
dirainuoient.le nombre réel des défppfeurs dé Tét-nt.