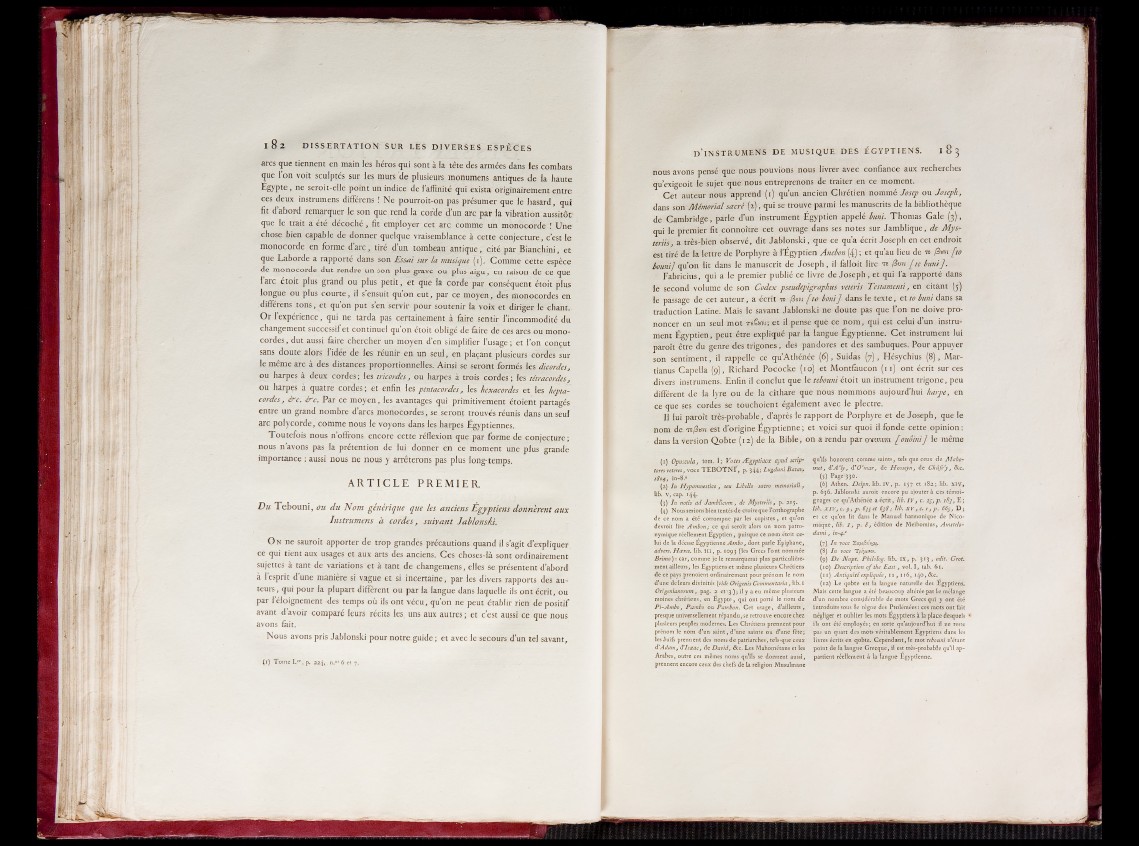
1 8 2 D I S S E R T A T IO N SUR LES D I V ER S ES E S P È C E S
arcs que tiennent en main les héros qui sont à la tête des armées dans les combats
que 1 on voit sculptés sur les murs de plusieurs monumens antiques de la haute
EgyPt e » ne seroit-elle point un indice de 1 affinité qui exista originairement entre
ces deux instrumens différens ! Ne pourroit-on pas présumer que le hasard, qui
fit d abord remarquer le son que rend la corde d’un arc par la vibration aussitôt
que le trait a été décoché, fit employer cet arc comme un monocorde ! Une
chose bien capable de donner quelque vraisemblance à cette conjecture, c’est le
monocorde en forme darc, tiré d’un tombeau antique, cité par Bianchini, et
que Laborde a rapporte dans son Essai sur la musique (r). Comme cette espèce
de monocorde dut rendre un son plus grave ou plus aigu, en raison de ce que
1 arc étoit plus grand ou plus petit, et que la corde par conséquent étoit plus
longue ou plus courte, il s’ensuit qu’on eut, par ce moyen, des monocordes en
differens tons, et quon put s en servir pour soutenir la voix et diriger le chant.
O r l'expérience, qui ne tarda pas certainement à faire sentir l’incommodité du
changement successif et continuel qu’on étoit obligé de faire de ces arcs ou monocordes,
dut aussi faire chercher un moyen d’en simplifier l’usage ; et l’on conçut
sans doute alors l’idée de les réunir en un seul, en plaçant plusieurs cordes sur
le même arc à des distances proportionnelles. Ainsi se seront formés les dicordes,
ou harpes à deux cordes; les tricordes, ou harpes à trois cordes; les tétracordes,
ou harpes à quatre cordes; et enfin les pentacordes, les hexacordes et les hepta-
cordes, dre. dre. Par ce moyen, les avantages qui primitivement étoient partagés
entre un grand nombre d’arcs monocordes, se seront trouvés réunis dans un seul
arc polycorde, comme nous le voyons dans les harpes Égyptiennes.
Toutefois nous n'offrons encore cette réflexion que par forme de conjecture;
nous n avons pas la prétention de lui donner en ce moment une plus grande
importance : aussi nous ne nous y arrêterons pas plus long-temps.
A R T I C L E P R E M I E R .
Du Tebouni, ou du Nom générique que les anciens Égyptiens donnèrent aux
Instrumens à cordes, suivant Jablonsli.
O n ne saurait apporter de trop grandés précautions quand il s’agit d’expliquer
ce qui tient aux usages et aux arts des anciens. Ces choses-là sont ordinairement
sujettes à tant de variations et à tant de changemens, elles se présentent d’abord
à l’esprit d’une manière si vague et si incertaine, par les divers rapports des auteurs,
qui pour la plupart diffèrent ou par la langue dans laquelle ils ont écrit, ou
par l’éloignement des temps où ils ont vécu, qu’on ne peut établir rien de positif
avant d avoir comparé leurs récits les uns aux autres; et c’est aussi ce que nous
avons fait.
Nous avons pris Jablonski pour notre guide ; et avec le secours d’un tel savant,
(1) T om e I.cr, p. 224, n.os 6 et 7.
D ’ i N S T R U M E N S D E M U S I Q U E D E S É G Y P T I E N S . I 8 3
nous avons pensé que nous pouvions nous livrer avec confiance aux recherches
qu’exigeoit le sujet que nous entreprenons de traiter en ce moment.
Cet auteur nous apprend (1) qu’un ancien Chrétien nommé Josep ou Joseph,
dans son Mémorial sacré (2), qui se trouve parmi les manuscrits de la bibliothèque
de Cambridge, parle d’un instrument Égyptien appelé luni. Thomas Gale (3),
qui le premier fit connoître cet ouvrage dans ses notes sur Jamblique, de Mys-
teriis, a très-bien observé, dit Jablonski, que ce qu’a écrit Joseph en cet endroit
est tiré de la lettre de Porphyre à l’Égyptien A n d on (4 ) ; et qu’au lieu de ro /3«vi [¡0
bouni] qu on lit dans le manuscrit de Joseph, il falloit lire tt /3ovi [ te luni] .
Fabricius, qui a le premier publié ce livre de Joseph, et qui l’a rapporté dans
le second volume de son Codex pseudepigraphus veteris Testamenti, en citant (5)
le passage de cet auteur, a écrit v> /3 ovt [to boni] dans le texte, et to luni dans sa
traduction Latine. Mais le savant Jablonski ne doute pas que l’on ne doive prononcer
en un seul mot te&vi; et il pense que ce nom, qui est celui d’un instrument
Égyptien, peut être expliqué par la langue Égyptienne. Cet instrument lui
paraît être du genre des trigones, des pandores et des sambuques. Pour appuyer
son sentiment, il rappelle ce qu’Athénée (6), Suidas (7), Hésychius (8), Mar-
tianus Capella (9), Richard Pococke (10) et Montfaucon (11) ont écrit sur ces
divers instrumens. Enfin il conclut que le tebouni étoit un instrument trigone, peu
différent de la lyre ou de la cithare que nous nommons aujourd’hui harpe, en
ce que ses cordes se touchoient également avec le plectre.
Il lui paraît très-probable, d’après le rapport de Porphyre et de Joseph, que le
nom de -n/3»vi est d’origine Égyptienne; et voici sur quoi il fonde cette opinion:
dans la version Qobte (12) de la Bible, on a rendu par tmunû [ ouoini] le même
(1) Opuscula, tom. I ; Voces Ægyptiacce apud scrip- qu’ils honorent comme saints, tels que ceux de Mahotores
veteres, voce T E B O T N I * , p. 344; Lugduni Batavr met> ¿ ’A 'fy j d 'O ’mar, de Hosseyn, de Châfe’y , & c .
1804, in-8.° (5) PaSe 33ô-
(2) In Hypomnestico, seu Libello sacro m e m o r ï a l i (6) Athen. Deipn, Iib. I V , p. 157 et 182; lib. XIV,
Iib V cap 144 P* 636. Jablonski auroit encore pu ajouter à ces témoi-
(3) In notis ad JambÙcum, de Mysteriis, p. ¿ ï 5. g nages ce qu’Athénée a éc rit, lib. i v , c. 23, p . 183, E ;
(4) Nous serions bien tentés de croire que I’orthographe bib. x i v , c * p , p . et 638; lib. X V , c. / , p . 663, D ;
de ce nom a été corrompue par les copistes, et qu’on et ce qu on lit dans le Manuel harmonique de Nicodevroit
lire Am b o n ; ce qui seroit alors un nom patro- maque, lib. 1 , p . 8 , édition de Meibomius, Amstelonymique
réellement Egyptien, puisque ce nom étoit ce- d am i , in-4.0
lui de la déesse Egyptienne Ambo , dont parle Epiphane, (7) In voce
advers. Hoeres. lib. I I I , p. 1093 (les Grecs l’ont nommée (8) In voce Tplyorov.
Brimo) : car, comme je le remarquerai plus particulière- (9) D e JVupt, Philolog. Iib. IX , p. 313 , edit, Crot.
ment ailleurs, les Egyptiens <et même plusieurs Chrétiens (10) Description o f the E a s l, vol. I , tab. 61.
de ce pays prenoient ordinairement pour prénom le nom (11) Antiquité expliquée, 1 1 , 1 16 , i 4°> &c,
d’une de leurs divinités {vide Origenis Commentaria, Iib. I (12) Le qobte est la langue naturelle des Egyptiens.
Origenianorum, pag. 2 et'13 ) ; il y a eu même plusieurs Mais cette langue a été beaucoup altérée par le mélange
moines chrétiens, en Egyp te, qui ont porté le nom de d’un nombre considérable de mots Grecs qui y ont été
P i-Am b o , Pambo ou Pair.bon. C e t usage, d’ailleurs, introduits sous le règne des Ptolémées: ces mots ont fait
presque universellement répandu, se retrouve encore chez négliger et oublier les mots Egyptiens à la place desquels 1
plusieurs peuples modernes. Les Chrétiens prennent pour ils ont été employés ; en sorte qu’aujourd’hui il ne reste
prénom le nom d’un saint, d’une sainte ou d’une fête; pas un quart des mots véritablement Egyptiens dans les
les Juifs prennent des noms de patriarches, tels »que ceux livres écrits en qobte. Cependant, le mot tebouni n’étant
d’Adam, d’Isaac, de David, & c . Les Mahométans et les point de la langue Grecque, il est très-probable qu’il ap-
Arabes, outre ces mêmes noms qu’ils se donnent aussi, partient réellement à la langue Egyptienne,
prennent encore ceux des chefs de la religion Musulmane