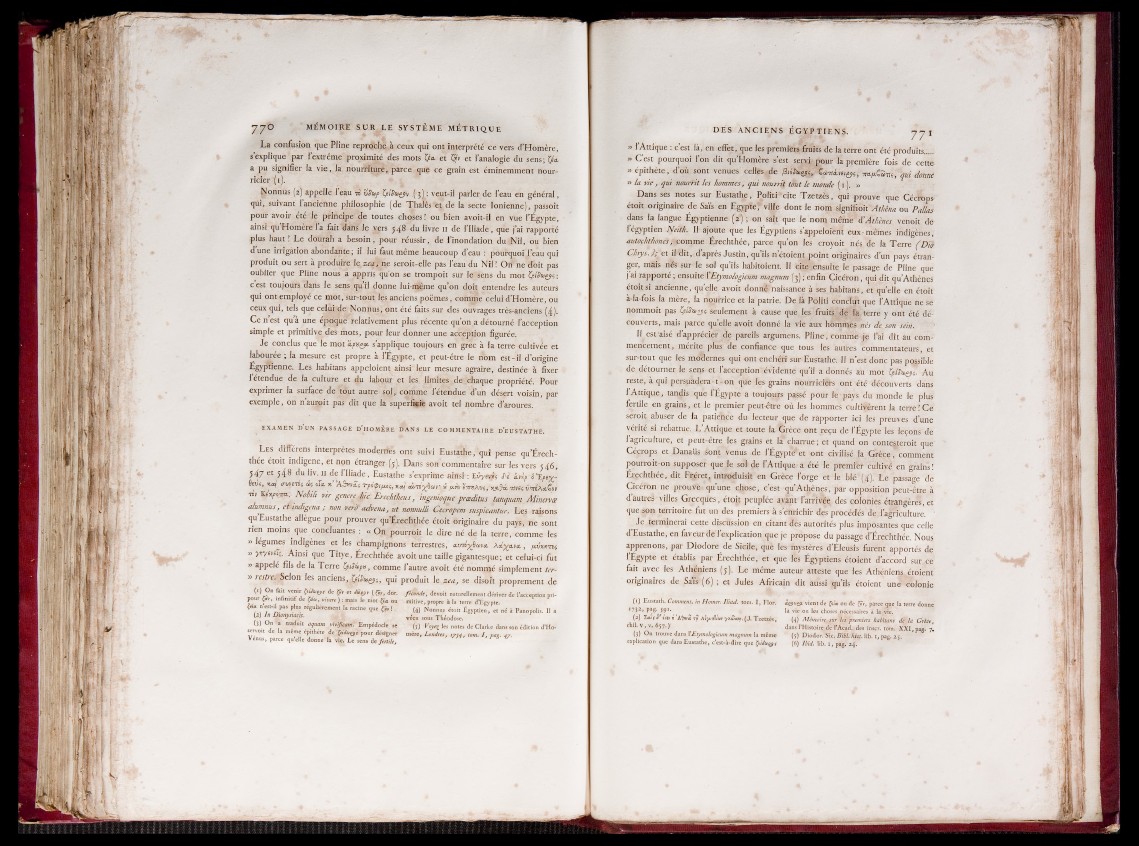
L a confusion que PJine reproche à ceux qui ont interprété ce vers d’H omère,
s’explique par i’extrême proximité des mots Çéa. et Çnv et l’analogie du sens; Çéa.
a pu signifier la v ie , la nourriture, parce que ce grain est éminemment nourricier
(i).
Nonnus (2) appelle 1 eau 70 vSup Çe/àlagpv ( 3 ) ; veut-il parler de l’eau en général,
qui, suivant 1 ancienne philosophie (de Thalès'et de la secte Ionienne), passoit
pour avoir été le principe de toutes choses ! ou bien avoit-il en vue l’Égypte,
ainsi quHomere la fait dans le vers y 48 du livre 11 de l’Iliade, que j’ai rapporté
plus haut! L e dourah a besoin, pour réussir, de l’inondation du Nil, ou bien
d une irrigation abondante ; il lui faut meme beaucoup d’eau : pourquoi l’eau qui
produit ou sert à produire le z e a , ne seroit-elle pas l’eau du Nil ! On ne doit pas
oublier que Piine nous a appris qu’on se trompoit sur le sens du mot Çe/i&eJ«:
c est toujours dans le sens qu’il donne lui-meme qu’on doit entendre les auteurs
qui ont employé ce mot, sur-tout les anciens poëmes, comme celui d’Homère, ou
ceux qui, tels que celui de Nonnus, ont été faits sur des ouvrages très-anciens (4).
C e n est qu a une époque” relativement plus récente qu’on, a détourné l’acception
simple et primitive des mots, pour leur donner une acception figurée.
Je conclus que le mot «-pxgje- s’applique toujours en grec à la terre cultivée et
labourée ; la mesure est propre à i’Égypte, et peut-être le nom e s t-il d’origine
Egyptienne. Les Iiabitans appeloient ainsi leur mesure agraire, destinée à fixer
1 étendue de la culture et du labour et les limites de chaque propriété. Pour
exprimer la surface de tout autre sol, comme l’étendue d’un désert voisin, par
exemple, on n’aurpit pas dit que la superficie avoit tel nombre d’aroures.
E X A M E N D U N P A S S A G E D ’H O M È R E D A N S L E C O M M E N T A I R E D ’E U S T A T H E .
L e s différens interprètes modernes ont suivi Eustathe, qui pense qu’Érech-
thée étoit indigène, et non étranger (y). Dans son commentaire sur les vers 54 6 ,
547 et du liv. 11 de 1 Iliade, Eustathe s’exprime ainsi : Eu’yenh J\= Ln.pS’Epe^-
Ôeu'c, « 4 en.n-âi ÔS of* *’ ASfiriL; g f H ^ ||| xaj mH ÛTréAd.Cov
■ni Nobih vir genere Ijtc Erechtheus, ingenioque proeditus tanquam Minerves
alumnus, ebindigena ; non vertfadvena, ut nonnulli Cecropem suspicantur. Les raisons
qu Eustathe allègue pour prouver qu’Érechthée étoit originaire du pays, ne sont
rien moins que concluantes : « On pourrait le dire né de la terre, comme les
» légumes indigènes et les champignons terrestres, Aa^nv*, pwxtmi
» y ryeveîc. Ainsi que T ity e , Érechthée avoit une taille gigantesque; et celui-ci fut
» appelé fils de la Terre tpiSùpv, comme l’autre avoit été nommé simplement ter-
os restre?Selon les anciens, ZfiSu&i, qui produit le zea, se disoit proprement de
(1) On fait yenir Çuduçpç de fît et edçÿy ( $ r , dor. féconde, devoit naturellement dériver de l’acception pri-
ponr f« r , infinitif de f« » , v/Vere ) : mais le mot fû t ou mitive, propre à la terre d'Égypte.
/ t" r ’ n ? “ pl“ ! r^ uliéreme" t Ia racine f î - ! (4) Nonnus étoit Égyptien, et né à Panopolis. II a
(2) In Djonypaas. ^ 3 . vécu sous Théodose.
(3) On a traduit aquam rmficamT Empédocie se (5) Voye^ les notes de Ciarke dans son édition d'Ho-
servoit de la meme epithete de g é jife g t pour désigner mère, Londres, sv¡4, tom. I, pas. 47.
Venus, parce qu’elle donne la vie. L e sens de fertile,
» l’Attique : c’est là, en effet, que les premiers fruits de la terre ont été produits....
» C’est pourquoi l’on dit qu’Homère s’est servi pour la première fois de cette
» épithète, d’où sont venues celles ,de pdSto&s,. «t^CSv s, qui donne
» la vie, qui nourrit les hommes, qui nourrit tout le monde ( i ). »
Dans ses notes sur Eustathe, Politi'cite Tzetzès, qui prouve que Cécïops
étoit originaire de Sais en Egypte,* ville dont le nom signifioit Athêna ou Pallas
dans la langue Égyptienne (2) ; on sait que le nom même à'Athènes venoit dé
^ égyptien Neith. Il ajoute que les Égyptiens s appeloient eux - mêmes indigènes,
autochthones/’.comme Érechthée, parce qu’on les croyoit nés de la Terre (D iô
Chrys. J/ et il dit, d après Justin, quils netoïent point originaires d’un pays étranger,
mais nés sur le sol qu’ils habitoient. Il cite ,ensuite le passage de Pline que
j ai rapporté ; ensuite X’Etymologicum magnum (3) ; enfin Cicéron, qui dit qu’Athènes
étoit si ancienne, qu’elle avoit donné naissance à ses habitans, et qu’elle en étoit
à-la-fois la mère, la nourrice et la patrie. De là Politi conclut que l’Attique ne se
nommoit pas {¿¡Stepa seulement à cause que les fruits de la terre y ont été découverts,
mais parce qu’elle avoit donné la vie aux hommes nés de son sein.
Il est aisé d’apprécier de pareils argumens. Pline, comme je lai dit au commencement
, mérité plus de confiance que tous les autres commentateurs, et
sur-tout que les modernes qui ont enchéri sur Eustathe. II n’est donc pas possible
de détourner le sens et l’acception évidente qu’il a donnés au mot ¡ P S f P Au
reste, à qui persuadera-t-on que les grains nourriciers ont été découverts dans
1 Attique, tandis que l’Égypte a toujours passé pour le pays du monde le plus
fertile en grains, et le premier peut-être où les hommes cultivèrent la terre!Ce
serait abuser de la patience du lecteur que de rapporter ici les preuves d’une
vérité si rebattue. L Attique et toute la Grèce ont reçu de l’Égypte les leçons de
1 agriculture, et peut-etre les grains et la charrue; et quand on contesterait que
Céçrops et Danaüs sont venus de l'Egypte4« ont civilisé la Grèce ^comment
pourroit-on supposer que le sol de l’Attique a été le premier cultivé en grains !
Érechthée, dit Fréret., introduisit en Grèce l’orge et le blé'(4). Le passage de
Cicéron ne prouvé, qu’une chose, c’est qu’Athènes, par opposition peut-être à
d autres villes Grecques, étoit peuplée avant l’arrivée des colonies étrangères, et
que son territoire fut un des premiers à s’enrichir des procédés de l’agriculture. •
Je tel minerai cette discussion en citant des autorités plus imposantes que celle
d Eustathe, en faveur de 1 explication que je propose du passage d’Érechthée. Nous
apprenons, par Diodore de Sicile, que les mystères d’ÉIeusis furent apportés de
lÉgypte et établis par Érechthée, et que les Égyptiens étoient d’accord sur ce
fait avec les Athéniens (5). Le même auteur atteste que les Athéniens étoient
originaires de Sais (6) ; et Jules Africain dit aussi qu’ils étoient une colonie
(1) Eustath. Comment, in Homer. llia d . tom. I , Flor. «eyvejt vient de Çtla ou de f î t , parce o se la terre donne
1732> Pag- 59r* " 1 la vie ou les choses nécessaires à la vie.
(2) latç J* «fir n ’AfrrS r» Aiy/sihW yhao*/. ( J. Tze tzé s, (4) Mémoire sur les 'premiers habitans de la C r e c e ,
chil. V , v. 6 57 .) dans l’Histoire de l’A cad. des inscr. tom; X X I , pag. 7.
(3) On trouve dans YEtymologicum magnum la même (5) Diôdor. Sic. Bibl. hist. Iib. I , pag. 25.
explication que dans Eustathe, c’est-à-dire que ÇtiJiu^ç (6) Jbid. Iib. 1 , pag. 24.