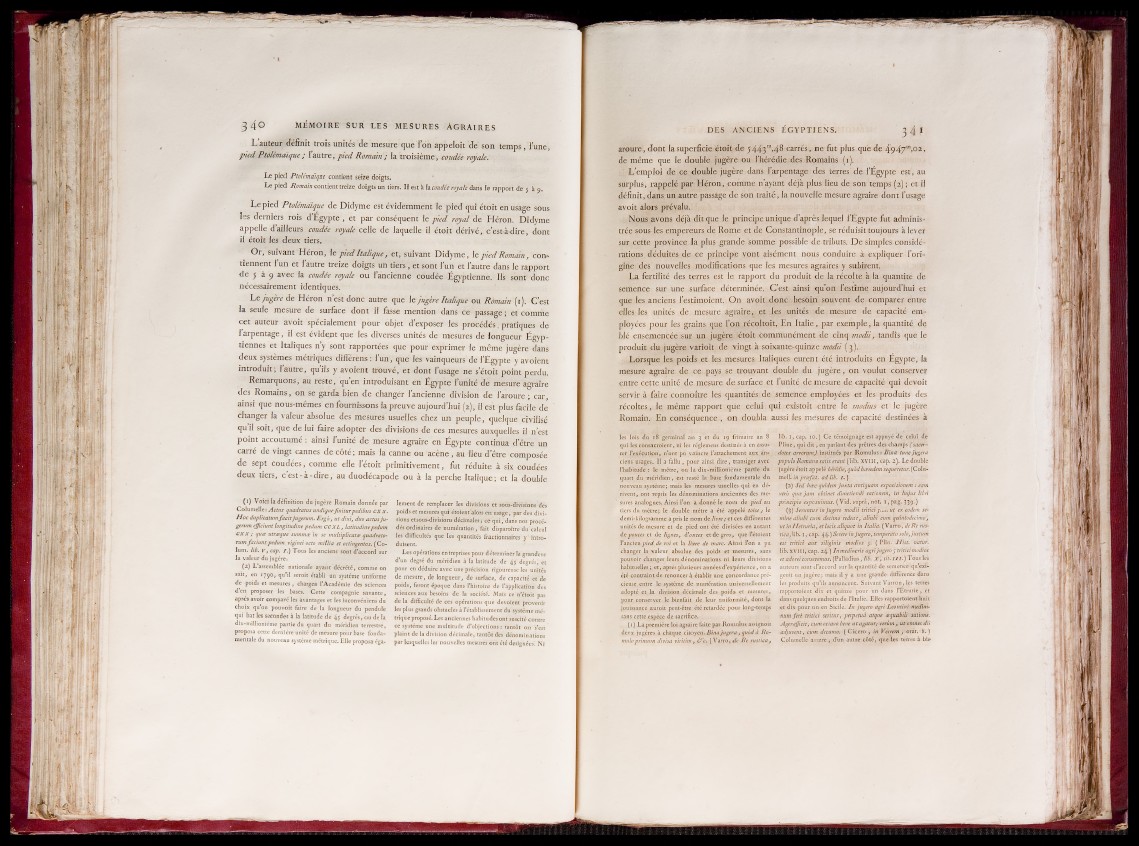
L auteur définit trois unités de mesure que l’on appeloit de son temps, Tune,
pied Ptôlémeüque ; 1 autre, pied Romain ; la troisième, coudée royale.
L e p ie d Ptolémàiqne c o n t i e n t s e iz e d o ig t s .
L e p ie d Romain c o n t ie n t t r e iz e d o ig t s u n t i e r s . I I e s t à la coudée royale d an s le r a p p o r t d e $ à p .
Le pied Ptolémàique de Didyme est évidemment le pied qui étoit en usage sous
les derniers rois d’Égypte , et par conséquent le pied royal de Héron. Didyme
appelle dailleurs coudée royale celle de laquelle il étoit dérivé, c’est-àdire, dont
il étoit les deux tiers.
Or, suivant Héron, le pied Italiqueg et, suivant Didyme, le pied Romain, contiennent
1 un et I autre treize doigts un tiers, et sont l'un et l'autre dans le rapport
de y à 9 avec la coudée royale ou l’ancienne coudée Égyptienne. Us sont donc
nécessairement identiques.
Le jugère de Héron n’est donc autre que le jugère Italique ou Romain (i). C’est
la seule mesure de surface dont il fasse mention dans ce passage ; et comme
cet auteur avoit spécialement pour objet d’exposer les procédés. pratiques de
1 arpentage, il est évident que les diverses unités de mesures de longueur Égyptiennes
et Italiques n y sont rapportées que pour exprimer le même jugère dans
deux systèmes métriques différens : l’un, que les vainqueurs de l’Égypte y avoient
introduit; 1 autre, quils y avoient trouvé, et dont l’usage ne s’étoit point perdu.
Remarquons, au reste, qu’en introduisant en Égypte l’unité de mesure agraire
des Romains, on se garda bien de changér l’ancienne division de l’aroure ; car,
ainsi que nous-mêmes en fournissons la preuve aujourd’hui (2), il est plus facile de '
changer la valeur absolue des mesures usuelles chez un peuple, quelque civilisé
qu il soit, que de lui faire adopter des divisions de ces mesures auxquelles il n’est
point accoutumé : ainsi l’unité de mesure agraire en Égypte continua d etre un
carré de vingt cannes de cote ; mais la canne ou acène, au lieu d’être composée
de sept coudées, comme elle l’étoit primitivement, fut réduite à six coudées
deux tiers, c e s t-à -d ire , au duodécapode ou à la perche Italique; et la double
(1) V o ic i la définition du jugère Romain donnée par lement de remplacer les divisions et sous-divisions des
Columeile : Actus quadratus ¡indiquefiniturptdibus C X X . poids et mesures qui étoient alors en usage, par des divi-
H o c duplicatwnfqcit jugerum. Ergo, ut dixi, duo actusju- sions etsous-divisions décimale,; ce qui. dans nos procé-
gerum efficiunt longitudine pedum c e X L , latitudine pedum dés ordinaires de numération, fait disparoitre du calcul
C X X ; quæ utræque suinmæ in se multiplicatæ quadrato- les difficultés que les quantités fractionnaires y" intro-
rumfaciuntpedum viginti octo tnillia et octingentos. ( C o- duisent.
lum. h t . V , cap. 1.) Tous les anciens sont d’accord sur Les opérations entreprises pour déterminer la grandeur
la valeur du jugère. d’un degré du méridien à la latitude de 4 ; degrésj et
(a) L assemblée nationale ayant décrété, comme on pour en déduire avec une précision rigoureuse les unités
sait, en 1790, qu’il serait établi un système uniforme de mesure, de longueur, de surface, de capacité et'd e
de poids et mesures, chargea l’Académie des sciences poids, feront époque dans l’histoire de l’application des
d en proposer les bases. Ce tte compagnie savante, sciences aux besoins de la société. Mais ce n’étoit pas
après avoir comparé les avantages et les inconvéniens du de la difficulté de ces opérations que devoient provenir
choix quon pouvoit faire de la longueur du pendule les plus grands obstacles à l’établissement du système mé-
qui bat les secondes à la latitude de 4) degrés, ou de la trique proposé. Les anciennes habitudes ont suscité contre
dix-millionième partie du quart du méridien terrestre, ce système une multitude d’objections : tantôt on s’est
proposa cette dernière unité de mesure pour base fonda- plaint de la division décimale, tantôt des dénominations
mentale du nouveau système métrique. Elle proposa éga- par lesquelles les nouvelles mesures ont été designées. N i
aroure, dont la superficie étoit de ^ 4 4 jm,4S carrés, ne fut plus que de 4947m>02>
de même que le double jugère ou l’hérédie des Romains (1).
L ’emploi de ce double jugère dans l’arpentage des terres de l’Égypte est, au
surplus, rappelé par Héron, comme n’ayant déjà plus lieu de son temps (2) ; et il
définit, dans un autre passage de son traité, la nouvelle mesure agraire dont l’usage
avoit alors prévalu.
Nous avons déjà dit que le principe unique d’après lequel l’Égypte fut administrée
sous les empereurs de Rome et de Constantinople, se réduisit toujours à lever
sur cette province la plus grande somme possible de tributs. De simples considérations
déduites de ce principe vont aisément nous conduire à expliquer l’origine
des nouvelles modifications que les mesures agraires y subirent.
La fertilité des terres est le rapport du produit de la récolte à la quantité de
semence sur une surface déterminée. C’est ainsi qu’on l’estime aujourd’hui et
que les anciens l’estimoient. On avoit donc besoin souvent de comparer entre
elles les unités de mesure agraire, et les unités de mesure de capacité employées
pour les grains que l’on récoltoit. En Italie, par exemple, la quantité de
blé ensemencée sur un jugère étoit communément de cinq ntodii, tandis que le
produit du jugère varioit de vingt à soixante-quinze modii ( 3).
Lorsque les poids et les mesures Italiques eurent été introduits en Égypte, la
mesure agraire de ce pays se trouvant double du jugère, on voulut conserver
entre cette unité de mesure de surface et l’unité de mesure de capacité qui devoit
servir à faire connoître les quantités’ de semence employées et les produits des
récoltes, le même rapport que celui qui existoit entre le modius et le jugère
Romain. En conséquence , on doubla aussi les mesures de capacité destinées à
les lois du 18 germinal an 3 et du 19 frimaire an 8
qui les consacroient, ni les réglemens destinés à en assurer
l’exécution, n’ont pu vaincre l’attachement aux anciens
usages. II a fallu , pour ainsi d ir e , transiger avec
l’habitude : le mètre, ou la dix-’millionième partie du
quart du méridien, est resté la base fondamentale du
nouveau système; mais les mesures usuelles qui en dérivent,
ont repris les dénominations anciennes des mesures
analogues. Ainsi l’on a donné le nom de pied au
tiers du mètre; le double mètre a été appelé toise le
demi-kilogramme a pris le nom de livre e t c es différentes
uni,tés de mesure et de pied ont été divisées en autant
de pouces et de lignes, onces et de gros, que l’étoient
l’ancien pied de roi et la livre de marc. Ainsi l’on a pu
changer la valeur absolue des poids et mesures, sans
pouvoir changer leurs dénominations ni leurs divisions
habituelles ; e t , après plusieurs années d’expérience, on a
été contraint de renoncer à établir une concordance précieuse
entre le système de numération universellement
adopté et la division décimale des poids et mesures,
pour conserver le bienfait de leur uniformité, dont la
jouissance auroit peut-être été retardée pour long-temps
sans cette espèce de sacrifice.
(1 ) La première loi agraire faite par Romulus assignoit
deux jugères à chaque citoyen. Bina jugera, quod à Ro-
mulo primum divisa viritim, ¿ fc . ( V arro, de Re tysiicay
Iib. I , cap. 10.) C e témoignage est appuyé de celui de
Plin e, qui d i t , en parlant des prêtres des champs ( sacerd
ote arvorum) institués par Romulus: Bina tune jugera
populo Romano satis erant ( lib. X V I I I , cap. 2). Le double
jugère étoit appelé hérêdie, quod hceredem sequeretur. (Colameli.
in prtrfat. ad lib. I . )
(2) Sed luxe quidem ju x ta an tiqua ni exposicionem : earn
vero quæ jam obtinet diinetiendi rationem, in hujus libri
principio expesuimus. ( V id. suprà, not. 1 , pag. 339.)
(3) Seruntur in jugero modii tritici y..... ut ex eodem semine
aliubi cu in decimo redeat, aliubi cum qitintodecimo,
ut in Hetruria, et locis aliquot in Italia. ( Varro, de Re rùstica,
lib. I c a p . 44-) S'erere in jugero, temperato solo,justurn
est tritici aut siliginis modios j ; ( Plin. Hist. natur.
Iib. XVIII, cap. 24*) Inmediocris agrijugero$ tritici modios
et adorei conseremus. (Palladrus, lib. X , tit. I I I . ) T ous les
auteurs sont d’accord sur la quantité de semence qu’exi-
geoit un jugère; mais il y a une grande différence dans
les produits qu’ils annoncent. Suivant Varro n , les terres
rapportoient dix et quinze pour un dans I’E trurie, et
dans quelques endroits de l’Italie. Elles rapportoient huit
et dix pour un en Sicile. In jugero agri Leontini medim-
num ferì tritici seritur, peipetuâ atque oequabili satione.
Agerefficit, cum octavo bene utagatur,- verinn, ut ontries dii
adjuvent, cum decunio. ( Cicero , in Ver rem, orar. 8. )
Columeile assure, dun autre côté, que.les terres à blé
*