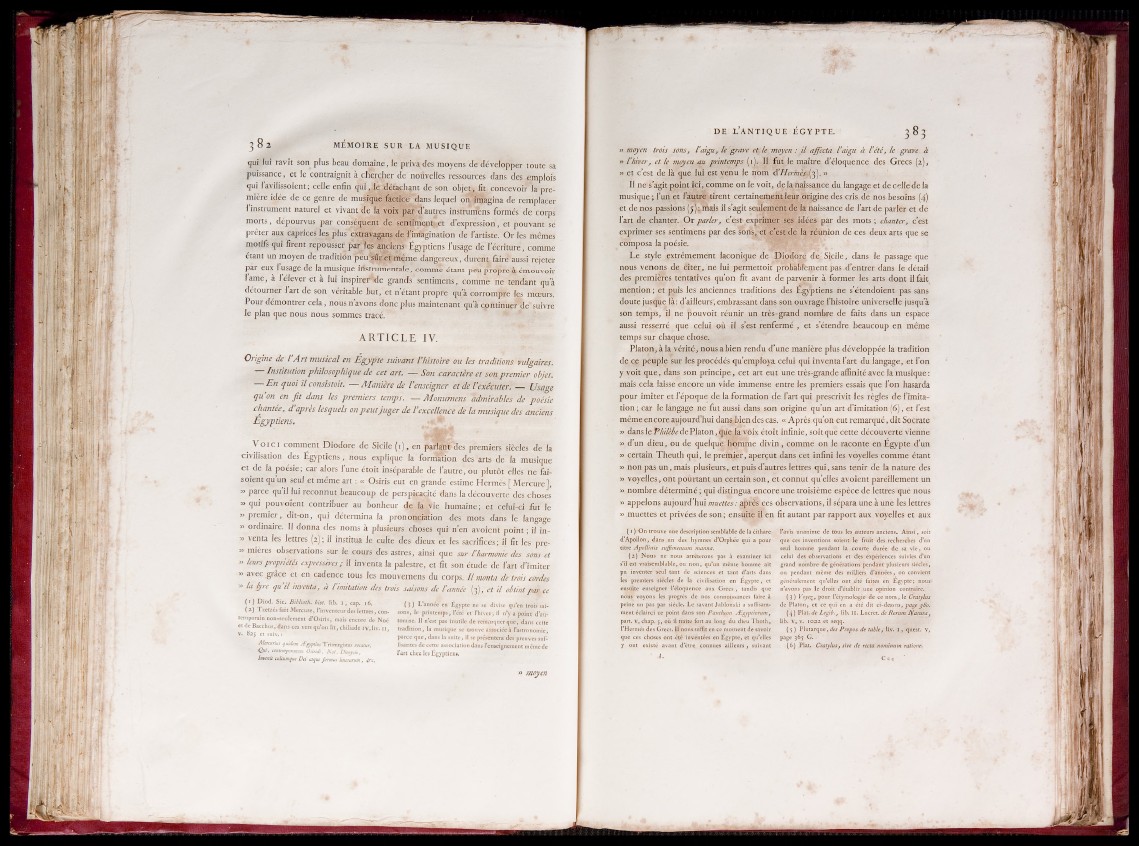
qui fui ravit son plus beau domaine, le priva des moyens de développer toute sa
puissance, et le contraignit à cherdier de noüvelles ressources dans des emplois
qui 1 avilissoient ; celle enfin qui, le détachant de son objet, fit concevoir la première
idée de ce genre de musique factice ‘ dans lequel o a imagina de remplacer
1 instrument naturel et vivant de la voix par d’autres instruirons formés de corps
morts, dépourvus par conséquent de sentiment: et d’expression, et pouvant sé
prêter aux caprices les plus extravagans de l’imagination de l’artiste. Or les mêmes
motifs qui firent repousser par les anciens Égyptiens l’usage de l’écriture, comme
étant un moyen de tradition pett'atur et même dangereux, durent faire'aussi rejeter
par eux l’usage de la musique instrumentale, comme étant peu propre à émouvoir
lame, a 1 élever et à lui inspirerMe grands sentimens, comme ne tendant qu’à
détourner 1 art de son véritable but, et n étant propre qu’à corrompre les moeurs.
Pour démontrer cela, nous n’avons donc plus maintenant qu’à continuer de'suivre
le plan que nous nous sommes tracé. ! "
A R T I C L E IV.
Origine de l A r t musical en Egypte suivant Vhistoire ou les traditions vulgaires.
Institution philosophique de cet art. |îj- Son caractère et son premier objet.
E n quoi il consistoit. — Manière de l ’enseigner et de l ’exécuter. — Usage
qu on en fit dans les premiers temps. — Monumens admirables de poésie
chantée, d après lesquels on p eu t jug er de l ’excellence de la musique des anciens
Egyptiens.
V o i c i comment Diodore de Sicile ( i), en parlant Ses premiers siècles de la
civilisation des Égyptiens, nous explique la formation des arts de la musique
et de la poésie; car alors l’une étoit inséparable de l’autre, ou plutôt elles ne fai-
soient qu’un seul et même art : « Osiris eut en grande estime Hermès [Mercure],
» parce qu il lui reconnut beaucoup de perspicacité dans la découverte des choses
» qui pouvoient contribuer au bonheur de la vie humaine; et celui-ci fut le
» premier, dit-on, qui détermina ia prononciation des mots dans le langage
» ordinaire. Il donna des noms a plusieurs choses qui n’en avoient point ; il in-
» venta les lettres (2) ; il institua le culte des dieux et les sacrifices ; il fit les pre-
» mières observations sur le cours des astres, ainsi que sur l ’harmonie des sons et
» leurs propriétés expressives; il inventa 1a palestre, et fit son étude de l’art d’imiter
» avec grâce et en cadence tous les mouvemens du corps. I l monta de trois cordes
» la lyre qu il inventa, a l imitation des trois saisons de l'année (3), et il obtint par ce
i ' J ° iod\ S !c; Iib- 1 “ P- ( 3) L ’année en Egypte ne se divise qu’en trois sai-
(2 ) i zetzes fait Mercure, I inventeur des lettres, con- sons, le printemps, l’été et l’hiver; il n’y a point d’au-
temporam non-seulement d’Osiris, mais encore de N o é tomne. Il n’est pas inutile de remarquer que, dans cette
etde Bacchus, dans ces vers qu’on lit , chiliade t v .liv . I I , tradition, la musique se trouve associée à l’astronomie
Y. 02Ç et suiv. : •' - v - r - , . .. ,
parce que , dans la suite, il se présentera des preuves suf-
Mcrcunus quidam Ægyptms Trfsmegîstus vocatur, fisantes de cette association dans l’enseignement même de
Q u i, contemporancus O siridi, N oë, Dionysio, l’art chez les Égyptiens.
Invertit cultumquc D ti cuque formas liiterarum, iffe.
» moyen trois sons, l ’aigu, le grave et le moyen : il affecta l'aigu à l'été, le grave à
» l ’hiver, et le moyen au printemps (1). Il fut le maître d’éloquence des Grecs (2),
sa et c’est de là que lui est venu le nom SHermèsjpj).-»
Il ne s’agit point ici, comme on le voit, de la naissance du langage et de celle de la
musique ; l’un et l’autre tirent certainement leur origine des cris de nos besoins (4)
et de nos passions (y) : mais il s’agit seulement de la naissance de l’art de parler et de
l’art de chanter. Or parler, c’est exprimer ses idées par des mots ; chanter, c’est
exprimer ses sentimens par des sons, et c’est de la réunion de ces deux arts que se
composa la poésie.
Le style extrêmement laconique de Diodore de, Sicile, dans le passage que
nous venons de citer, ne lui permettoit probablement pas.d’entrer dans le détail
des premières tentatives qu’on fit avant de parvenir à former les arts dont il fait
mention ; et puis les anciennes traditions des Égyptiens ne s’étendoient pas sàns
doute jusque là: d’ailleurs; embrassant dans son ouvrage l’histoire universelle jusqu’à
son temps, il ne pouvoit réunir un très-grand nombre de faits dans un espace
aussi resserré que celui où il s’est renfermé , et s’étendre beaucoup en même
temps sur chaque chose.
Platon, à la vérité, nousabien rendu d’une manière plus développée la tradition
de c.e peuple sur les procédés qu’employa celui qui inventa l’art du langage, et l’on
y voit que, dans son principe, cet art eut une très-grande affinité avec la musique :
mais cela laisse encore un vide immense entre les premiers essais que l’on hasarda
pour imiter et l’époque de la formation de l’art qui prescrivit les règles de l’imitation
; car le langage ne fut aussi dans son origine qu’un art d’imitation (6), et l’est
même encore aujourd’hui danubien des cas. « Après qu’on eut remarqué, dit Socrate
» dans le Philèbe de Platon, que la voix étoit infinie, soit que cette découverte vienne
» d un dieu, ou de quelque homme divin , comme on le raconte en Égypte d’un
» certain Theuth qui, le premier, aperçut dans cet infini les voyelles comme étant
» non pas un, mais plusieurs, et puis d’autres lettres qui, sans tenir de la nature des
» voyelles, ont pourtant un certain son, et connut qu’elles avoient pareillement un
» nombre déterminé ; qui distingua encore une troisième espèce de lettres que nous
» appelons aujourd’hui muettes: après ces observations, il sépara une à une les lettres
» muettes et privées de son ; ensuite il en fit autant par rapport aux voyelles et aux
( i )-On trouve une description semblable de la cithare
d’A pollon, dans un des hymnes d’Orphée oui a pour
titre Apollinis suffimenium manna.
(2 ) Nous ne nous arrêterons pas à examiner ici
s’il est vraisemblable, ou non, qu’un même homme ait
pu inventer 'seul tant de sciences et tant d’arts dans
les premiers siècles de la civilisation en E g yp te , et
ensuite enseigner l’éloquence aux G re c s , tandis que
nous voyons les progrès de nos connoissances faire à
peine un pas par siècle. Le savant Jablonski a suffisamment
éclairci ce point dans son Panthéon Ægyptiorum,
part, v , chap. 5, où il traite fort au long du dieu T h o th ,
1 Hermès des Grecs. Il nous suffit en ce moment de savoir
que ces choses ont .été inventées en Egypte, et qu’elles
y ont existé avant d’être connues ailleurs, suivant
' A.
l’avis unanime de tous les auteurs anciens. A in s i, soit
que ces inventions soient le fruit des recherches d’un
seul homme pendant la courte durée de sa v ie , ou
celui des observations et des expériences suivies d’un
grand nombre de générations pendant plusieurs siècles,
ou pendant même des milliers d’années, on convient
généralement qu’elles ont été faites en Egypte; nous-
n’avons pas le droit d’établir.une opinion contraire.
( 3 ) J/r<y,££.» pour l’étymologie de ce nom, le Cratylus
de Platon, et ce qui en a été dit ci-dessus, page$80.
(4) Plat, de Legib., lib. II. Lucret. de Rerurn Naiura,
lib. V, v. 1022 et seqq.
( 5 ) Plutarque, des Propos de table, liv. I , quest. V,
page 365 G . •
(6) Plat. Cratylus, sive de recta jiominum ratione.