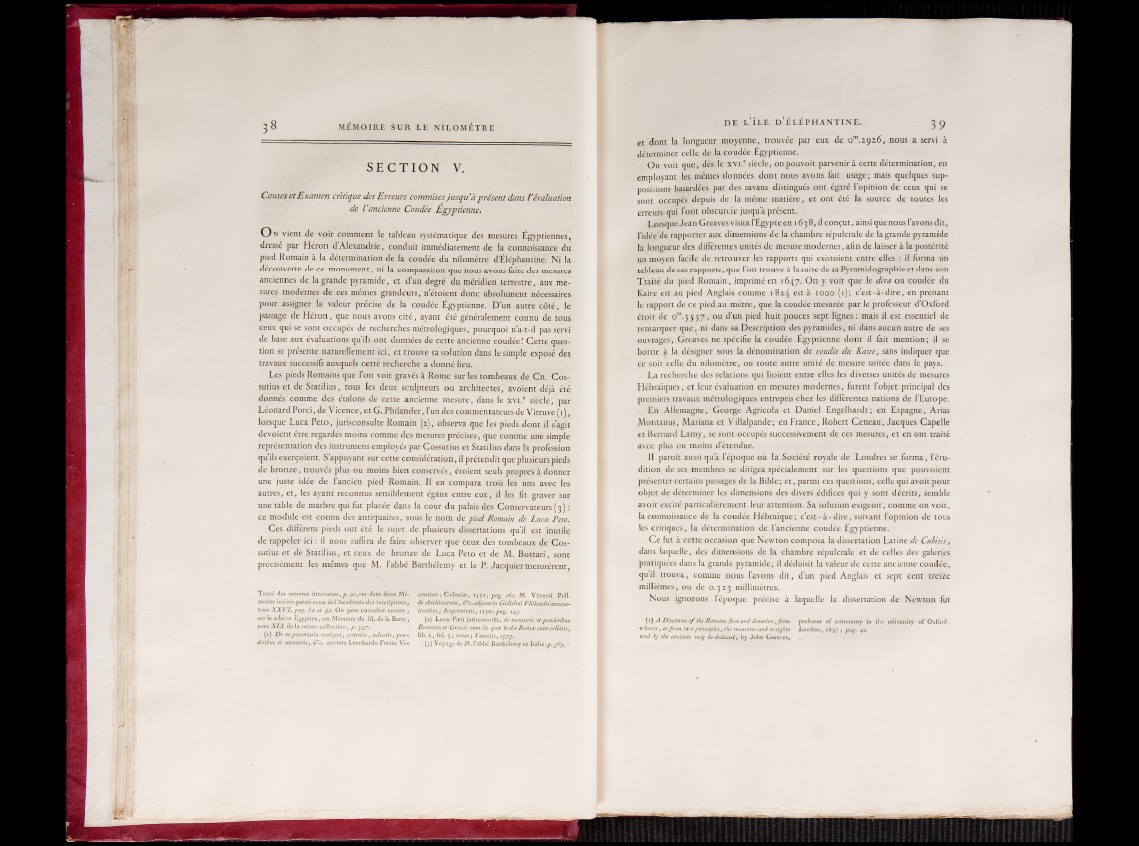
S E C T I O N V.
Causes et Examen critique des Erreurs commises ju sq u ’à présent dans l ’évaluation
de l ’ancienne Coudée Égyptienne.
O n vient de voir comment le tableau systématique des mesures Égyptiennes,
dressé par Heron d Alexandrie, conduit immédiatement de la connoissance du
pied Romain a la determination de la coudée du nilomètre d’Éléphantine. Ni la
découverte de ce monument, ni la comparaison que nous avons faite des mesures
anciennes de la grande pyramide, et d’un degré du méridien terrestre, aux mesures
modernes de ces memes grandeurs, n’étoient donc absolument nécessaires
pour assigner la valeur précise de la coudée Égyptienne. D ’un autre côté, le
passage de Héron, que nous avons cité, ayant été généralement connu de tous
ceux qui se sont occupes de recherches métrologiques, pourquoi n’a-t-il pas servi
de base aux évaluations quils ont données de cette ancienne coudée.' Cette question
se présente naturellement ici, et trouve sa solution dans le simple exposé des
travaux successifs auxquels cette recherche a donné lieu.
Les pieds Romains que l’on voit gravés à Rome sur les tombeaux de Cn. Cos-
sutius et de Statilius, tous les deux sculpteurs ou architectes, avoient déjà été
donnés comme des étalons de cette ancienne mesure, dans le x v i.' siècle, par
Léonard Porci, de Vicence, et G. Philander, l’un des commentateurs de Vitruve (i),
lorsque Luca Peto, jurisconsulte Romain (2), observa que les pieds dont il s’agit
devoient être regardes moins comme des mesures précises, que comme une simple
représentation des instrumens employés par Cossutius et Statilius dans la profession
qu iis exerçoient. S appuyant sur cette considération, il prétendit que plusieurs pieds
de bronze, trouves plus ou moins bien conservés, étoient seuls propres à donner
une juste idée de l’ancien pied Romain. Il en compara trois les uns avec les
autres, et, les ayant reconnus sensiblement égaux entre eux, il les fit graver sur
une table de marbre qui fut placée dans la cour du palais des Conservateurs (3.) :
ce module est connu des antiquaires, sous le nom de pied Romain de Luca Peto.
Ces différens pieds ont été le sujet de plusieurs dissertations qu’il est inutile
de rappeler ici : il nous suffira de faire observer que ceux des tombeaux de Cossutius
et de Statilius, et ceux de bronze de Luca Peto et de M. Bottari, sont
précisément les mêmes que M. l’abbé Barthélémy et le P. Jacquier mesurèrent,
Traité des mesures itinéraires, ». 90,"et dans deux Mémoires
insérés parmi ceux de l’A cadémie des inscriptions,
tom eX X V I , pag, 82 et 92. On peut consulter encore,
sur le schène Egyptien, un Mémoire de M. de la Barre,
tome X I X de la même collection, p. 347.
(1) D e repecuniaria an tiqua, sestertio , talentis, pon-
deribus et mensuris, ¿7c. auctore Leonhardo Portio V icentino
; C o lon iæ , 1551 \ pag. 160. M. Vitruvii Poil.
de Architectura, ¿7”c, adjunct is Gulielini Philandri annotation
ibus ; Argentorati, 15 50; pag. 143.
(2) Lucæ Pæti jurisconsulte de mensuris etponder'tbus
Romanis et Groecis cum iis quæ hodie Romoe sunt colla ris,
lib. I , fol. 5 , verso; Venetiis, 1573. "
(3) Voyage de M . l’abbé Barthélémy en Ita lie,p .389. •
et dont la longueur moyenne, trouvée par eux de om.2 9 z6 , nous a servi à
déterminer celle de la coudée Égyptienne.
On voit que, dès le x v i.' siècle, onpouvoit parvenir à cette détermination, en
employant les mêmes données dont nous avons fait usage; mais quelques suppositions
hasardées par des savans distingués ont égaré l’opinion de ceux qui se
sont occupés depuis de la même matière, et ont été la source de toutes les
erreurs qui l’ont obscurcie jusqu’à présent.
Lorsque Jean Greaves visita l’Égypte en 16 3 8, il conçut, ainsi que nous l’avons dit,
l’idée de rapporter aux dimensions de la chambre sépulcrale de la grande pyramide
la longueur des différentes unités de mesure modernes, afin de laisser à la postérité
un moyen facile de retrouver les rapports qui existoient entre elles : il forma un
tableau de ces rapports, que l’on trouve à la suite de sa Pyramidographie et dans son
Traité du pied Romain, imprimé en 1647. On y voit que le dera ou coudée du
Kaire est au pied Anglais comme 1824 est à 1000 (1); c’est-à-dire, en prenant
le rapport de ce pied au mètre, que la coudée mesurée par le professeur d’Oxford
étoit de o'”.5 5 5 7 , ou d’un pieJ huit pouces sept lignes: mais il est essentiel de
remarquer que, ni dans sa Description des pyramides, ni dans aucun autre de ses
ouvrages, Greaves ne spécifie la coudée Égyptienne dont il fait mention; il se
borne à la désigner sous la dénomination de coudée du Kaire, sans indiquer que
ce soit celle du nilomètre, ou toute autre unité de mesure usitée dans le pays.
La recherche des relations qui lioient entre elles les diverses unités de mesures
Hébraïques, et leur évaluation en mesures modernes, furent l’objet principal des
premiers travaux métrologiques entrepris chez les différentes nations de l’Europe.
En Allemagne, George Agricola et Daniel Engelhardt ; en Espagne, Arias
Montanus, Mariana et Villalpande; en France, Robert Ceneau, Jacques Capelle
et Bernard Lamy, se sont occupés successivement de ces mesures, et en ont traité
avec plus ou moins d’étendue.
Il paroît aussi qu’à l’époque où la Société royale de Londres se forma, l’érudition
de ses membres se dirigea spécialement sur les questions que pouvoient
présenter certains passages de la Bible; e t , parmi ces questions, celle qui avoit pour
objet de déterminer les dimensions des divers édifices qui y sont décrits, semble
avoir excité particulièrement leur attention. Sa solution exigeoit, comme on voit,
la connoissance de la coudée Hébraïque; c’e st-à -d ire , suivant l’opinion de tous
les critiques, la détermination de l’ancienne coudée Égyptienne.
Ce fut à cette occasion que Newton composa la dissertation Latine de Cubitis,
dans laquelle, des dimensions de la chambre sépulcrale et de celles des galeries
pratiquées dans la grande pyramide, il déduisit la valeur de cette ancienne coudée,
qu’il trouva, comme nous l’avons dit, d’un pied Anglais et sept cent treize
millièmes, ou de 0.523 millimètres.
Nous ignorons l’époque précise à laquelle la dissertation de Newton fut
(1) A Discourse o f the Romane foot and denarius, from professor o f astronomy in the university o f Oxford
whence, as from two principles, the measures and weights Lond on, 1647 ; pag. 41.
used by the ancients may be deduced; by John Greaves,