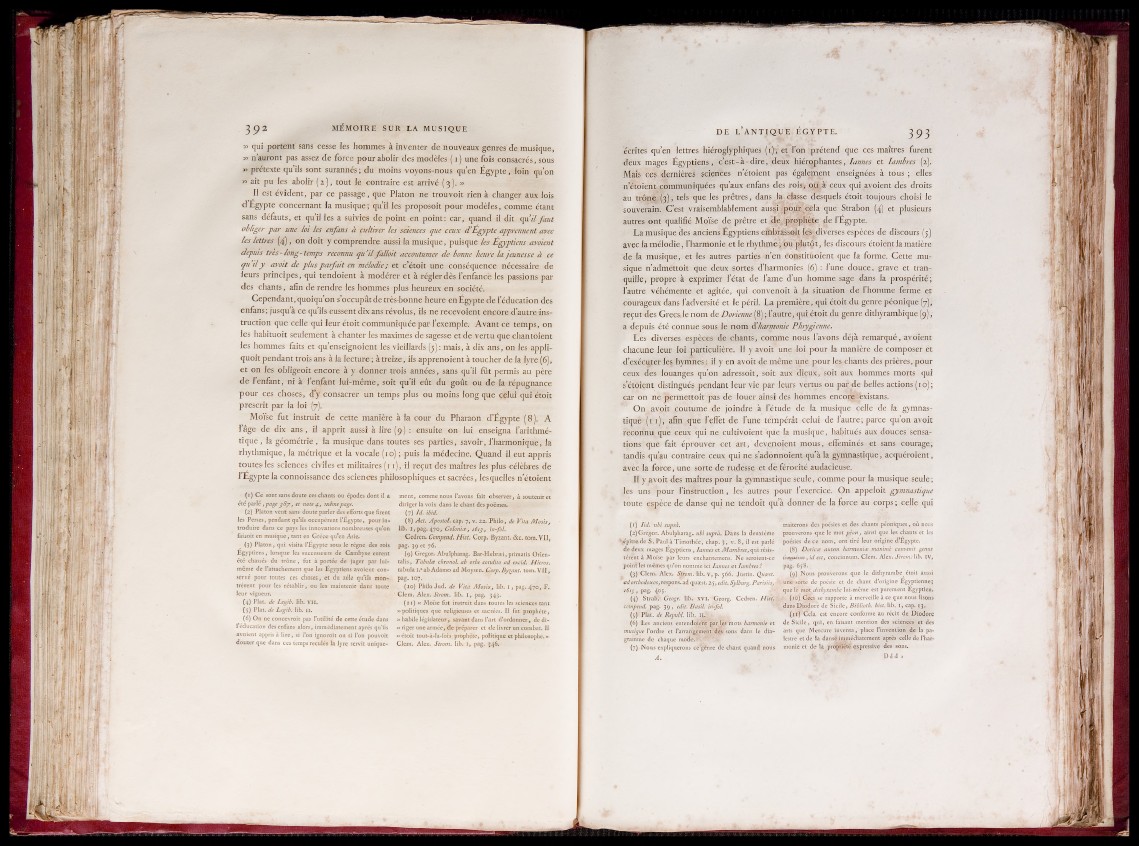
3 9 2 M É M O I R E S U R L A M U S I Q U E
» qui portent sans cesse les hommes à inventer de nouveaux genres de musique,
» n’auront pas assez de force pour abolir des modèles ( i ) une fois consacrés, sous
» prétexte qu’ils sont surannés ; du moins voyons-nous qu’en Égypte, loin qu’on
» ait pu les abolir (2), tout le contraire est arrivé (3). »
Il est évident, par ce passage, que Platon ne trouvoit rien à changer aux lois
^ % p t e concernant la musique ; qu’il les proposoit pour modèles, comme étant
sans défauts, et qu’il les a suivies de point en point: car, quand il dit qu'ilfa u t
obliger par une loi les enfans à cultiver les sciences que ceux d‘Égypte apprennent avec
les lettres (4), on doit y comprendre aussi la musique, puisque les Égyptiens avoient
depuis très - long- temps reconnu qu’d fallait accoutumer de bonne heure la jeunesse à ce
qu il y avoit de plus parfait en mélodie; et c’étoit une conséquence nécessaire de
leurs principes, qui tendoient à modérer et à régler dès l’enfancë les passions par
des chants, afin de rendre les hommes plus heureux en société.
Cependant, quoiqu’on s’occupât de très-bonne heure en Égypte de l’éducation des
enfans; jusqu’à ce qu’ils eussent dix ans révolus, ils ne recevoient encore d’autre instruction
que celle qui leur étoit communiquée par l’exemple. Avant ce temps, on
les habituoit seulement à chanter les maximes de sagesse et de vertu que chantoient
les hommes faits et qu’enseignoient les vieillards (j): mais, à dix ans, on les appli-
quoit pendant trois ans à la lecture ; à treize, ils apprenoient à toucher de la lyre (6),
et on les obligeoit encore à y donner trois années, sans qu’il fut permis au père
de 1 enfant, ni à l’enfant lui-même, soit qu’il eût du goût ou de la répugnance
pour ces choses, d’y consacrer un temps plus ou moins long que celui qui étoit
prescrit par la loi (7).
Moïse fut instruit de cette manière à la cour du Pharaon d’Égypte (8). A
l’âge de dix ans , il apprit aussi à lire (9) : ensuite on lui enseigna l’arithmétique
, la géométrie, la musique dans toutes ses parties, savoir, l’harmonique, la
rhythmique, la métrique et la vocale (10) ; puis la médecine. Quand il eut appris
toutes-les sciences civiles et militaires (11), il reçut des maîtres les plus célèbres de
EEgypte la connoissance des sciences philosophiques et sacrées, lesquelles n’étoient
(1) C e sont sans doute ces chants ou épod esd on til a ment, comme nous l’avons fait observer, à soutenir et
été p a rlé , page 3 8 7 , et note 4 , même page. diriger la voix dans le chant des poëmes.
(2) Platon veut sans doute parler des efforts que firent (7) Jd. ibid.
les Perses, pendant qu’ ils occupèrent l’Egypte, pour in- (8) A ct. Apostol. cap. 7, v. 22. P h ilo , de Vita Mos is
traduire dans ce pays les innovations nombreuses qu’on Iib. I , pag. 47Q, Coloniæ, 1613, in-fol.
faisoit en musique, tant en Grèce qu’en Asie. Cedren. Compend. H is t. Corp. Byzant. & c . tom. V I I ,
(3) Platon , qui visita l’Egypte sous le règne des rois pag. 39 et 76.
Egyptiens, lorsque les successeurs de Cambyse eurent (9) Gregor. Abulpharag. Bar-Hebræi,primatis Orien-
été chassés du t rô n e , fut à portée de juger par lui- talis, Tabulas chronol. ab orbe condho ad excid. Hieros.
même de l’attachement que les Egyptiens avoient con- tabula i.*ab Adamo ad Moysen. Corp. Byzant. tom. V I I ,
servé pour toutes ces choses, et du zèle qu’ils mon- pag. 10,7.
trèrent pour les rétablir, ou les maintenir dans toute (10) Philo Jud. de Vita M o s is , Iib. I , pag. 47.0., F.
leur vigueur. 1 Çlem. Alex-, Strom. Iib. I , pag. 34.3.
(4) Plat, de Legib. Iib. VII. (1 1 ) « Moïse fut instruit dans toutes les sciences tant
(5) Plat, de Legib. iib. i l . »politiques que religieuses et sacrées. II fut prophète,
(6) On ne concevrait pas l’utilité de cette étude dans » habile législateur, savant dans l’art d’ordonner, de di-
I éducation des enfans alors, immédiatement après qu’ils » riger une armée, de préparer et de livrer un,combat. II
avoient appris à lire , si l’on ignorait ou si l’on pouvoit » é to it tout-à-Ia-fois prophète, politique et philosophe.»
douter que dans ces temps reculés la lyre servît unique- Clem. Alex. Strom. Iib. 1, pag. 346.
D E L A N T I Q U E E G Y P T E .
écrites qu’en lettres hiéroglyphiques site et l’on prétend que ces maîtres furent
deux mages Égyptiens, c’est-à-dire, deux hiérophantes, Iannes et Iambrcs (2).
Mais ces dernières sciences n’étoient pas également enseignées à tous ; elles
n’étoient communiquées qu’aux enfans des rois:, ou à ceux qui avoient des droits
au trône (3), tels que les prêtres, dans la classe desquels étoit toujours choisi le
souverain. C’est vraisemblablement ausÿ^po.ur _c,ela que Strabon (4) et plusieurs
autres ont qualifié Moïse de prêtre et de prophète de l’Égypte.
La musique des anciens Égyptiens cntbràssoit les diverses espèces de discours (y)
avec la mélodie, l’harmonie et le rhythme ; bu plutôt, les discours étoient la matière
de la musique, et les autres parties n’en constitùoient que la forme. Cette musique
n’admettoit que deux sortes d’harmonies (6) : l’une douce, grave et tranquille,
propre à exprimer l’état de l’ame d’un homme sage dans la prospérité;
l’autre véhémente et agitée, qui convenoit à la situation de l’homme ferme et
courageux dans l’adversité et le péril. La première, qui étoit du genre péonique (7),
reçut des Grecs, le nom de Dorienne (8) ; l’autre, qui étoit du genre dithyrambique (9);,-
a depuis été connue sous le nom £ harmonie Phrygienne.
Les diverses espèces de chants, comme nous l’avons déjà remarqué, avoient
chacune leur loi particulière. Il y avoit une loi pour la manière de composer et
d’exécuter les hymnes : il y en avoit de même une pour les chants des prières, pour
ceux des louanges qu’on adressoit, soit aux dieux, soit aux hommes morts qui
s’étoicnt distingués pendant leur vie par leurs vertus ou par de belles actions (10);
car on ne permettoit pas de louer ainsi des hommes encorei'existans.
On avoit coutume de joindre à l’étude de la musique celle de la gymnas-
tiquè (i 1), afin que l’effet de l’une tempérât celui de l’autre; parce qu’on avoit
reconnu que ceux qui ne cultivoient que la musique, habitués aux douces sensations
que fait éprouver cet art, devenoient mous, efféminés et sans courage,
tandis qu’au contraire ceux qui ne s’adonnoient qu’à la gymnastique, acquéroient,
avec la force, une sorte de rudesse et de férocité audacieuse.
II y avoit des maîtres pour la gymnastique seule, comme pour la musique seule ;
les uns pour l’instruction, les autres pour l’exercice. On appeloit gymnastique
toute espèce de danse qui ne tendoit qu’à donner de la force au corps ; celle qui
(r) lid . ubi suprà.
(2) Gregor. Abulpharag. ubi suprà. Dans la deuxième
i-épître de S. Paul à Timothée, chap. 3 , v. 8, il est parlé
de deux mages Egyptiens, Iannes et Mambres, qui résistèrent
à Moïse par leurs enchantemens. N e seroient-ce
point les mêmes qu’on nomme ic i Iannes et 1ambres /
(3) Clem. A lex . Strom. Iib. v , p. 566. Justin. Quoest.
à d orthodoxes, respons. ad quæst. 25, edit. Sylburg, Parisiis,
1613, pag. 405.
(4) Strab,* Geogr, Iib. x v i . Georg. Cedren. Hist,
compend. pag. 3 9 , edit. Basil, in-fol.
(5) Plat, de Republ. Iib. il .
(6) Les anciens entendqient par les mots harmonie et
musique l’ordre et l’arrangement des sons dans le diagramme
de chaque mode.
(7) Nous expliquerons ce genre de chant quand nous
A .
traiterons des poésies et des chants péoniques , où nous
prouverons que le mot péon, ainsi que les chants et les
poésies de ce nom, ont tiré leur origine d’Egypte.
(8) Dóricas autem harmonice maxime convenir genus
tvetùjuônov, id est, concinnum. Clem. Alex. Strom. Iib. Iv ,
pag. 658.
(9) Nous prouverons que le dithyrambe étoit aussi
une sorte de poésie et de chant d’origine Egyptienne;
que lé mot dithyrambe lui-même est purement Egyptien.
t (10). Ce c i se rapporte à merveille à ce que nous lisons
dans Diodore de S ic ile, Biblioth. hist. Iib. 1 , cap. 13.
(11) Ce la est encore conforme au récit de Diodore
de S ic ile , qui, en faisant mention des sciences et des
arts que Mercure inventa, place l’ invention de la palestre
et de la danse immédiatement après celle de l’harmonie
et de la propriété expressive des sons.
Dd d 2