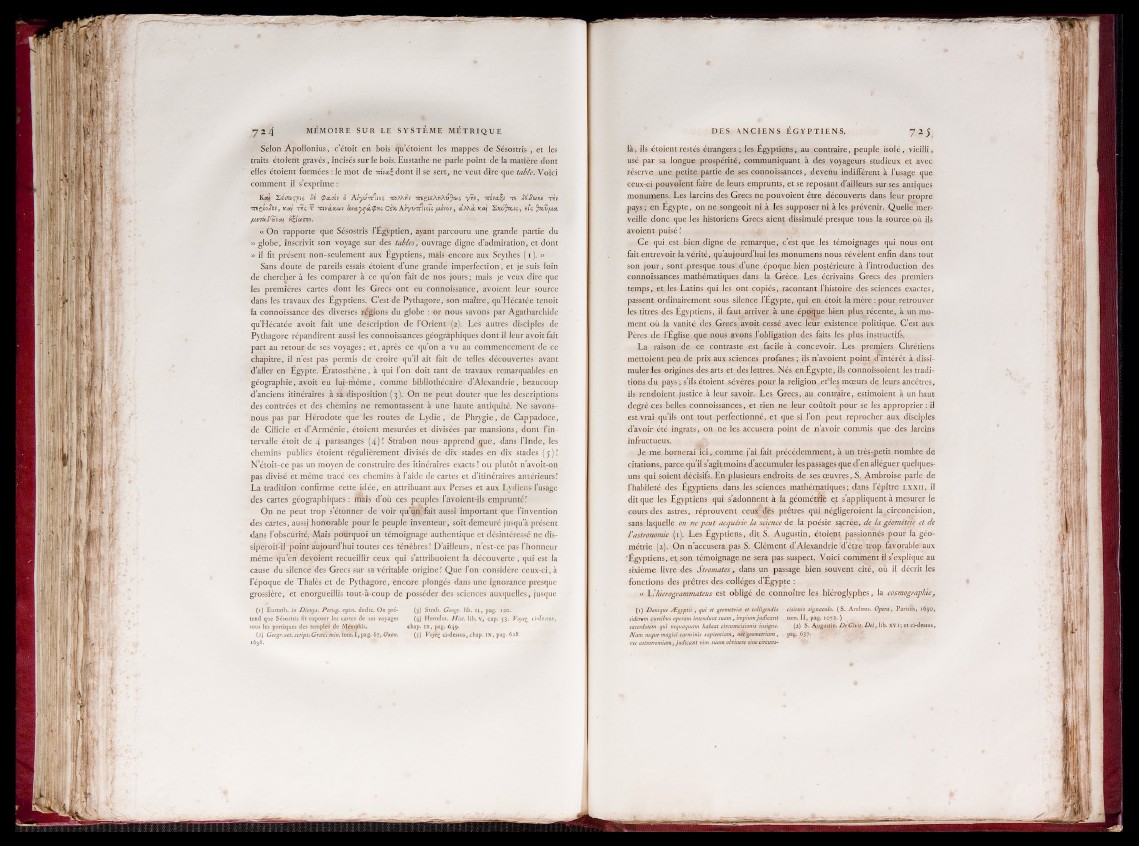
Selon Apollonius, c’étoit en bois qu’étoient les mappes de Sésostris , et les
traits étoient gravés, incisés sur le bois. Eustathe ne parle point de la matière dont
elles étoient formées : le mot de 7n*aJ; dont il se sert, ne veut dire que table. Voici
comment il s’exprime :
KXeoûjçviç Çctjii o A'iyjarltoi 7rE&ieÀïiAu9*v$ ■y«*', ts IIS'ùjki tkv
•ntejtoSbv, x.aj t v s r m iix a ii/ cw cL jç iic p it i C f x A ly v ir iio t i/M iio v , E x v j t u i , e lç ÿu,v/wi
/ue7afÇsvui Yiçïairtv.
« On rapporte que Sésostris l’Égÿptien, ayant parcouru une grande partie du
» globe, inscrivit son voyage sur des tables, ouvrage digne d’admiration, et dont
3) il fit présent non-seulement aux Egyptiens, mais encore aux Scythes (i). »
Sans doute de pareils essais étoient d’une grande imperfection, et je suis loin
de chercher à les comparer à ce qu’on fait de nos jours ; mais je veux dire que
les premières cartes dont les Grecs ont eu connoissance, avoient leur source
dans les travaux des Égyptiens. C’est de Pythagore, son maître, qu’Hécatée tenoit
la connoissance des diverses régions du globe : or nous savons par Agatharchide
qu’Hécatée avoit fait une description de l’Orient (2). Les autres disciples de
Pythagore répandirent aussi les connoissances géographiques dont il leur avoit fait
part au retour de ses voyages ; e t , après ce qu’on a vu au commencement de ce
chapitre, il n’est pas permis de croire qu’il ait fait de telles découvertes avant
d’aller en Egypte. Ératosthène, à qui l’on doit tant de travaux remarquables en
géographie, avoit eu lui-même, comme bibliothécaire d’Alexandrie, beaucoup
d’anciens itinéraires .à sa-disposition (3). On ne peut douter que les descriptions
des contrées et des chemins ne remontassent à une haute antiquité. Ne savons-
nous pas par Hérodote que les routes de Lydie, de Phrygie, de Cappadoce,
de Cilicie et d’Arménie, étoient mesurées et divisées par mansions, dont l’intervalle
étoit de 4 parasanges (4 )! Strabon nous apprend que, dans l’Inde, les
chemins publics étoient régulièrement divisés de dix stades en dix stades (y)!
N’étoit-ce pas un moyen de construire des itinéraires exacts ! ou'plutôt n’avoit-on
pas divisé et même tracé ces chemins à l’aide de cartes et d’itinéraires antérieurs!
La tradition confirme cette idée, en attribuant aux Perses et aux Lydiens l’usage
des cartes géographiques : mais d’où ces peuples l’avoient-ils emprunté!
On ne peut trop s’étonner de voir qu’un fait aussi important que l’invention
des cartes, aussi honorable pour le peuple inventeur, soit demeuré jusqu’à présent
dans l’obscurité. Mais pourquoi un témoignage authentique et désintéressé ne dis-
siperoit-il point aujourd’hui toutes ces ténèbres! D ’ailleurs, n’est-ce pas l’honneur
même dù’en devoiént recueillir ceux qui s’attribuoient la découverte , qui est la
cause du silence des Grecs sur sa véritable origine! Que l’on considère ceux-ci, à
l’époque de Thalès et de Pythagore, encore plongés dans une ignorance presque
grossière, et enorgueillis tout-à-coup de posséder des sciences auxquelles, jusque
(1) Eustath. in Dionys. Perieg. epist. dedîc. On pré- (3) Strab. Geogr. lib. H , pag. 120.
tend que Sésostris fit exposer les cartes de ses voyages (4) Herodot. His t. Iib. V, cap. 53. Voyez ci-dejsus,
sous les portiques des temples.de Memphis. chap. IX, pag. 649.
(2) Geogr. Met, script. Grotc. min, tom. I , pag. 67, Qxon. (5) Voye% ci-dessus, chap. IX, pag. 628.
là, ils étoient restés étrangers ; les Égyptiens, au contraire, peuple isolé, vieilli,
usé par sa longue prospérité, communiquant à des voyageurs studieux et avec
réserve une petite partie de ses connoissances, devenu indifférent à l’usage que
ceux-ci pouvoient faire de leurs emprunts, et se reposant d’ailleurs sur ses antiques
monumens. Les larcins des Grecs ne pouvoient être découverts dans leur propre
pays ; en Egypte, on ne songeoit ni à les supposer ni à les prévenir. Quelle merveille
donc que les historiens Grecs aient dissimulé presque tous la source où ils
avoient puisé !
Ce qui est bien digne de remarque, c’est que les témoignages qui nous ont
fait entrevoir la vérité, qu’aujourd’hui les monumens nous révèlent enfin dans tout
son jour , sont presque tous d’une époque bien postérieure à l’introduction des
connoissances mathématiques dans la Grèce. Les écrivains Grecs des premiers
temps, et les Latins qui les ont copiés, racontant l’histoire des sciences exactes,
passent ordinairement sous silence l’Egypte, qui en étoit la mère : pour retrouver
les titres des Égyptiens, il faut arriver à une époque bien plus récente, à un moment
où la vanité des Grecs avoit cessé avec leur existence politique. C’est aux
Pères de l’Église que nous avons l’obligation des faits les plus instructifs.
La raison de ce contraste est facile à concevoir. Les premiers Chrétiens
mettoient peu de prix aux sciences profanes ; ils n’avoient point d’intérêt à dissimuler
les origines des arts et des lettres. Nés en Egypte, ils connoissoient les traditions
du pays ; s’ils étoient sévères pour la religion et'les moeurs de leurs ancêtres,
ils rendoient justice à leur savoir. Les Grecs, au contràire, estimoient à un haut
degré ces belles connoissances, et rien ne leur coûtoit pour se les approprier : il
est vrai qu’ils ont tout perfectionné, et que si l’on peut reprocher aux disciples
d’avoir été ingrats, on ne les accusera point de n’avoir commis que des larcins
infructueux.
Je me bornerai ici, comme j’ai fait précédemment, à un très-petit nombre de
citations, parce qu’il s’agit moins d’accumuler les passages que d’en alléguer quelques-
uns qui soient décisifs. En plusieurs endroits de ses oeuvres, S. Ambroise parle de
l’habileté des Égyptiens dans les sciences mathématiques; dans l’épître l x x i i , il
dit que les Égyptiens qui s’adonnent à la géométrie qt s’appliquent à mesurer le
cours des astres, réprouvent ceux des prêtres qui négligeroient la .circoncision,
sans laquelle on ne peut acquérir la science de la poésie sacrée, de la géométrie et de
l'astronomie (i). Les Égyptiens, dit S. Augustin, étoient passionnés pour la géométrie
( 2 ) . On n’accusera pas S. Clément d’Alexandrie d’être trop favorable aux
'Égyptiens, et.son témoignage ne sera pas suspect. Voici comment il s’explique au
sixième livre des Stromates, dans un passage bien souvent cité, où il décrit les
fonctions des prêtres des collèges d’Égypte :
« L ’hierogrammateus est obligé de connoître les hiéroglyphes, la cosmographie,
(1) Denique Ægyptii, qui et geometría: et colligendis cisionis signáculo. (S . Ambros. Opera, Parisiis, 1690,
siderum cursibus operam intendunt suam, impium judicant tom. I I , .pag. 1 0 7 2 . )
sacerdotem qui nequáquam habeat circumcisionis insigne. (a) S . Augustin. DeCivit. D e i , Iib. XVI; et ci-dessus,
Nam neque magici carminis sapientiam, nec'geometriam, pag. 637.
nec astronomiam, judicant van suam obtinere sine circum