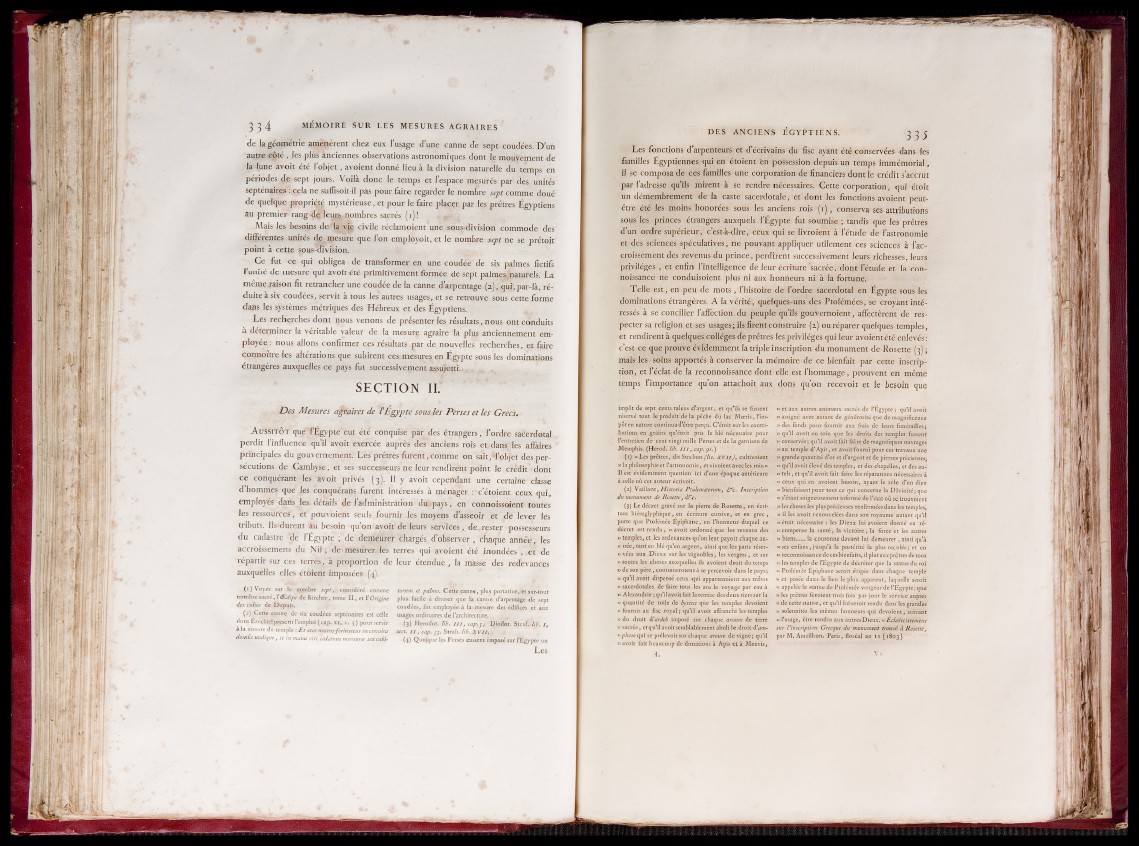
de la géométrie amenèrent chez eux l’usage d’une canne de sept coudées. D ’un
autre cô té , les plus anciennes observations astronomiques dont le mouvement de
la -lune avoit été l’objet , avoient donné lieu à la division naturelle du temps en
périodes de sept jours. Voilà donc le temps et l’espace mesurés par' des unités
septénaires : cela ne suffisoit-il pas pour faire regarder le nombre sept comme doué
de quelque propriété mystérieuse, et pour le faire placer par les prêtres Égyptiens
au premier rang de leurs nombres sacrés (i)!
Mais les besoins de* la vie civile réclamoient une sous-division commode des
différentes unités de mesure que l’on employoit, et le nombre sept ne se prêtoit
point à cette sous-division.
■ Ce fut -ce qui obligea de transformer en une coudée de six palmes fictifs
l’unité de mesure qui avoit été primitivement formée de sept palmes>naturels. La
même raison fît retrancher une coudée de la canne d’arpentage (2),’qui, par-là, réduite
à six coudées, servit à tous les*autres usages, et se retrouve sous cette forme
dans les systèmes métriques des Hébreux et des Égyptiens.
Les recherches dont nous venons de présenter les résultats, nous ont conduits
à déterminer la véritable valeur de la mesure agraire la plus anciennement employée:
nous allons confirmer ces résultats par de nouvelles recherches, et faire
connoître les altérations que subirent ces mesures en Égypte sous les dominations
étrangères auxquelles ce pays fut successivement assujetti.
SECTION H
Des Mesures agraires de tEgypte sous les Perses et les Grecs.
A ussitôt que l’Égypte eut été conquise par des étrangers, l’ordre sacerdotal
perdit l’influence qu’il avoit exercée auprès des' anciens rois et dans les affaires
principales du gouvernement. Les prêtres furent, comme on sait,*i’objet des persécutions
de Cambyse, et ses successeurs ne leur rendirent point le crédit dont
ce conquérant les avoit privés (3). Il y avoit cependant une certaine classe
d’hommes que les conquérans furent intéressés à ménager : c’étoient ceux qui,
employés dans les, détails de l’administration du pays, en connoissoient toutes
les ressources, et pouvoient seuls fournir les moyens d’asseoir et de lever les
tributs. Ils-durent au besoin qu’on avoit de leurs services, de .rester possesseurs
du cadastre de l’Égypte ; de demeurer chargés d’observer , chaque année, les
accroissemens du Nil ; de mesurer les terres qui avoient été inondées , et de
répartir sur ces terrés, à proportion de leur étendue. la masse des redevances
auxquelles elles étoient imposées (4).
( 1 ) Voyez sur le nombre sept, considéré - comme torum et palmo. Cette canne, plus .portative, et sur-tout
nombre sacré, I OEdipe de Kircher, tome I I , et l'Origine plus facile à diviser que la canne d’arpentage de sept des cultes de Dupuis. ‘ coudées, fut employée à la mesure des édifices et aux
(2) Cette canne de six coudées septénaires est ceile usages ordinaires de l’architecture.
dont Evréi.idprescrit l’emploi (cap. XL, v. 5) pourservtr (3) Herodot. lib. lu, cap.p; Diodo’r. Sicul. V/i, /,
à la mesure do temple : l'.l t’cct murüsjbrinscajs in ciiruitn sect.Il, cap. 35. Strab. lib. S VI I .
domus ¡indique, et in manu y/ri calamus mensum sexcubt- (4) Quoique les Perses eussent imposé sur l’É gypte un
Les
Les fonctions d arpenteurs et d écrivains du fisc ayant été conservées dans, les
familles Égyptiennes qui en étoient fen possession depuis un temps immémorial,
il se composa de ces familles une corporation de financiers dont le crédit s’accrut
par l’adresse qu’ils mirent à se rendre nécessaires. Cette corporation, qui étoit
un démembrement de la caste sacerdotale, et dont les fonctions avoient peut-
être été les moins honorées sous les anciens rois (1), conserva ses attributions
sous les princes étrangers auxquels l’Égypte fut soumise ; tandis que les prêtres
d’un ordre supérieur, c’est-à-dire, ceux qui se livroient à l’étude de l’astronomie
et des sciences spéculatives, ne pouvant appliquer utilement ces sciences à l’accroissement
des revenus du prince, perdirent successivement leurs richesses, leurs
privilèges , et enfin l’intelligence de leur écriture sacrée, dont l’étude et la con-
noissance ne conduisoient plus ni aux honneurs ni à la fortune.
Telle est, en peu de mots, l’histoire de l’ordre sacerdotal en Égypte sous les
dominations étrangères. A la vérité, quelques-uns des Ptolémées, se croyant intéressés
à se concilier l’affection du peuple qu’ils gouvernoient, affectèrent de respecter
sa religion et ses usages; ils firent construire (2) ou réparer quelques temples,
et rendirent à quelques collèges de prêtres les privilèges qui leur avoientété enlevés :
c’est ce que prouve évidemment la triple inscription du monument de Rosette (3) ;
mais les soins apportés à conserver la mémoire de ce bienfait par cette inscription,
et l’éclat de la reconnoissance dont elle est l’hommage, prouvent en même
temps l’importance qu’on attachoit aux dons qu’on recevoit et le besoin que
impôt de sept c.ents talens d’argent, et qu’ ils se fussent
réservé tout le produit de la pêche du lac Moeris, l’impôt
en nature continua d’être perçu. C ’étoit sur les contributions
en grains- qu’étoit pris le blé nécessaire pour
l’entretien de cent vingt mille Perses et de la garnison de
Memphis. (Herod. lib. m , cap. pr.)
(1) «Les prêtres, ditStrabon (liv . x v i i ) , cultivoient
» la philosophie et l’astronomie, etvivoientavecles rois.»
II est évidemment question ici d’une époque antérieure
a celle où cet auteur écrivoit.
(2). Vaillant, Historia Ptolemoeorum, ¿7c. Inscription
du monument de Rosette, <1? c.
(3) Le décret gravé sur la pierre de Rosette, en écriture
hiéroglyphique, en écriture cursive, et en g rec ,
porte que Ptolémée Epiphane,"en l’honneur duquel ce
décret est rendu, « avoit ordonné que les revenus des
» temples, et les redevances qu’on leur payoit chaque an-
» née, tant en blé qu’en argent, ainsi que les parts réser-
» vées aux Dieux sur les vignobles, les vergers, et sur
» toutes les choses auxquelles ils avoient droit du temps
» de son père, çontinueroient à se percevoir dans le pays;
» qu’il avoit dispensé ceux qui appartenoient aux tribus
» sacerdotales de faire tous les ans le voyage par eau à
» Alexandrie ; qu’il avoit fait la remise des deux tiers sur la
» quantité de toile de byssus que les temples dévoient
» fournir au fisc royal ; qu’il avoit affranchi les temples
» du droit d*ardeb imposé sur chaque aroure de terre
» sacrée, et qu’ il avoit semblablement aboli le.droit d’am-
» phorequi se prélevoit sur chaque aroure de vigne; qu’il
»avoit fait beaucoup de donations à Apis et à Mnevis,
A.
» et aux autres animaux sacrés de l’Égypte; qu’il avoit
» assigné avec autant de générosité que de magnificence
» des fonds pour fournir aux frais de leurs funérailles ; v qu’il avoit eu soin que les droits des temples fussent
» conservés ; qu’ il avoit fait faire de magnifiques ouvrages
»■au temple d’Apis, et avoit fourni pour ces travaux une
» grande quantité d’or et d’argent et de pierres précieuses;
» qu’il avoit élevé des temples, et des chapelles, et des au-
» tels, et qu’il avoit fait faire les réparations nécessaires à
» ceux qui en avoient besoin, ayant le zèle d’un dieu
» bienfaisant pour tou t ce qui concerne la Divinité ; que
» s’étant soigneusement informé de l’état où se trouvoient
» les choses les plus précieuses renfermées dans les temples,
» il les avoit renouvelées dans son royaume autant qu’il
» étoit n é c e s s a ir e le s Dieux lui avoient donné en ré-
» compense la santé, la vic to ire , la force et les autres
» biens...... la couronne devant lui demeurer, ainsi qu’à
»ses enfans> jusqu’à la postérité la plus reculée; et en
» reconnoissance de ces bienfaits, il plut aux prêtres de tous
» les temples de l’E gypte de décréter que la statue du roi
» Ptolémée Epiphane seroit érigée dans chaque temple
» et posée dans le lieu le plus apparent, laquelle seroit
» appelée la statue de Ptolémée vengeur de l’É gypte; que'
» les prêtres fèroient trois fois par jour le service auprès
» de cette statue-, et qu’il lui seroit rendu dans les grandes
» solennités les mêmes honneurs qui devoient; suivant
» l’usage, être rendus aux autresDieux. » Éclaircissemens
sur l’ inscription Grecque du monument trouvé à Rosette,
par M. Ameilhon. Paris, floréal an n [1803].